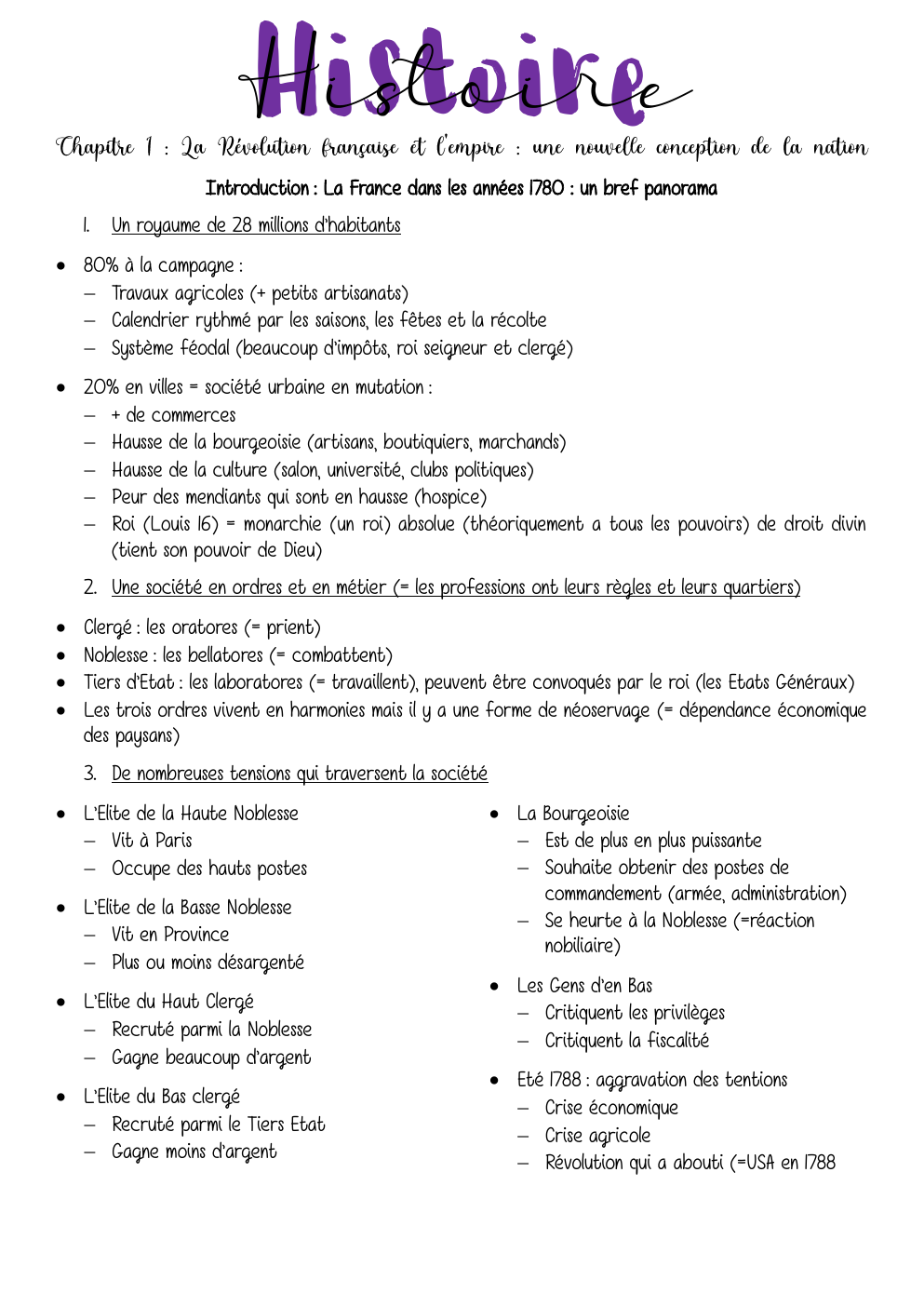La France dans les années 1780 : un bref panorama
Publié le 25/09/2025
Extrait du document
«
Histoire
Histoire
Introduction : La France dans les années 1780 : un bref panorama
1.
Un royaume de 28 millions d’habitants
• 80% à la campagne :
− Travaux agricoles (+ petits artisanats)
− Calendrier rythmé par les saisons, les fêtes et la récolte
− Système féodal (beaucoup d’impôts, roi seigneur et clergé)
• 20% en villes = société urbaine en mutation :
− + de commerces
− Hausse de la bourgeoisie (artisans, boutiquiers, marchands)
− Hausse de la culture (salon, université, clubs politiques)
− Peur des mendiants qui sont en hausse (hospice)
− Roi (Louis 16) = monarchie (un roi) absolue (théoriquement a tous les pouvoirs) de droit divin
(tient son pouvoir de Dieu)
2.
Une société en ordres et en métier (= les professions ont leurs règles et leurs quartiers)
•
•
•
•
Clergé : les oratores (= prient)
Noblesse : les bellatores (= combattent)
Tiers d’Etat : les laboratores (= travaillent), peuvent être convoqués par le roi (les Etats Généraux)
Les trois ordres vivent en harmonies mais il y a une forme de néoservage (= dépendance économique
des paysans)
3.
De nombreuses tensions qui traversent la société
• L’Elite de la Haute Noblesse
− Vit à Paris
− Occupe des hauts postes
• L’Elite de la Basse Noblesse
− Vit en Province
− Plus ou moins désargenté
• L’Elite du Haut Clergé
− Recruté parmi la Noblesse
− Gagne beaucoup d’argent
• L’Elite du Bas clergé
− Recruté parmi le Tiers Etat
− Gagne moins d’argent
• La Bourgeoisie
− Est de plus en plus puissante
− Souhaite obtenir des postes de
commandement (armée, administration)
− Se heurte à la Noblesse (=réaction
nobiliaire)
• Les Gens d’en Bas
− Critiquent les privilèges
− Critiquent la fiscalité
• Eté 1788 : aggravation des tentions
− Crise économique
− Crise agricole
− Révolution qui a abouti (=USA en 1788
Problématique : Comment les périodes révolutionnaire et impériale instaurent-elles un nouveau rapport
entre nation et pouvoir politique ?
En 1789, la France est profondément endettée, et le roi Louis XVI se trouve confronté à deux options :
désavouer la dette de son royaume ou convoquer les États généraux.
Conseillé par Necker, son ministre
des Finances, le roi choisit, à contre cœur, de convoquer les États généraux le 24 janvier 1789.
I.
La Révolution française et l’affirmation de la souveraineté nationale (mai 1789 – septembre
1792)
A.
L’année 1789 marque la fin de l’Ancien régime
1.
Deux acteurs pour une révolution politique
Les Etats Généraux
Le 5 mai 1789, les États généraux s’ouvrent à Versailles avec la convocation des trois ordres, représentés
par leurs députés.
Après plusieurs mois de préparation, le Tiers État nourrit de grandes attentes,
notamment en matière de meilleure représentation politique.
Ses revendications sont consignées dans des
cahiers de doléances.
Cependant, les députés du Tiers État sont déçus, car il n’y a pas de réformes politiques majeures en
faveur de leur ordre, et seule la question d’un nouvel impôt est abordée.
Le vote se fait toujours par
ordre, ce qui désavantage le Tiers État, qui, bien que représentant 96 % de la population, n’a qu’une voix
face aux deux voix de la noblesse et du clergé.
Pour protester, le Tiers État refuse de débattre et de
voter par ordres, bloquant ainsi les États généraux pendant plusieurs semaines.
Le 17 juin 1789, un premier acte révolutionnaire se produit : les députés du Tiers État, rejoints par quelques
membres de la noblesse et surtout du clergé, se constituent en Assemblée nationale, considérant qu’ils
représentent 96 % de la nation.
Cet acte est révolutionnaire, car il transfère la souveraineté du roi à
la nation, affirmant que seuls ses représentants peuvent décider pour l’ensemble des citoyens.
Pour eux,
le roi ne peut s’opposer aux décisions de l’Assemblée.
Le serment du peu de paume
Le transfert de la souveraineté du roi va se concrétiser par un deuxième acte révolutionnaire : le serment
du jeu de paume.
Le matin du 20 juin 1789, il pleut sur Versailles et le roi leur refuse l’entrer à l’Hôtel Des Menus Plaisirs
aux députés de l’Assemblée nationale.
Ceux-ci improvisent une réunion dans la salle du Jeu de Paume.
Ils
discutent, puis Bailly (élut présidant de l’assemblé Nationale) a l’idée de prêter serment « Nous ne nous
séparerons pas tant que nous n’aurons pas donné de constitution à la France » Les députés présent
prêtent tous serment, ils conjurent.
Il existe deux retranscriptions écrites pour rendre cela concret et à la fin de chaque livre il y a une
signature de tous les députés présent (= la révolution est collective).
Ce serment à une portée politique
majeure : les députés, en agissant au nom de la nation, affirment leur rôle en tant que voix collective du
peuple.
Il s’agit d’une « journée révolutionnaire » qui, commencée le matin et achevée le soir, marque un point
de non-retour et amorce un renversement de l’ordre établi.
Malgré cela, les députés espèrent encore
collaborer avec le roi ; la plupart étant royalistes, ils craignent même d’être emprisonnés à la Bastille.
Toutefois, cette journée historique est souvent perçue comme ayant moins d’impact que la prise de la
Bastille, car elle n’implique pas directement le peuple, mais seulement ses représentants.
Début juillet, le roi fait positionner autour de Paris et Versailles des troupes composées d’étrangers.
− Le peuple craint un coup de force du roi contre la nouvelle Assemblée pour rétablir son autorité
absolue.
− En réaction une milice parisienne est donc créée le 13 juillet.
Elle récupère des armes et reçoit le
soutien de soldats pour attaquer la forteresse de la Bastille où se trouve la poudre.
Cette action
populaire est le premier acte de violence, qui fait environ 100 morts (la Bastille elle-même ne
comptait que quelques prisonniers) et le gouverneur de la bastille est massacré.
Pour calmer le peuple parisien, le roi ordonne le retrait des troupes étrangères.
2.
Un acteur pour une révolution sociale
a.
Le peuple des campagnes va accélérer la transformation de la société
Les événements parisiens ont une « onde de choc » sur les campagnes, car tout ce qui se passe à Paris
résonne dans les campagnes.
C’est la Grande Peur (juillet-août 1789).
Cette période se traduit par une
prise d’assaut des châteaux par les paysans, accompagnée de combats.
Les paysans craignent des
représailles suite aux événements parisiens et réagissent par anticipation, en s’opposant aux privilèges.
Ils brûlent les contrats où sont inscrits les droits féodaux.
Face à cela, les nobles choisissent d’émigrer,
fuir pour échapper aux troubles.
Dans ce contexte de crise, la nuit du 4 août 1789 voit les députés des trois ordres proclamer l’abolition
des privilèges : fin des corvées, des droits féodaux, de la dîme payée à l’Église, ainsi que des dispenses
d’impôts accordées à la noblesse et au clergé.
Cette proclamation est acceptée facilement par les
députés, non seulement par peur mais aussi dans l’optique d’arrêter les violences et de créer une société
nouvelle.
b.
La nuit du 4 août 1789 : abolition des privilèges
La poursuite de la nuit du 4 août conduit à l’ambition de créer une société nouvelle, illustrée par la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789.
La DDHC reprend et complète
les décisions prises le 4 août en affirmant que l’unité nationale repose sur des idées de liberté (liberté
d’opinion, de culte, d’expression), d’égalité civile (égalité des droits) et sur le droit de propriété.
Elle
définit les droits et devoirs des citoyens et rappelle la nécessité de la séparation des pouvoirs, selon
l’article 16.
Cependant, le roi Louis XVI, profondément attaché aux privilèges de classe, refuse de signer les décrets
du 4 août et du 26 août.
Il rappelle ses troupes à Versailles, ne voulant pas se soumettre aux nouvelles
réformes.
3.
5 et 6 octobre 1789 : une nouvelle action politique du peuple parisien
Les troubles de l’été ont créé une situation économique difficile.
Le manque de pain pousse le peuple
parisien à se rendre à Versailles pour en réclamer à l’Assemblée et au roi.
Le château est envahi et sous
la pression populaire le roi est contraint de signer les décrets du 4 et 26 août.
C’est la 2ème fois que
la violence est utilisée.
Le peuple, qui craint une fuite du roi, l’oblige à venir s’installer à Paris (aux Tuileries).
L’Assemblée nationale
le suit → Paris redevient la capitale politique de la France avec un pouvoir désormais sous la surveillance
du peuple parisien.
Bilan : les 3 acteurs de l’année 1789
• Les députés élus du Tiers d'État, surtout des bourgeois, obtiennent monarchie constitutionnelle et la
DDCH.
Ils veulent bien du peuple pour faire pression sur le roi, mais pas que peuple mène la révolution.
• Le peuple (parisien, soldat et paysan) dont la violence inquiète les députés mais fait plier le roi
• Le roi qui s'oppose à toutes les réformes mais se retrouve finalement contraint de les accepter sous
la pression des députés et surtout du peuple.
B.
Fin 1789 – Printemps 1791 :....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Des chaînes de montagnes lointaines forment l'arrière-plan du tableau dont elles rehaussent l'intérêt. Arthur Young, Voyages en France pendant les années 1787, 1788, 1789, traduction de H. J. Lesage, ABU, la Bibliothèque universelle
- La Grande-Bretagne de 1815 à 1918 par François BédaridaInstitut d'Études Politiques, Paris En 1815, la Grande-Bretagne sort victorieuse de vingt années de lutte contrela France révolutionnaire et impériale.
- David Gascoynené en 1916Né à Harrow dans le Middlesex, il passa plusieurs années en France où il s'est installé etoù jadis il faisait partie du cercle surréaliste.
- Gilles-Gaston Grangerné en 1920Philosophe français, il enseigne de nombreuses années au Brésil avant de s'installer àAix-en-Provence et devenir professeur au Collège de France.
- NOSTRADAMUS, Michel de Notre-Dame, dit (14 décembre 1503-2 juillet 1566) Médecin, astrologue Après être devenu maître ès arts à Avignon en 1521, et avoir été reçu docteur par la faculté de médecine de Montpellier vers 1534, il passe des années à voyager, en France comme en Italie.