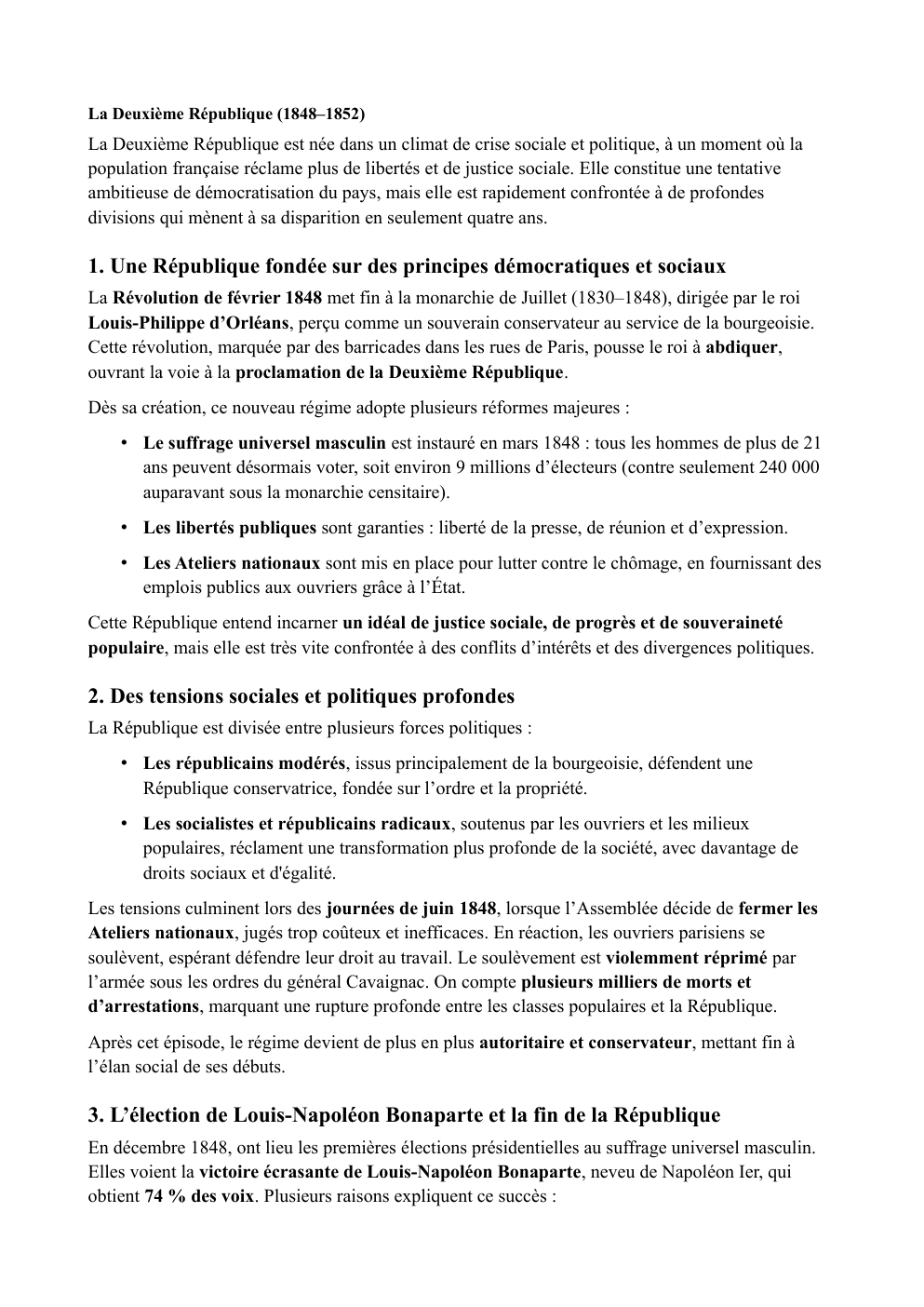La Deuxième République (1848–1852)
Publié le 13/05/2025
Extrait du document
«
La Deuxième République (1848–1852)
La Deuxième République est née dans un climat de crise sociale et politique, à un moment où la
population française réclame plus de libertés et de justice sociale.
Elle constitue une tentative
ambitieuse de démocratisation du pays, mais elle est rapidement confrontée à de profondes
divisions qui mènent à sa disparition en seulement quatre ans.
1.
Une République fondée sur des principes démocratiques et sociaux
La Révolution de février 1848 met fin à la monarchie de Juillet (1830–1848), dirigée par le roi
Louis-Philippe d’Orléans, perçu comme un souverain conservateur au service de la bourgeoisie.
Cette révolution, marquée par des barricades dans les rues de Paris, pousse le roi à abdiquer,
ouvrant la voie à la proclamation de la Deuxième République.
Dès sa création, ce nouveau régime adopte plusieurs réformes majeures :
• Le suffrage universel masculin est instauré en mars 1848 : tous les hommes de plus de 21
ans peuvent désormais voter, soit environ 9 millions d’électeurs (contre seulement 240 000
auparavant sous la monarchie censitaire).
• Les libertés publiques sont garanties : liberté de la presse, de réunion et d’expression.
• Les Ateliers nationaux sont mis en place pour lutter contre le chômage, en fournissant des
emplois publics aux ouvriers grâce à l’État.
Cette République entend incarner un idéal de justice sociale, de progrès et de souveraineté
populaire, mais elle est très vite confrontée à des conflits d’intérêts et des divergences politiques.
2.
Des tensions sociales et politiques profondes
La République est divisée entre plusieurs forces politiques :
• Les républicains modérés, issus principalement de la bourgeoisie, défendent une
République conservatrice, fondée sur l’ordre et la propriété.
• Les socialistes et républicains radicaux, soutenus par les ouvriers et les milieux
populaires, réclament une transformation plus profonde de la société, avec davantage de
droits sociaux et d'égalité.
Les tensions culminent lors des journées de juin 1848, lorsque l’Assemblée décide de fermer les
Ateliers nationaux, jugés trop coûteux et inefficaces.
En réaction, les ouvriers parisiens se
soulèvent, espérant défendre leur droit au travail.
Le soulèvement est violemment réprimé par
l’armée sous les ordres du général Cavaignac.
On compte plusieurs milliers de morts et
d’arrestations, marquant une rupture profonde entre les classes populaires et la République.
Après cet épisode, le régime devient de plus en plus autoritaire et conservateur, mettant fin à
l’élan social de ses débuts.
3.
L’élection de Louis-Napoléon Bonaparte et la fin de la République
En décembre 1848, ont lieu les premières élections présidentielles au suffrage universel masculin.
Elles voient la victoire écrasante de Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, qui
obtient 74 % des voix.
Plusieurs raisons expliquent ce succès :
• La popularité du nom Bonaparte, encore très ancrée dans les esprits.
• Un discours social rassurant pour les classes populaires.
• Le soutien massif des milieux ruraux et conservateurs, désireux de stabilité et d’ordre.
Mais Louis-Napoléon ne respecte pas l’esprit républicain : empêché par la Constitution de se
représenter en 1852, il organise un coup d’État le 2 décembre 1851, jour anniversaire de la
victoire d’Austerlitz de son oncle.
Il dissout l’Assemblée et concentre tous les pouvoirs.
Ce coup d’État est ratifié par plébiscite (vote du peuple), et en décembre 1852, il se proclame
empereur sous le nom de Napoléon III, mettant fin à la Deuxième République et inaugurant le
Second Empire.
Le Second Empire (1852–1870) : entre autoritarisme et modernisation
Proclamé après le coup d’État du 2 décembre 1851, le Second Empire marque le retour d’un
pouvoir impérial fort en France sous la direction de Napoléon III, neveu de Napoléon Ier.
Ce
régime, à la fois autoritaire et populaire, cherche à moderniser la France tout en contrôlant
fermement la vie politique.
Il connaît deux grandes phases : une phase autoritaire (1852–1860) et
une phase libérale (1860–1870).
1.
Un régime autoritaire et centralisé (1852–1860)
Dès son instauration, le Second Empire s’impose comme un régime de pouvoir personnel :
• Napoléon III détient l’ensemble des pouvoirs exécutifs et législatifs :
• Il nomme les ministres, qui ne sont pas responsables devant le Parlement.
• Il propose les lois, dirige l’armée, contrôle la diplomatie, et peut dissoudre le Corps
législatif.
• Les institutions sont organisées pour limiter la contestation :
• Le Sénat et le Conseil d’État sont nommés par l’Empereur.
• Le Corps législatif est élu, mais a très peu de pouvoir au début.
La répression est sévère :
• La presse est censurée, les caricatures interdites, et les publications contrôlées.
• Les opposants politiques (républicains, monarchistes, socialistes) sont arrêtés, exilés ou
réduits au silence.
• L’administration, notamment les préfets, joue un rôle essentiel dans le contrôle des
populations, notamment en province.
Pourtant, Napoléon III conserve une légitimité populaire grâce au suffrage universel masculin,
qu’il utilise pour organiser des plébiscites (référendums) renforçant son pouvoir :
• En 1851, le coup d’État est approuvé par plus de 90 % des votants.
• En 1852, le rétablissement de l’Empire est confirmé par un nouveau plébiscite.
2.
Une modernisation économique et sociale de la France
Malgré son autoritarisme, le Second Empire se distingue par une politique ambitieuse de
modernisation, qui transforme profondément la France :
a.
Une économie en plein essor
• Napoléon III favorise le développement industriel, notamment dans le textile, la
métallurgie, les chemins de fer, les banques.
• Il encourage la construction de grandes infrastructures : canaux, routes, ports, gares.
• La France signe des traités de libre-échange, comme avec l’Angleterre en 1860, ce qui
stimule le commerce.
• Paris est transformée par le baron Haussmann : percement de larges avenues, construction
d’égouts, d’espaces verts et de bâtiments modernes.
b.
Une certaine politique sociale
• Création des premières caisses d’épargne, développement de mutuelles et premières lois
sociales (comme l’encadrement du travail des enfants).
• Soutien au logement ouvrier et à l’amélioration de l’hygiène.
• Tentative de dialogue avec les milieux ouvriers, même si le régime reste méfiant envers les
syndicats et les grèves.
3.
L’évolution vers un Empire plus libéral (1860–1870)
Sous la pression croissante des oppositions politiques et de l’opinion publique, Napoléon III
commence à assouplir le régime :
a.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- NAPOLEON III, Louis Napoléon Bonaparte(20 avril 1808-9 janvier 1873)Président de la République (1848-1852)Empereur des Français (1852-1870)Fils du roi de Hollande, Louis Bonaparte, et d'Hortense de Beauharnais,il est le neveu de Napoléon Ier.
- Napoléon III Président de la République de 1848 à 1852 et empereur des Français de 1852à 1870, Napoléon III est le fils du roi de Hollande, Louis Bonaparte, etd'Hortense de Beauharnais - donc le neveu de Napoléon Ier.
- NAPOLEON III, Louis Napoléon Bonaparte (20 avril 1808-9 janvier 1873) Président de la République (1848-1852) Empereur des Français (1852-1870) Fils du roi de Hollande, Louis BonaparteF259D, et d'Hortense de BeauharnaisF217C, il est le neveu de Napoléon IerF227.
- Napoléon III devient le premier président de la République française en 1848
- L’ouvrage : Philippe VIGIER, 1848, les Français et la République, La vie quotidienne, Préface d'Alain Corbin, Paris, Hachette, 1998, 437 p.