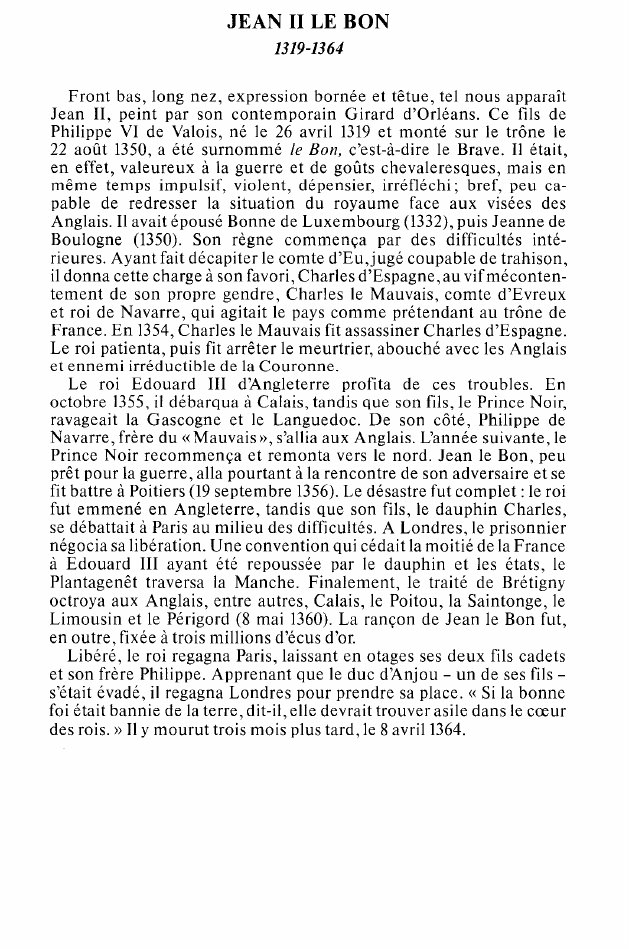JEAN II LE BON
Publié le 16/05/2020

Extrait du document
«
JEAN II LE BON
(Dit "le Bon", 1319-1364) Roi de France en 1350, fils de Philippe VI de Valois.Jean II est confronté dès le début de son règne à des difficultés financières et doit dévaluer la livre tournoi.
Il marie sa fille au roi deNavarre, Charles II le Mauvais.
Celui-ci assassine le connétable Charles d'Espagne, favori du roi.
Emprisonné, Charles le Mauvais serallie au roi d'Angleterre, privant Jean d'un précieux soutien.En 1355, pour répondre aux difficultés financières du royaume et à la reprise des hostilités contre les Anglais, il convoque les Etatsgénéraux.Il fut vaincu et fait prisonnier à Poitiers par le Prince Noir, fils d'Edouard III, en 1356.Son fils, le futur Charles V assura la régence pendant sa captivité à Londres et négocia le traité de Brétigny qui devait apporter la paixet la libération du roi.
Mais les finances du royaume ne permettant pas de payer la totalité de la rançon, Jean II retourna à Londres oùil mourut en 1364.
Front bas, long nez, expression bornée et têtue,-tel nous apparaît Jean II, peint par son contemporain Girard d'Orléans.
Ce fils dePhilippe VI de Valois, né le 26 avril 1319 et monté sur le trône le 22 août 1350, a été surnommé le Bon, c'est-à-dire le Brave.
Il était,en effet, valeureux à la guerre et de goûts chevaleresques, mais en même temps impulsif, violent, dépensier, irréfléchi ; bref, peucapable de redresser la situation du royaume face aux visées des Anglais.
Il avait épousé Bonne de Luxembourg (1332), puis Jeannede Boulogne (1350).
Son règne commença par des difficultés intérieures.
Ayant fait décapiter le comte d'Eu, jugé coupable de trahison,il donna cette charge à son favori, Charles d'Espagne, au vif mécontentement de son propre gendre, Charles le Mauvais, comted'Evreux et roi de Navarre, qui agitait le pays comme prétendant au trône de France.
En 1354, Charles le Mauvais fit assassinerCharles d'Espagne.
Le roi patienta, puis fit arrêter le meurtrier, abouché avec les Anglais et ennemi irréductible de la Couronne.Le roi Edouard III d'Angleterre profita de ces troubles.
En octobre 1355, il débarqua à Calais, tandis que son fils, le Prince Noir,ravageait la Gascogne et le Languedoc.
De son côté, Philippe de Navarre, frère du «Mauvais », s'allia aux Anglais.
L'année suivante, lePrince Noir recommença et remonta vers le nord.
Jean le Bon, peu prêt pour la guerre, alla pourtant à la rencontre de son adversaireet se fit battre à Poitiers (19 septembre 1356).
Le désastre fut complet : le roi fut emmené en Angleterre, tandis que son fils, ledauphin Charles, se débattait à Paris au milieu des difficultés.
A Londres, le prisonnier négocia sa libération.
Une convention qui cédaitla moitié de la France à Edouard III ayant été repoussée par le dauphin et les états, le Plantagenêt traversa la Manche.
Finalement, letraité de Brétigny octroya aux Anglais, entre autres, Calais, le Poitou, la Saintonge, le Limousin et le Périgord (8 mai 1360).
La rançonde Jean le Bon fut, en outre, fixée à trois millions d'écus d'or.Libéré, le roi regagna Paris, laissant en otages ses deux fils cadets et son frère Philippe.
Apprenant que le duc d'Anjou - un de ses fils -s'était évadé, il regagna Londres pour prendre sa place.
« Si la bonne foi était bannie de la terre, dit-il, elle devrait trouver asile dansle coeur des rois.
» Il y mourut trois mois plus tard, le 8 avril 1364.
Fils de Philippe VI et de Jeanne de Bourgogne, Jean porte le titre de duc de Normandie jusqu'au 26 septembre 1350, jour où il estsacré roi de France à Reims.
L'exécution du connétable Raoul de Brienne, remplacé par Charles d'Espagne, marque le début de sonrègne.
C'est ce connétable que Jean II a mis en place que Charles le Mauvais, roi de Navarre et gendre du roi de France (dont il aépousé la fille Jeanne), assassine.
Le même Charles de Navarre s'allie à l'Angleterre.
Edouard III fait une campagne en Artois.
Le ducde Lancastre se porte au secours de Jean de Montfort en Bretagne.
Le Prince Noir ravage le Languedoc.
Jean II doit faire face.
Laguerre coûte plus cher que les fêtes fastueuses qu'il a données pour la création de l'ordre de l'Etoile.
Les Etats généraux des Etats delangue d'oïl accordent au roi, par une ordonnance du 28 décembre 1355, les subsides qu'il demande.
Le 26 mars 1356, les Etats delangue d'oc font de même.
Mais Charles de Navarre attise la résistance à payer les impôts nouveaux, accordés au roi par les Etatsgénéraux.
Le 5 avril 1356, le roi le fait arrêter à Rouen et emprisonner.
Cette arrestation provoque la colère des frères du roi deNavarre qui appellent les Anglais à la rescousse en Normandie.
Les troupes du Prince Noir parviennent jusqu'à la Loire.
Le roi deFrance les affronte à Poitiers, le 19 septembre 1356.
Il est fait prisonnier et emmené à Londres.
Il ne doit qu'à la signature du traité deBrétigny, le 24 octobre 1360, d'être libéré.
Pendant les quatre ans qui se sont écoulés, c'est le Dauphin Charles qui assume la régencedu royaume.
Il doit tenir tête à Etienne Marcel et à Charles le Mauvais que celui-ci a fait libérer ; il doit faire face aux jacqueries.
Letraité qui permet la libération du roi implique le paiement d'une rançon de 3 millions d'écus d'or et que les trois fils du roi soient remisen otage.
(La monnaie d'or frappée pour que le roi soit libéré, est donc « franc » c'est-à-dire libre ; elle gardera longtemps son nom.)A son retour en France, Jean II revient dans un royaume que ravagent la peste, la famine et les exactions des « routiers ».
Le ducd'Anjou, l'un des trois fils de Jean, otage en Angleterre, s'évade.
Le roi estime conforme à l'honneur qui est le sien de reprendre saplace de prisonnier : il se livre à Edouard III en janvier 1364.
C'est prisonnier qu'il meurt, quelques mois plus tard.
A cette époque vivait :
CHAVENGES, Jean Gaulart de (? -?)
Clerc du diocèse de Troyes, conseiller au Parlement, il compose, entre 1345 et 1348, un poème qui doit comprendre environ 4 850vers, intitulé Le Livre Royal ou Le Livre des Prophéties de Notre Dame .
D'une série d'emprunts à l'Ecriture sainte, à Virgile et à Ovide, l'auteur prétend tirer un enseignement moral.
Il multiplie les digressions dont la plupart ont trait à l'histoire de France depuis lesorigines fabuleuses jusqu'aux événements de 1344..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Préparation à l’oral du baccalauréat de français Analyse linéaire n°4 - Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, 1990 (épilogue)
- [Ne pas prendre pour naturelles des inégalités sociales] Jean-Jacques ROUSSEAU
- Le Secret du monde Jean Kepler
- Sven Ortoli et Jean-Pierre Pharabod : Cantique des quantiques (résumé et analyse)
- Jean-Pierre Luminet: L'Univers chiffonné