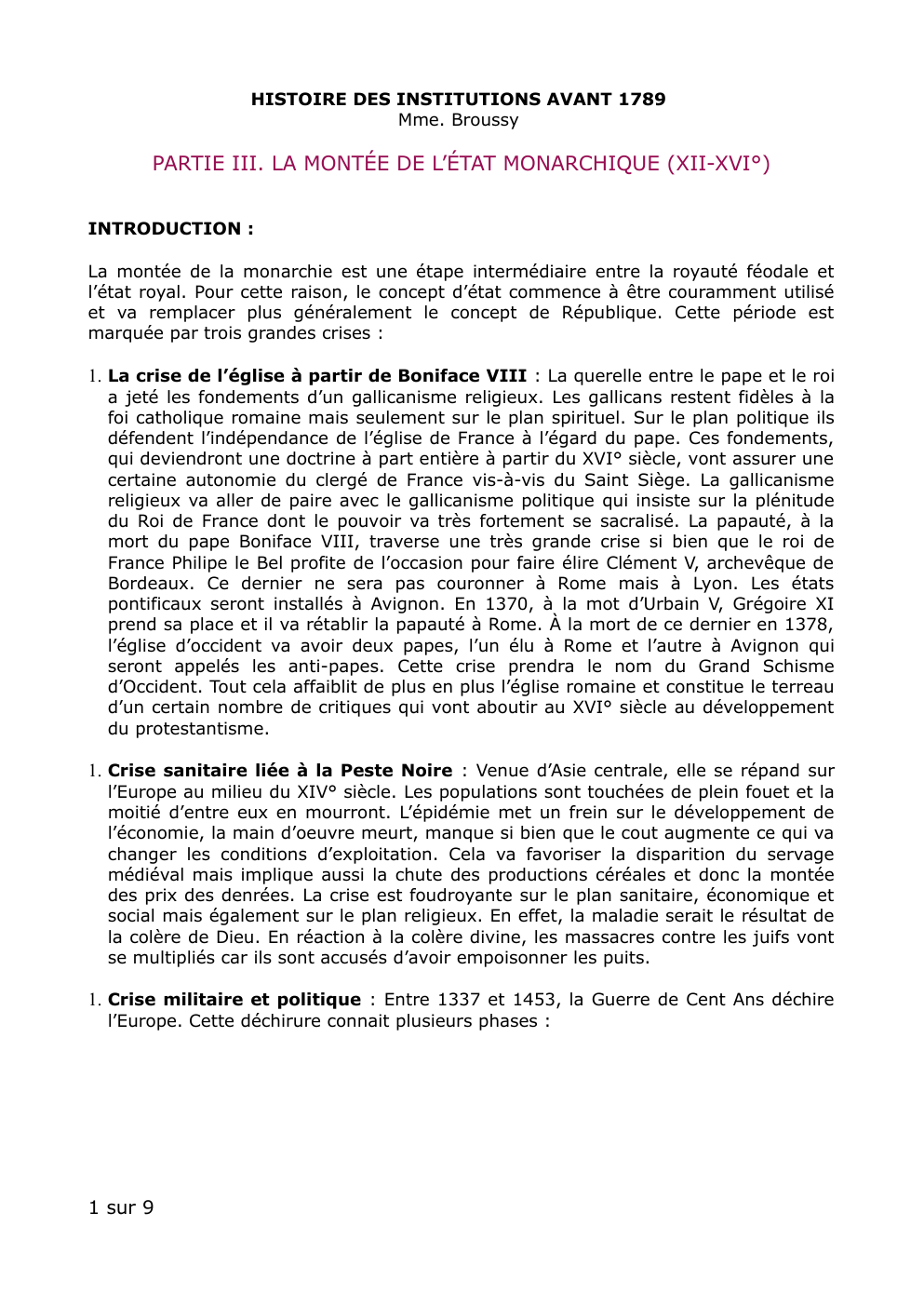HISTOIRE DES INSTITUTIONS AVANT 1789 PARTIE III. LA MONTÉE DE L’ÉTAT MONARCHIQUE (XII-XVI°)
Publié le 04/10/2025
Extrait du document
«
HISTOIRE DES INSTITUTIONS AVANT 1789
PARTIE III.
LA MONTÉE DE L’ÉTAT MONARCHIQUE (XII-XVI°)
INTRODUCTION :
La montée de la monarchie est une étape intermédiaire entre la royauté féodale et
l’état royal.
Pour cette raison, le concept d’état commence à être couramment utilisé
et va remplacer plus généralement le concept de République.
Cette période est
marquée par trois grandes crises :
1.
La crise de l’église à partir de Boniface VIII : La querelle entre le pape et le roi
a jeté les fondements d’un gallicanisme religieux.
Les gallicans restent fidèles à la
foi catholique romaine mais seulement sur le plan spirituel.
Sur le plan politique ils
défendent l’indépendance de l’église de France à l’égard du pape.
Ces fondements,
qui deviendront une doctrine à part entière à partir du XVI° siècle, vont assurer une
certaine autonomie du clergé de France vis-à-vis du Saint Siège.
La gallicanisme
religieux va aller de paire avec le gallicanisme politique qui insiste sur la plénitude
du Roi de France dont le pouvoir va très fortement se sacralisé.
La papauté, à la
mort du pape Boniface VIII, traverse une très grande crise si bien que le roi de
France Philipe le Bel profite de l’occasion pour faire élire Clément V, archevêque de
Bordeaux.
Ce dernier ne sera pas couronner à Rome mais à Lyon.
Les états
pontificaux seront installés à Avignon.
En 1370, à la mot d’Urbain V, Grégoire XI
prend sa place et il va rétablir la papauté à Rome.
À la mort de ce dernier en 1378,
l’église d’occident va avoir deux papes, l’un élu à Rome et l’autre à Avignon qui
seront appelés les anti-papes.
Cette crise prendra le nom du Grand Schisme
d’Occident.
Tout cela affaiblit de plus en plus l’église romaine et constitue le terreau
d’un certain nombre de critiques qui vont aboutir au XVI° siècle au développement
du protestantisme.
1.
Crise sanitaire liée à la Peste Noire : Venue d’Asie centrale, elle se répand sur
l’Europe au milieu du XIV° siècle.
Les populations sont touchées de plein fouet et la
moitié d’entre eux en mourront.
L’épidémie met un frein sur le développement de
l’économie, la main d’oeuvre meurt, manque si bien que le cout augmente ce qui va
changer les conditions d’exploitation.
Cela va favoriser la disparition du servage
médiéval mais implique aussi la chute des productions céréales et donc la montée
des prix des denrées.
La crise est foudroyante sur le plan sanitaire, économique et
social mais également sur le plan religieux.
En effet, la maladie serait le résultat de
la colère de Dieu.
En réaction à la colère divine, les massacres contre les juifs vont
se multipliés car ils sont accusés d’avoir empoisonner les puits.
1.
Crise militaire et politique : Entre 1337 et 1453, la Guerre de Cent Ans déchire
l’Europe.
Cette déchirure connait plusieurs phases :
1 sur 9
- Phase de défaite des français : Une défaite à Poitiers en 1356 par laquelle le roi
Jean II est fait prisonnier par les anglais.
Les états généraux, menés par Étienne
Marcel, se révoltent et entendent imposer une monarchie parlementaire à Paris.
Jean le Bon parvient à rentrer en France en 1360 et il récupère le royaume.
- Phase de victoire des français : Charles VI déshérite son fils en 1420 au profit
du roi d’Angleterre, Henry V.
Les deux meurent rapidement et le fils du roi récupère
son pouvoir.
Charles VI profite d’une noblesse qui soutient le roi et de Jeanne d’Arc
pour être victorieux face aux anglais.
La victoire de Castillon en 1453 marque la
défaite des anglais et l’affirmation d’un sentiment national français
CHAPITRE I.
LE ROI ET L’ÉTAT MONARCHIQUE :
Section 1.
Le statut de l’état monarchique :
§1.
La dévolution de la couronne :
A.Un dévolution spécifique :
Au XIV° siècle, les règles de dévolution doivent êtres précisées et ce dans deux sens :
la transmission héréditaire et la catholicité qui va être hissée au rang des lois
fondamentales du royaume.
1/ La transmission héréditaire précisée :
A.La primogéniture précisée :
C’est le premier né qui hérite de la couronne suivant l’ordre des naissances.
Si l’ainé
qui hérite de la couronne est encore mineur, une régence est mise en place.
Depuis
Saint Louis, la régence est confiée à la Reine Mère.
À Partir de 1374, une règle va avoir tendance à se dégager.
En effet, le roi va laisser
l’administration du royaume à un collatéral.
Le roi Charles V laisse cette administration
à son frère, le Duc d’Anjou.
En revanche, il laisse la garde de ses enfants à la reine
mère qui ne doit pas se remarier.
On trouve ici une précaution empruntée au droit
féodal.
En effet, on distingue les biens et les enfants qui ne doivent pas revenir à la
même personne pour éviter les tentations de faire disparaitre les enfants et
s’approprier les biens.
Seul l’ainé reçoit la couronne.
S’il meurt, on suit l’ordre des naissances.
Celui signifie
que les cadets peuvent êtres tenté de contester l’élection de la couronne.
Pour cette
raison et pour les en empêcher, les cadets reçoivent des terres prélevées sur le
domaine royale, des apanages.
Cependant, dans cette pratique subsiste le risque de
voir renaître une féodalité.
A.La primogéniture mâle précisée : l’exclusion des femmes :
2 sur 9
Ce principe n’avait pas eu à être précisé avant le XIV° siècle car tous les rois avaient
des aînés masculins, cela va se préciser à partir du règne de Philippe le Bel.
La
légende raconte que lorsqu’il condamne au buché Jacques de Molay, en 1314, ce
dernier avant de mourir aurait maudit le roi lui-même et toute sa
descendance.
Cette légende expliquerait la mort du roi quelques mois plus tard et
surtout la malédiction qui pèse sur les trois fils du Roi, qui vont régner tour à tour
successivement parce qu’aucun n’aura d’héritier mâle pour lui succéder.
Et la difficulté
est telle que la couronne finira même par passer en 1358 à une branche cousine, les
Valois.
L’exclusion des femmes :
Jusqu’au règne de Philippe le Bel chacun des rois avait un fils pour lui succéder, le
« miracle capétien ».
Le dernier en date est Philippe IV le Bel avec son fils Louis X dit
« le Lutin » (le querelleur).
En 1316 Louis X meurt, à sa mort il laisse une fille,
Jeanne, mais aussi la Reine enceinte, si bien qu’à titre provisoire on organise la
régence du royaume accordée à Philippe V le Long.
Et quelques semaines plus tard né
Jean 1er le Posthume et meurt quelques jours après sa naissance et le
problème se pose de savoir à qui doit revenir la couronne.
Peut-elle revenir à
Jeanne, en ligne directe, ou doit-elle revenir nécessairement à un homme, en ligne
collatérale ? C’est Philippe qui deviendra Philippe V, sacré en 1377 et roi en 1316, et
on obtient le principe selon lequel « femme ne succède point à la couronne de
France ».
Cette solution est contestable sur le plan juridique pour plusieurs raisons :
- En droit privé des successions l’héritage revient en premier lieu au descendant le
plus proche en degré.
- En matière de fief, en l’absence de fils une fille pouvait hériter d’un fief (qu’elle se
marie ou qu’elle soit déjà mariée).
- Les femmes peuvent êtres régentes.
- Dans d’autres royaumes, les femmes pouvaient régner.
C’est une raison d’opportunité qui conduit à écarter la princesse Jeanne, notamment
la crainte qu’en se mariant elle ne fasse passer la couronne entre les mains d’une
famille étrangère.
Et il y a surtout la crainte que sous le règne d’une femme se
perpétue les nombreux troubles survenus sous le règne de son père, troubles qui lui
valent le surnom de « Lutin », pour ces raisons la couronne passe à Philippe V le Long.
Charles IV le Bel prend la succession de la couronne à la mort de Philippe V, la
transmission du pouvoir royale se distingue petit à petit de l’hérédité et va commencer
à obéir à ses propres règles.
Il reste l’idée à préciser de savoir dans qu’elle mesure on
va exclure les femmes.
Est-ce que les filles ne pourraient pas faire accéder leurs
descendants mâles au trône même en y étant exclues ?
3 sur 9
L’exclusion des descendants mâles par les femmes :
Un des successeurs est Edouard II descendant au 3ème degré de Philippe IV le
Bel, le deuxième candidat est un cousin du Roi défunt, Philippe de Valois, parent
au 4ème degré.
Deux arguments sont en faveur d’Edouard II :
- C’est un des parent en plus proche degré.
- On a pensé que même si les femmes ne pouvaient accéder à la couronne elles
pouvaient faire « pont et planche » en faveur de leur fils.
En faveur de Philippe de Valois on faisait valoir un principe juridique selon lesquelles
les femmes ne savaient transmettre plus de droits qu’elles n’en avaient.
Une
Assemblée composée de hauts dignitaires du royaume se réunit et décide d’écarter
Edouard III d’Angleterre, les raisons sont d’opportunités plus que....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Histoire (Partie 1) La Révolution Française - Partie I 1774/17891774 : avènement de Louis 16I) L'influence des révolutions d'atlantiques.
- Cours: Histoire des institutions politiques
- LE CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN Étude film documentaire « Palestine, Histoire d’une terre »(1993) de Simone Bitton, Première Partie (1880-1950)
- Lecture linéaire n°2: Deuxième partie p 160, l.1401 à 1435 «Histoire du Vidame de Chartres»
- Les caisses sont autorisées à souscrire à son capital jusqu'à concurrence du quart de leurs avoirs propres respectifs. Pierre Poulin, Histoire du Mouvement Desjardins, tome III, Québec Amérique