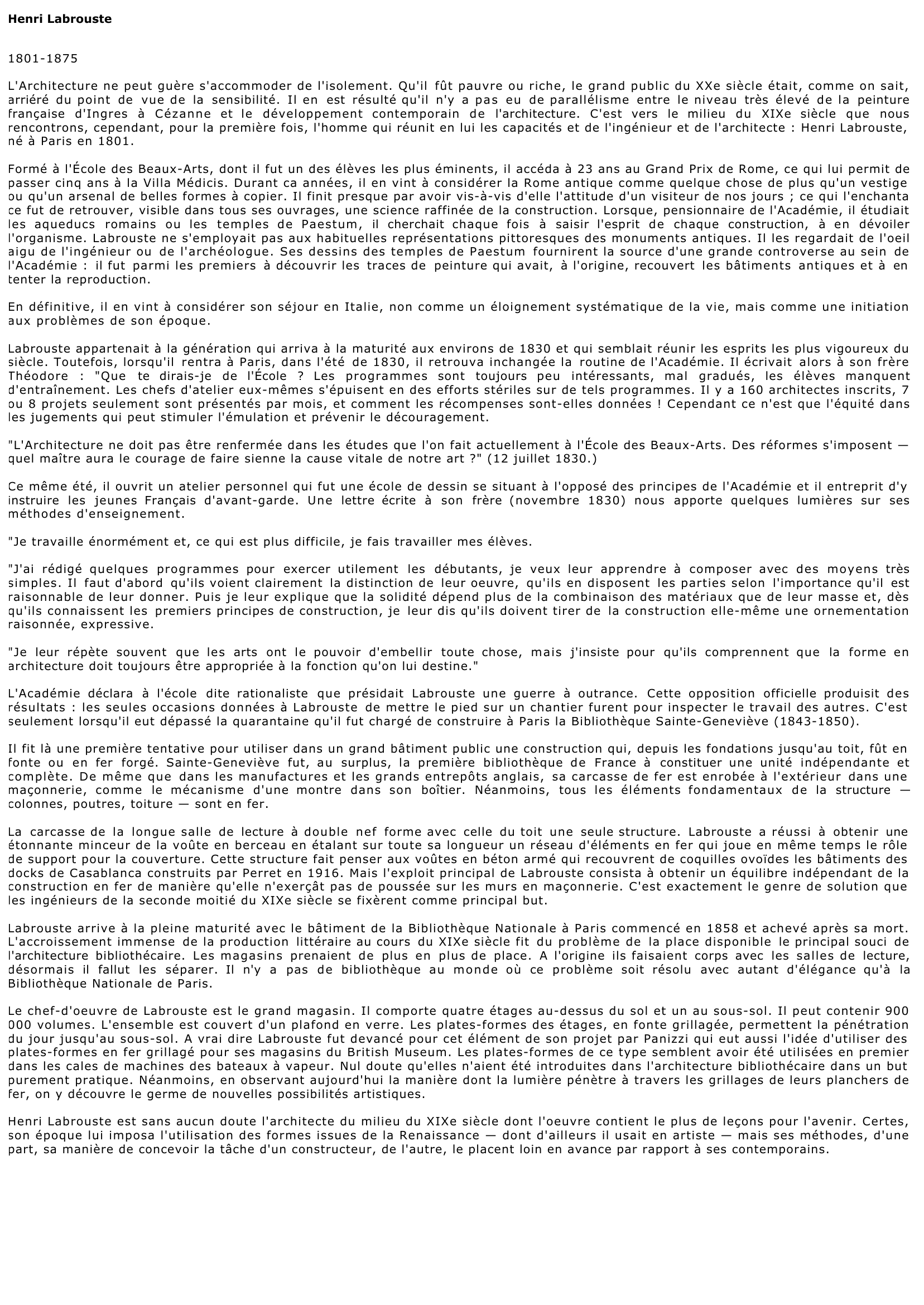Henri Labrouste
Publié le 16/05/2020

Extrait du document
«
Henri Labrouste
1801-1875
L'Architecture ne peut guère s'accommoder de l'isolement.
Qu'il fût pauvre ou riche, le grand public du XXe siècle était, comme on sait,arriéré du point de vue de la sensibilité.
Il en est résulté qu'il n'y a pas eu de parallélisme entre le niveau très élevé de la peinturefrançaise d'Ingres à Cézanne et le développement contemporain de l'architecture.
C'est vers le milieu du XIXe siècle que nousrencontrons, cependant, pour la première fois, l'homme qui réunit en lui les capacités et de l'ingénieur et de l'architecte : Henri Labrouste,né à Paris en 1801.
Formé à l'École des Beaux-Arts, dont il fut un des élèves les plus éminents, il accéda à 23 ans au Grand Prix de Rome, ce qui lui permit depasser cinq ans à la Villa Médicis.
Durant ca années, il en vint à considérer la Rome antique comme quelque chose de plus qu'un vestigeou qu'un arsenal de belles formes à copier.
Il finit presque par avoir vis-à-vis d'elle l'attitude d'un visiteur de nos jours ; ce qui l'enchantace fut de retrouver, visible dans tous ses ouvrages, une science raffinée de la construction.
Lorsque, pensionnaire de l'Académie, il étudiaitles aqueducs romains ou les temples de Paestum, il cherchait chaque fois à saisir l'esprit de chaque construction, à en dévoilerl'organisme.
Labrouste ne s'employait pas aux habituelles représentations pittoresques des monuments antiques.
Il les regardait de l'oeilaigu de l'ingénieur ou de l'archéologue.
Ses dessins des temples de Paestum fournirent la source d'une grande controverse au sein del'Académie : il fut parmi les premiers à découvrir les traces de peinture qui avait, à l'origine, recouvert les bâtiments antiques et à ententer la reproduction.
En définitive, il en vint à considérer son séjour en Italie, non comme un éloignement systématique de la vie, mais comme une initiationaux problèmes de son époque.
Labrouste appartenait à la génération qui arriva à la maturité aux environs de 1830 et qui semblait réunir les esprits les plus vigoureux dusiècle.
Toutefois, lorsqu'il rentra à Paris, dans l'été de 1830, il retrouva inchangée la routine de l'Académie.
Il écrivait alors à son frèreThéodore : "Que te dirais-je de l'École ? Les programmes sont toujours peu intéressants, mal gradués, les élèves manquentd'entraînement.
Les chefs d'atelier eux-mêmes s'épuisent en des efforts stériles sur de tels programmes.
Il y a 160 architectes inscrits, 7ou 8 projets seulement sont présentés par mois, et comment les récompenses sont-elles données ! Cependant ce n'est que l'équité dansles jugements qui peut stimuler l'émulation et prévenir le découragement.
"L'Architecture ne doit pas être renfermée dans les études que l'on fait actuellement à l'École des Beaux-Arts.
Des réformes s'imposent —quel maître aura le courage de faire sienne la cause vitale de notre art ?" (12 juillet 1830.)
Ce même été, il ouvrit un atelier personnel qui fut une école de dessin se situant à l'opposé des principes de l'Académie et il entreprit d'yinstruire les jeunes Français d'avant-garde.
Une lettre écrite à son frère (novembre 1830) nous apporte quelques lumières sur sesméthodes d'enseignement.
"Je travaille énormément et, ce qui est plus difficile, je fais travailler mes élèves.
"J'ai rédigé quelques programmes pour exercer utilement les débutants, je veux leur apprendre à composer avec des moyens trèssimples.
Il faut d'abord qu'ils voient clairement la distinction de leur oeuvre, qu'ils en disposent les parties selon l'importance qu'il estraisonnable de leur donner.
Puis je leur explique que la solidité dépend plus de la combinaison des matériaux que de leur masse et, dèsqu'ils connaissent les premiers principes de construction, je leur dis qu'ils doivent tirer de la construction elle-même une ornementationraisonnée, expressive.
"Je leur répète souvent que les arts ont le pouvoir d'embellir toute chose, mais j'insiste pour qu'ils comprennent que la forme enarchitecture doit toujours être appropriée à la fonction qu'on lui destine."
L'Académie déclara à l'école dite rationaliste que présidait Labrouste une guerre à outrance.
Cette opposition officielle produisit desrésultats : les seules occasions données à Labrouste de mettre le pied sur un chantier furent pour inspecter le travail des autres.
C'estseulement lorsqu'il eut dépassé la quarantaine qu'il fut chargé de construire à Paris la Bibliothèque Sainte-Geneviève (1843-1850).
Il fit là une première tentative pour utiliser dans un grand bâtiment public une construction qui, depuis les fondations jusqu'au toit, fût enfonte ou en fer forgé.
Sainte-Geneviève fut, au surplus, la première bibliothèque de France à constituer une unité indépendante etcomplète.
De même que dans les manufactures et les grands entrepôts anglais, sa carcasse de fer est enrobée à l'extérieur dans unemaçonnerie, comme le mécanisme d'une montre dans son boîtier.
Néanmoins, tous les éléments fondamentaux de la structure —colonnes, poutres, toiture — sont en fer.
La carcasse de la longue salle de lecture à double nef forme avec celle du toit une seule structure.
Labrouste a réussi à obtenir uneétonnante minceur de la voûte en berceau en étalant sur toute sa longueur un réseau d'éléments en fer qui joue en même temps le rôlede support pour la couverture.
Cette structure fait penser aux voûtes en béton armé qui recouvrent de coquilles ovoïdes les bâtiments desdocks de Casablanca construits par Perret en 1916.
Mais l'exploit principal de Labrouste consista à obtenir un équilibre indépendant de laconstruction en fer de manière qu'elle n'exerçât pas de poussée sur les murs en maçonnerie.
C'est exactement le genre de solution queles ingénieurs de la seconde moitié du XIXe siècle se fixèrent comme principal but.
Labrouste arrive à la pleine maturité avec le bâtiment de la Bibliothèque Nationale à Paris commencé en 1858 et achevé après sa mort.L'accroissement immense de la production littéraire au cours du XIXe siècle fit du problème de la place disponible le principal souci del'architecture bibliothécaire.
Les magasins prenaient de plus en plus de place.
A l'origine ils faisaient corps avec les salles de lecture,désormais il fallut les séparer.
Il n'y a pas de bibliothèque au monde où ce problème soit résolu avec autant d'élégance qu'à laBibliothèque Nationale de Paris.
Le chef-d'oeuvre de Labrouste est le grand magasin.
Il comporte quatre étages au-dessus du sol et un au sous-sol.
Il peut contenir 900000 volumes.
L'ensemble est couvert d'un plafond en verre.
Les plates-formes des étages, en fonte grillagée, permettent la pénétrationdu jour jusqu'au sous-sol.
A vrai dire Labrouste fut devancé pour cet élément de son projet par Panizzi qui eut aussi l'idée d'utiliser desplates-formes en fer grillagé pour ses magasins du British Museum.
Les plates-formes de ce type semblent avoir été utilisées en premierdans les cales de machines des bateaux à vapeur.
Nul doute qu'elles n'aient été introduites dans l'architecture bibliothécaire dans un butpurement pratique.
Néanmoins, en observant aujourd'hui la manière dont la lumière pénètre à travers les grillages de leurs planchers defer, on y découvre le germe de nouvelles possibilités artistiques.
Henri Labrouste est sans aucun doute l'architecte du milieu du XIXe siècle dont l'oeuvre contient le plus de leçons pour l'avenir.
Certes,son époque lui imposa l'utilisation des formes issues de la Renaissance — dont d'ailleurs il usait en artiste — mais ses méthodes, d'unepart, sa manière de concevoir la tâche d'un constructeur, de l'autre, le placent loin en avance par rapport à ses contemporains..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Etude de texte Henri Poincaré
- Questionnaire sur Emile Zola par Henri Guillemin
- Aliocha Henri Troyat 1991 (XXème siècle)
- « Un texte dramatique est un texte littéraire conçu en vue d'être représenté : sa nature est double ; il n'existe pas sans un style, appréciable à la lecture, et pourtant ses valeurs propres ne peuvent pleinement jaillir que par le jeu du théâtre, par la représentation. » Commentez cette affirmation de Pierre-Henri Simon.
- HENRI-GEORGES CLOUZOT