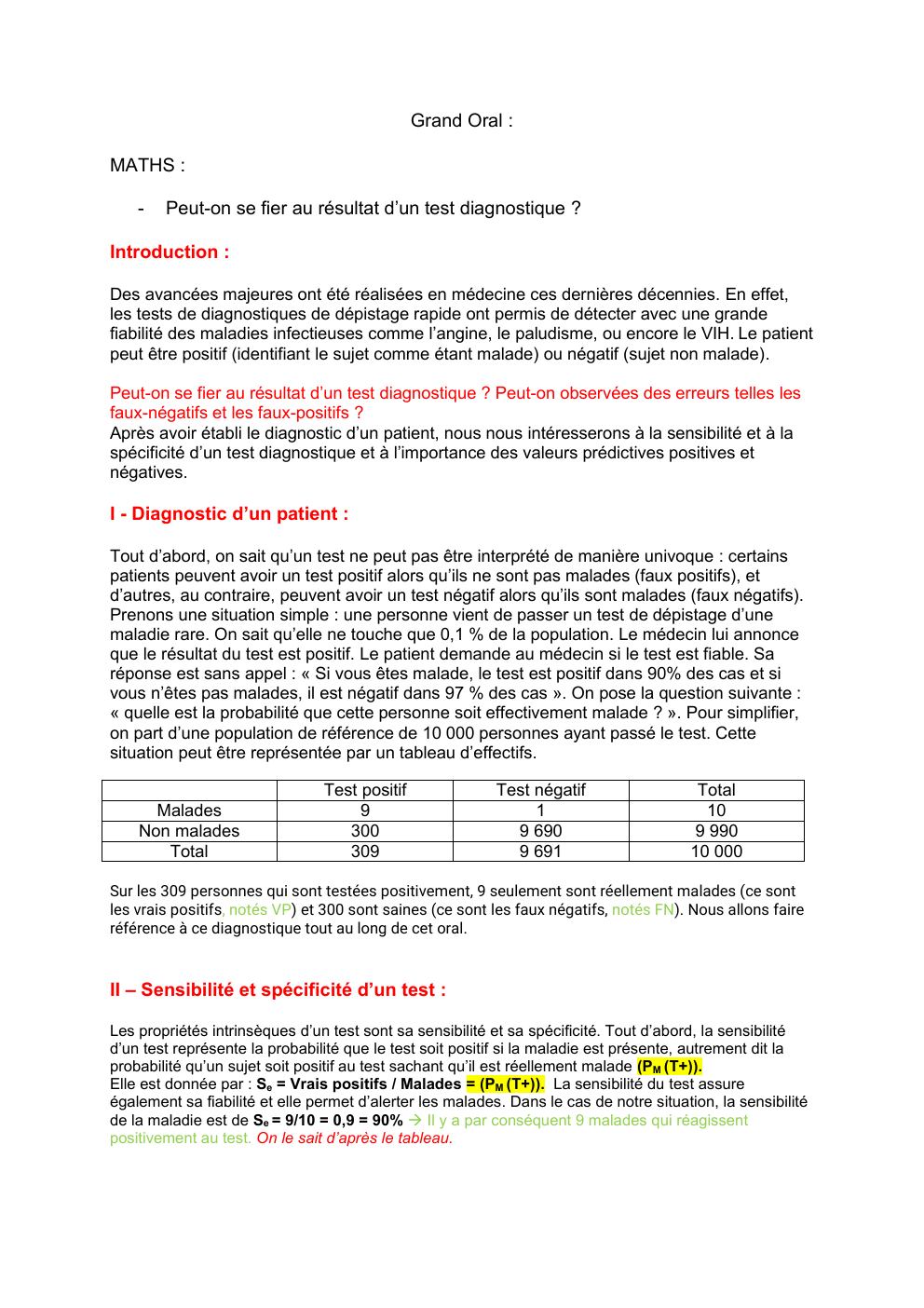Grand oral Math Logarithme
Publié le 27/05/2025
Extrait du document
«
Grand Oral :
MATHS :
-
Peut-on se fier au résultat d’un test diagnostique ?
Introduction :
Des avancées majeures ont été réalisées en médecine ces dernières décennies.
En effet,
les tests de diagnostiques de dépistage rapide ont permis de détecter avec une grande
fiabilité des maladies infectieuses comme l’angine, le paludisme, ou encore le VIH.
Le patient
peut être positif (identifiant le sujet comme étant malade) ou négatif (sujet non malade).
Peut-on se fier au résultat d’un test diagnostique ? Peut-on observées des erreurs telles les
faux-négatifs et les faux-positifs ?
Après avoir établi le diagnostic d’un patient, nous nous intéresserons à la sensibilité et à la
spécificité d’un test diagnostique et à l’importance des valeurs prédictives positives et
négatives.
I - Diagnostic d’un patient :
Tout d’abord, on sait qu’un test ne peut pas être interprété de manière univoque : certains
patients peuvent avoir un test positif alors qu’ils ne sont pas malades (faux positifs), et
d’autres, au contraire, peuvent avoir un test négatif alors qu’ils sont malades (faux négatifs).
Prenons une situation simple : une personne vient de passer un test de dépistage d’une
maladie rare.
On sait qu’elle ne touche que 0,1 % de la population.
Le médecin lui annonce
que le résultat du test est positif.
Le patient demande au médecin si le test est fiable.
Sa
réponse est sans appel : « Si vous êtes malade, le test est positif dans 90% des cas et si
vous n’êtes pas malades, il est négatif dans 97 % des cas ».
On pose la question suivante :
« quelle est la probabilité que cette personne soit effectivement malade ? ».
Pour simplifier,
on part d’une population de référence de 10 000 personnes ayant passé le test.
Cette
situation peut être représentée par un tableau d’effectifs.
Malades
Non malades
Total
Test positif
9
300
309
Test négatif
1
9 690
9 691
Total
10
9 990
10 000
Sur les 309 personnes qui sont testées positivement, 9 seulement sont réellement malades (ce sont
les vrais positifs, notés VP) et 300 sont saines (ce sont les faux négatifs, notés FN).
Nous allons faire
référence à ce diagnostique tout au long de cet oral.
II – Sensibilité et spécificité d’un test :
Les propriétés intrinsèques d’un test sont sa sensibilité et sa spécificité.
Tout d’abord, la sensibilité
d’un test représente la probabilité que le test soit positif si la maladie est présente, autrement dit la
probabilité qu’un sujet soit positif au test sachant qu’il est réellement malade (PM (T+)).
Elle est donnée par : Se = Vrais positifs / Malades = (PM (T+)).
La sensibilité du test assure
également sa fiabilité et elle permet d’alerter les malades.
Dans le cas de notre situation, la sensibilité
de la maladie est de Se = 9/10 = 0,9 = 90% → Il y a par conséquent 9 malades qui réagissent
positivement au test.
On le sait d’après le tableau.
Puis, la spécificité d’un test représente la probabilité que le test soit négatif si la maladie n’est pas
présente, autrement dit la probabilité qu’un sujet soit négatif au test sachant qu’il est réellement non
malade (PM « barre » (T-)).
Elle est donnée par : Sp = Vrais négatifs /Non Malades = (PM « barre » (T-)).
De plus, elle représente la
capacité d’un test à ne pas alerter faussement les non-malades.
Si nous reprenons notre situation, la spécificité
du test de la maladie rare est de Sp = 9 690/9 990 = 0,969 = 97 % → Il y a 9 690 test négatif chez une personnes
saines, et donc 300 tests positifs chez ces 9 990 personnes saines.
Ces deux caractéristiques sont calculées....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Sujet de Math Grand Oral
- grand oral math: un singe dactylographe
- grand oral ses/math: UN ÉCONOMISTE EST-IL UN STATISTICIEN MALGRÉ LUI ?
- Grand Oral Math Question : Comment les maths peuvent – elle nous aider à modéliser l’évolution d’une population ?
- Grand oral svt math: Est-il si difficile de trouver la compatibilité entre donneur et receveur?