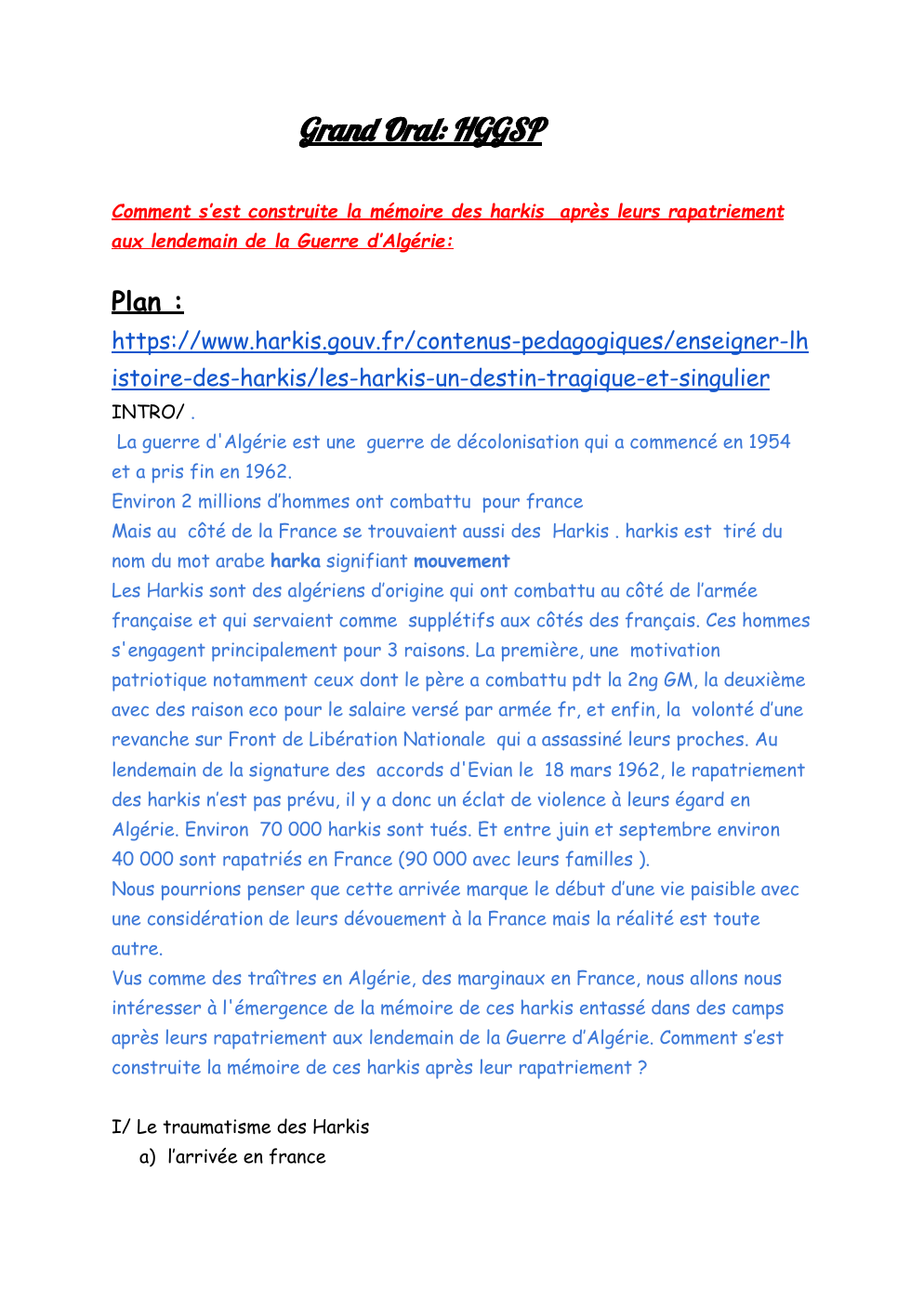Grand Oral: HGGSP Comment s’est construite la mémoire des harkis après leurs rapatriement aux lendemain de la Guerre d’Algérie:
Publié le 14/04/2025
Extrait du document
«
Grand Oral: HGGSP
Comment s’est construite la mémoire des harkis après leurs rapatriement
aux lendemain de la Guerre d’Algérie:
Plan :
https://www.harkis.gouv.fr/contenus-pedagogiques/enseigner-lh
istoire-des-harkis/les-harkis-un-destin-tragique-et-singulier
INTRO/ .
La guerre d'Algérie est une guerre de décolonisation qui a commencé en 1954
et a pris fin en 1962.
Environ 2 millions d’hommes ont combattu pour france
Mais au côté de la France se trouvaient aussi des Harkis .
harkis est tiré du
nom du mot arabe harka signifiant mouvement
Les Harkis sont des algériens d’origine qui ont combattu au côté de l’armée
française et qui servaient comme supplétifs aux côtés des français.
Ces hommes
s'engagent principalement pour 3 raisons.
La première, une motivation
patriotique notamment ceux dont le père a combattu pdt la 2ng GM, la deuxième
avec des raison eco pour le salaire versé par armée fr, et enfin, la volonté d’une
revanche sur Front de Libération Nationale qui a assassiné leurs proches.
Au
lendemain de la signature des accords d'Evian le 18 mars 1962, le rapatriement
des harkis n’est pas prévu, il y a donc un éclat de violence à leurs égard en
Algérie.
Environ 70 000 harkis sont tués.
Et entre juin et septembre environ
40 000 sont rapatriés en France (90 000 avec leurs familles ).
Nous pourrions penser que cette arrivée marque le début d’une vie paisible avec
une considération de leurs dévouement à la France mais la réalité est toute
autre.
Vus comme des traîtres en Algérie, des marginaux en France, nous allons nous
intéresser à l'émergence de la mémoire de ces harkis entassé dans des camps
après leurs rapatriement aux lendemain de la Guerre d’Algérie.
Comment s’est
construite la mémoire de ces harkis après leur rapatriement ?
I/ Le traumatisme des Harkis
a) l’arrivée en france
Les Harkis ne se sentent pas en sécurité en Algérie, des menaces de morts
pèsent sur leurs familles.
La majorité des Harkis restent en Algérie tandis que
d’autres supplétifs qui ne sont pas parvenus à se faire connaître par les
autorités administratives embarquent clandestinement pour la France.
Ils
partent alors subitement de l’Algérie.
Ils laissent derrière eux la majorité de
leurs biens.
Ils quittent l’Algérie par bateau pour arriver au port de Marseille.
Le voyage est difficile, le traumatisme des harkis commence souvent dès le
voyage.
Ils voyagent sur des cargos dédiés au transport de marchandises.
Les
familles s’entassent dans les cales, sans pouvoir boire et manger.
Une fois arrivé
au port de Marseille les familles sont conduitent par camions dans les camps de
transit et d’hébergement
La majorité des Harkis restent en Algérie tandis que d’autres supplétifs qui ne
sont pas parvenus à se faire connaître par les autorités administratives
embarquent clandestinement pour la France avec ou sans l’aide de leurs
officiers.
b) les conditions de vie dans les camps
(la honte d'être un Harkis)
L’administration ouvre progressivement, sur le territoire métropolitain, six
camps de transit et d’hébergement le camps du Larzac dans l’aveyron , le
camps de Bias dans le lot et garonne,le camps de La Rye dans la commune
de Vienne,le camp de Rivesaltes dans les Pyrénées Orientales,le camps de
Saint-Maurice-L’Ardoise dans le Gard et le camps de Bourg-Lastic dans le
puy de Dôme ou les harkis sont répartis avec des conditions de vie très
difficile.
Les familles vivent dans des baraquements ou des tentes très mal
isolés sans accès à l’eau.
Les douches et toilettes étaient collectives et situées à
l'extérieur.
Les habitants avaient le droit à une douche par semaine au maximum,
les gérants du camp pouvaient décider de manière arbitraire de ne pas laisser
l’accès aux douches.
Les conditions sanitaires étaient propices à la propagation
de maladies et aux nuisibles.
La plupart du temps, les enfants n’avaient pas accès à l’école, lorsqu'ils pouvaient
y aller, c’était avec une école interne au camp.
De plus, des zones d’ombres sur le
quotidien des camps, particulièrement en ce qui concerne le placement arbitraire
d’enfants.
Des fratries étaient divisées sans aucune raison apparente, les aînées
étaient envoyées dans d’autres camps, sans même que les parents soient prévus.
Encore aujourd’hui, les raisons des déplacements sont encore inconnues
Les chefs de camps géraient les épargnes des familles, ils les distribuaient selon
leur bon vouloir.
La moitié des prestations sociales que touchaient les harkis
étaient prises pour assurer le fonctionnement du camp.
C’est pour cela qu'on dit
que les harkis payaient leur propre prison.
c) la honte d'être un Harkis
Les conditions de vie dans les camps étaient alors misérables, cependant
personne n’en parlait, les habitants des camps faisaient comme si cela était
normal.
Ce silence sur leur quotidien est lié à la honte qui pèse qu ces familles,
j’aimerais alors reprendre l’expression de Dalila Kerchouche, née en 1937 dans le
camp: “harkis avec un petit h comme honte”.
Cette honte pèse particulièrement
sur les pères, jugés responsables de cette trahison à leur patrie, l’Algérie.
La mémoire ne circule pas et les enfants ne sont pas inclus dans le devoir de
mémoire.
II/ La mémoire des Harkis dès 70
a) la révolte des enfants d’harkis
Au début des années 70, les enfants ayant vécu depuis jeunes dans le camp
deviennent adolescents, ils deviennent alors conscient des conditions
déplorables dans lesquels ils vivent.
Un mouvement contestataire animé par la
volonté d’en finir avec les camps émerge en 1975.
Ce mouvement connaît un
effort retentissement, notamment grâce à M’hammed Laradji, qui a effectué
des actions de sensibilisation et de dénonciation auprès de l’opinion publique pour
alerter sur ces camps d’harkis.
Ces révoltes ont lieu dans les 2 derniers camps
existant: le camp de Biais et le camp de saint Maurice l’Ardoise, elles
permettent leur fermeture à la fin de 1975.
Ces mouvements constituent un
premier réveil de la mémoire au grand jour , puisque les révélations faites sur
les camps permettent au grand public de comprendre quel à été le quotidien de
ces familles harkis pendant 13 ans.
b) première reconnaissance de l’ Etat grâce à des mesures et indemnisation
en 80/90
Cette attention médiatique sur les harkis se traduit par des premières mesures
de reconnaissance, par exemple l’obtention du statut d’ancien combattant pour
les harkis en 1974.
En 1987, une mesure d’indemnisation par des allocations forfaitaires aux harkis
et a leurs famille à été votée .
Cette première....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- grand oral HGGSP: Argentine et Shoah
- Grand oral hggsp: Sujet : Comment la justice contribue à la réconciliation civile à la suite du génocide du Rwanda (7 avril au 17 juillet 1994) ?
- Grand oral HGGSP les parc naturel américains
- grand oral HGGSP Théorie du complots
- Grand Oral HGGSP: le patrimoine