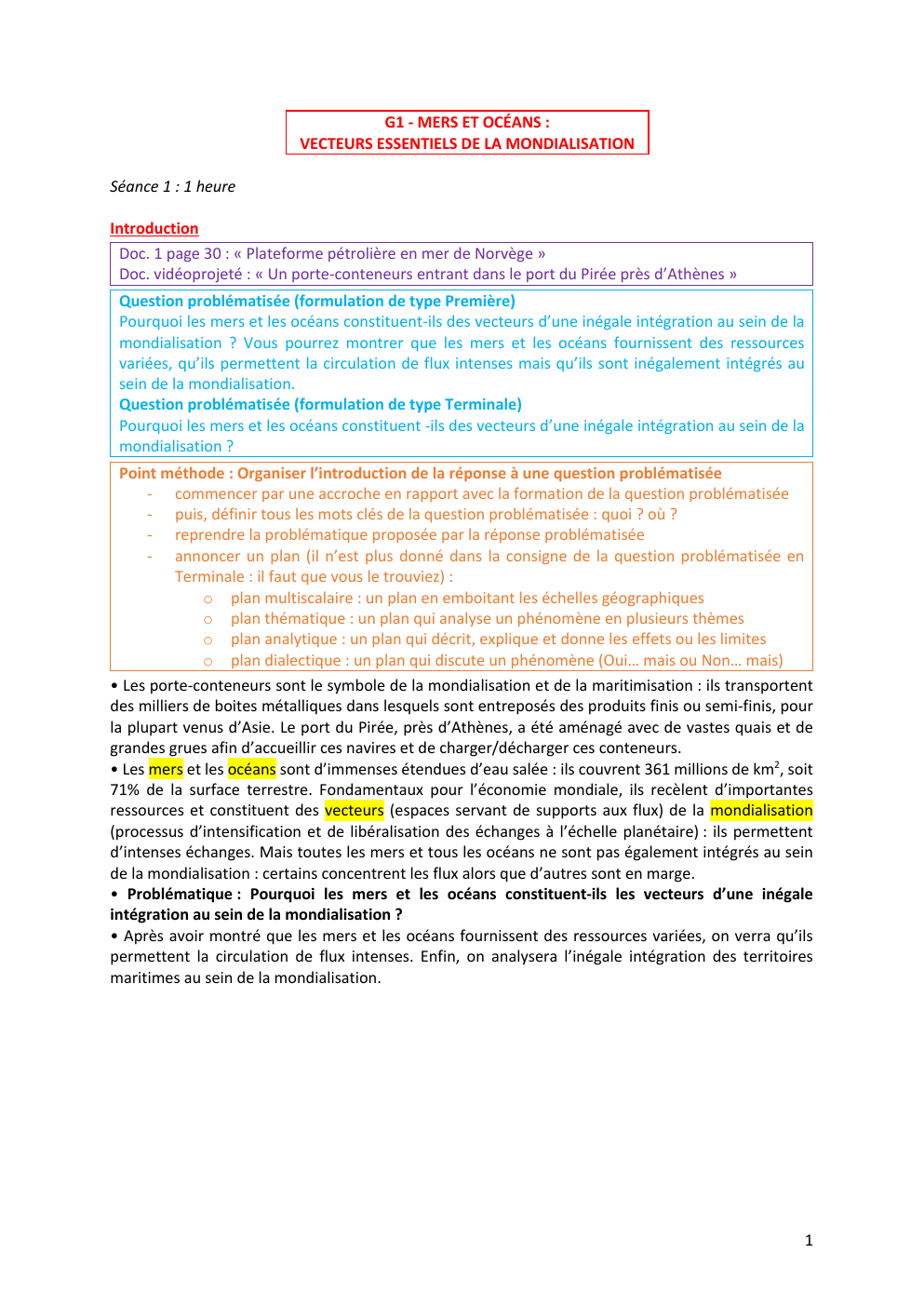G1 - MERS ET OCÉANS : VECTEURS ESSENTIELS DE LA MONDIALISATION
Publié le 22/05/2025
Extrait du document
«
G1 - MERS ET OCÉANS :
VECTEURS ESSENTIELS DE LA MONDIALISATION
Séance 1 : 1 heure
Introduction
Doc.
1 page 30 : « Plateforme pétrolière en mer de Norvège »
Doc.
vidéoprojeté : « Un porte-conteneurs entrant dans le port du Pirée près d’Athènes »
Question problématisée (formulation de type Première)
Pourquoi les mers et les océans constituent-ils des vecteurs d’une inégale intégration au sein de la
mondialisation ? Vous pourrez montrer que les mers et les océans fournissent des ressources
variées, qu’ils permettent la circulation de flux intenses mais qu’ils sont inégalement intégrés au
sein de la mondialisation.
Question problématisée (formulation de type Terminale)
Pourquoi les mers et les océans constituent -ils des vecteurs d’une inégale intégration au sein de la
mondialisation ?
Point méthode : Organiser l’introduction de la réponse à une question problématisée
- commencer par une accroche en rapport avec la formation de la question problématisée
- puis, définir tous les mots clés de la question problématisée : quoi ? où ?
- reprendre la problématique proposée par la réponse problématisée
- annoncer un plan (il n’est plus donné dans la consigne de la question problématisée en
Terminale : il faut que vous le trouviez) :
o plan multiscalaire : un plan en emboitant les échelles géographiques
o plan thématique : un plan qui analyse un phénomène en plusieurs thèmes
o plan analytique : un plan qui décrit, explique et donne les effets ou les limites
o plan dialectique : un plan qui discute un phénomène (Oui… mais ou Non… mais)
• Les porte-conteneurs sont le symbole de la mondialisation et de la maritimisation : ils transportent
des milliers de boites métalliques dans lesquels sont entreposés des produits finis ou semi-finis, pour
la plupart venus d’Asie.
Le port du Pirée, près d’Athènes, a été aménagé avec de vastes quais et de
grandes grues afin d’accueillir ces navires et de charger/décharger ces conteneurs.
• Les mers et les océans sont d’immenses étendues d’eau salée : ils couvrent 361 millions de km2, soit
71% de la surface terrestre.
Fondamentaux pour l’économie mondiale, ils recèlent d’importantes
ressources et constituent des vecteurs (espaces servant de supports aux flux) de la mondialisation
(processus d’intensification et de libéralisation des échanges à l’échelle planétaire) : ils permettent
d’intenses échanges.
Mais toutes les mers et tous les océans ne sont pas également intégrés au sein
de la mondialisation : certains concentrent les flux alors que d’autres sont en marge.
• Problématique : Pourquoi les mers et les océans constituent-ils les vecteurs d’une inégale
intégration au sein de la mondialisation ?
• Après avoir montré que les mers et les océans fournissent des ressources variées, on verra qu’ils
permettent la circulation de flux intenses.
Enfin, on analysera l’inégale intégration des territoires
maritimes au sein de la mondialisation.
1
Séance 2 : 1 heure
I.
Des ressources variées fournies par les espaces maritimes
A.
Les ressources halieutiques : pêche, aquaculture et biomasse
Doc.
vidéoprojeté : « Évolution mondiale des stocks de poissons »
Doc.
vidéoprojeté : « L’exploitation des stocks de poisson dans le monde face à la… »
Doc.
1 page 36 : « Les principaux pays de pêche »
Doc.
vidéoprojeté : « La répartition des navires de pêche (par région, en 2016) »
Doc.
vidéoprojeté : « L’exploitation de ressources aquacoles »
• Les ressources halieutiques (espaces animales ou végétales vivant dans l’eau) sont largement
exploitées : 80 millions de tonnes de poissons sont pêchées chaque année.
Ce chiffre stagne
depuis plusieurs années du fait de la pêche industrielle, qui fait craindre l’épuisement des
ressources et du changement climatique, qui fait migrer des espèces vers des zones froides.
• L’océan Pacifique regroupe la moitié des captures devant l’océan Atlantique (20 % des prises).
La Chine, l’Indonésie et les États-Unis sont les principaux pays pour la pêche.
La pêche en mer
rassemble des techniques variées et la productivité moyenne mondiale par pêcheur (2,3 tonnes
par an) masque des inégalités.
La pêche artisanale se pratique le long des côtes avec de petits
bateaux.
La pêche industrielle s’effectue en haute mer avec des chalutiers (bateau de pêche
tirant un filet derrière lui) où le poisson est directement transformé et conditionné.
• L’importance de l’aquaculture (élevage d’espèces aquatiques dans un but commercial)
croît : 30 millions de tonnes d’algues sont produites par an.
Mais l’aquaculture requiert
d’importantes ressources halieutiques.
Cette production met en péril la pêche artisanale qui
domine dans les pays en développement et dont les prises dépendent de l’abondance de la
ressource.
La biomasse (matière d’origine animale ou végétale utilisable comme source
d’énergie) n’est pas seulement utilisée pour l’alimentation, elle peut aussi servir à produire de
l’énergie, comme les algocarburants (carburants produits à partir d’algues).
B.
Les ressources des fonds marins : énergies, nodules et sable
Doc.
vidéoprojeté : « Les hydrocarbures offshore »
Doc.
vidéoprojeté : « Mers et océans, réservoirs de ressources »
Doc.
vidéoprojeté : « Plateforme pétrolière en Écosse »
Doc vidéoprojeté : « Éoliennes off-shore et bateau de croisière entre la Suède et le… »
Doc.
vidéoprojeté : « Développement de l’éolien off-shore »
Doc.
vidéoprojeté : « L’exploitation de sable en Sierra Leone »
• Les hydrocarbures off-shore (pétrole et gaz prélevés dans les fonds marins).
représentent la
plus grande part des ressources énergétiques marines : 30% de la production mondiale de
pétrole et 27% de celle de gaz se fait par le biais de plateformes en mer.
Ces ressources sont
inégalement réparties, ce qui génère des flux.
Les hydrocarbures off-shore sont exploités dans
les golfes de Guinée et du Mexique ainsi qu’en mer de Chine.
Les progrès techniques récents
permettent des forages de plus en plus profonds et éloignés des côtes dans de nombreuses
zones d’exploitation (Arctique, golfe du Mexique, Alaska, golfe de Guinée…).
• Les mers et océans produisent des énergies marines renouvelables (énergies produites à partir
du rayonnement solaire, du vent ou de la houle).
Des champs d’éoliennes en mer se sont
multipliés, surtout en Europe.
La force de la marée, de la houle ou des courants marins peut
aussi être exploitée pour produire de l’électricité.
L’eau de mer peut être dessalée : cette
solution est envisagée par quelques pays en situation de stress hydrique (situation dans laquelle
les quantités d’eau sont insuffisantes pour répondre aux besoins), comme au Moyen-Orient.
• Les mers et océans regorgent de ressources stratégiques.
Les nodules polymétalliques
(métaux rares non ferreux) sont présents dans les fonds marins.
Mais, ces-derniers ne sont pas
encore tous exploités, pour des raisons de coût du fait de leur profondeur.
Le sable est
nécessaire pour toutes les constructions (routes, bâtiments).
Il est donc exploité de façon très
intensive, notamment en Sierra Leone, en Australie, dans le Golfe persique ou en Indonésie.
2
C.
Les ressources touristiques : croisières, marinas et plages
Doc.
vidéoprojeté : « Navires de croisière (Cozumel, Mexique, mer des Caraïbes) »
Doc.
vidéoprojeté : « Les tourisme de croisières »
Doc.
vidéoprojeté : « Le monde des croisières maritimes »
Doc.
vidéoprojeté : « La marina de Dubaï »
Doc.
vidéoprojeté : « Le surf : diffusion planétaire d’une pratique sportive en mer »
• Les activités de croisière maritime connaissent une croissance très importante.
Le bassin
caribéen, avec le port de Miami (premier port de croisières au monde), et la Méditerranée
concentrent la majorité des croisières.
Le tourisme de croisière (forme de tourisme pratiquée
sur des paquebots, impliquant plusieurs escales, à partir ou vers un port d’attache) s’accroît : on
comptait 28 millions de croisiéristes en 2019.
Elles se développent également en mer du Nord
et dans les mers de Chine, mais aussi en Arctique et en Antarctique.
Des firmes transnationales
assurent l’essentiel du marché (Cunard Line, Costa croisières, MSC croisières…) mais cette
activité est de plus en plus remise en question du fait de son impact environnemental.
• La plaisance est une autre activité marine dont la pratique s’est beaucoup développée depuis
la fin du XXème siècle.
Elle a engendré de vastes aménagements des littoraux, de façon assez
standardisée, avec des marinas.
C’est à Dubaï que se trouve, à ce jour, la plus grande marina du
monde, qui peut accueillir 4 400 yachts et 6 000 passagers.
• Les ressources paysagères favorisent également le tourisme.
Les pratiques sportives ou
récréatives en mer sont nombreuses.
Les bains de mer, la plongée ou les sports de glisse attirent
des touristes et des locaux dans des « spots » dont certains sont célèbres comme Hawaii ou la
côte basque en France.
Ils y pratiquent le tourisme balnéaire (forme de tourisme associée à la
fréquentation de la plage), très présent sur de nombreux littoraux du monde.
3
Séance 3 : 1 heure
II.
Des flux divers en circulation sur les espaces maritimes
A.
Des circulations humaines sur les mers et sur les océans
Doc.
vidéoprojeté : « Un équipage multiculturel »
Doc.
vidéoprojeté : « L’évolution du trafic maritime »
Doc.
vidéoprojeté : « Une recomposition des routes migratoires vers l’Europe »
Doc.
vidéoprojeté : « Le tourisme de croisière »
• Les mers et....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre 1 : Mers et océans : au cœur de la mondialisation Cours 1 : Mers et océans : vecteurs essentiels de la mondialisation
- Question problématisée : Pourquoi les mers et les océans sont-ils des vecteurs essentiels de la mondialisation ?
- Mers et océans : vecteurs essentiels de la mondialisation
- MERS ET OCÉANS : VECTEURS ESSENTIELS DE LA MONDIALISATION
- P1-les mers et océans, vecteur essentiels de la mondialisation