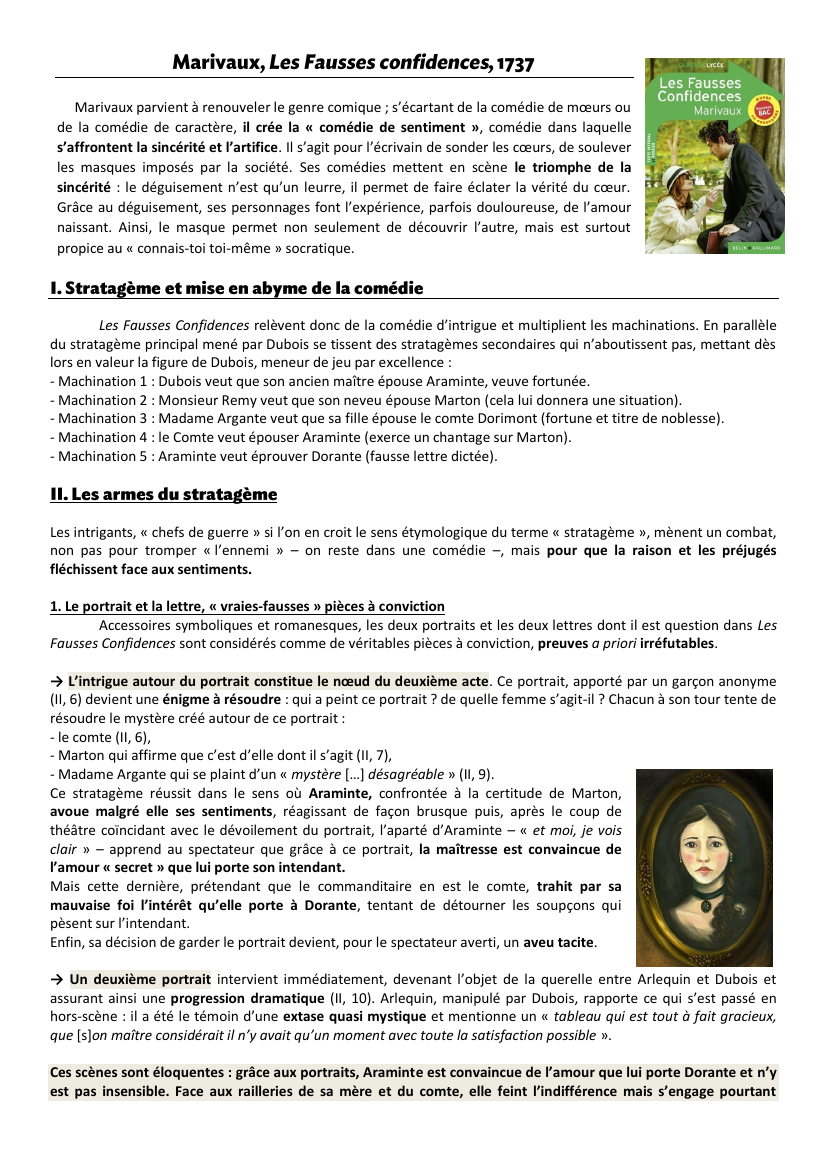fausses confidence Marivaux: Dubois
Publié le 11/10/2021

Extrait du document
«
Marivaux parvient à renouveler le genre comique ; s’écartant de la comédie de mœurs ou
de la comédie de caractère, il crée la « comédie de sentiment » , comédie dans laquelle
s’affrontent la sincérité et l’artifice .
Il s’agit pour l’écrivain de sonder les cœurs, de soulever
les masques imposés par la société. Ses comédies mettent en scène le triomphe de la
sincérité : le déguisement n’est qu’un leurre, il permet de faire éclater la vérité du cœur.
Grâce au déguisement, ses personnages font l’expérience, parfois douloureuse, de l’amour
naissant.
Ainsi, le masque permet non seulement de découvrir l’autre, mais est surtout
propice au « connais -toi toi -même » socratique.
Les Fausses Confidences relèvent donc de la comédie d’intrigue et multiplient les machinations.
En parallèle
du stratag ème principal mené par Dubois se tissent des stratagèmes secondaires qui n’aboutissent pas, mettant dès
lors en valeur la figure de Duboi s, meneur de jeu par excellence :
- Machination 1 : Dubois veut que son ancien maître épouse Araminte, veuve fortunée.
- Machination 2 : Monsieur Remy veut que son neveu épouse Marton (cela lui donnera une situation) .
- Machination 3 : Madame Argante veut que sa fille épouse le comte Dorimont (fortune et titre de noblesse) .
- Machination 4 : le Comte veut épouser Araminte (exerce un chantage sur Marton) .
- Machination 5 : Araminte veut éprouver Dorante (fausse lettre dictée) .
Les intrigants, « ch efs de guerre » si l’on en croit le sens étymologique du terme « stratagème », mènent un combat,
non pas pour tromper « l’ennemi » – on reste dans une comédie –, mais pour que la rai son et les préjugés
fléchissent face aux sentiments.
1.
Le portrait et l a lettre, « vraies -fausses » pièces à conviction
Accessoires symboliques et romanesques, les deux portraits et les deux lettres dont il est question dans Les
Fausses Confidences sont considérés comme de véritables pièces à conviction, preuves a priori irr éfutables .
→ L’intrigue autour du portrait constitue le nœud du deuxième acte .
Ce portrait, apporté par un garçon anonyme
(II, 6) devient une énigme à résoudre : qui a peint ce portrait ? de quelle femme s’agit -il ? Chacun à son tour tente de
résoudre le mystère créé autour de ce portrait :
- le comte (II, 6),
- Marton qui affirme que c’est d’elle dont il s’agit (==, 7),
- Madame Argante qui se plaint d’un « mystère […] désagréable » (II, 9).
Ce stratagème réussit dans le sens où Araminte, confrontée à la certitud e de Marton,
avoue malgré elle ses sentiments , réagissant de façon brusque puis, après le coup de
théâtre coïn cidant avec le dévoilement du portrait, l’aparté d’Araminte – « et moi, je vois
clair » – apprend au spectateur que grâce à ce portrait, la maîtresse est convaincue de
l’amour « secret » que lui porte son intendant.
Mais cette dernière, prétendant que le commanditaire en est le comte, trahit par sa
mauvaise foi l’intérêt qu’elle porte à Dorante , tentant de détourner les soupçons qui
pèsent sur l’intendant.
Enfin, sa décision de garder le portrait devient, pour le spectateur averti, un aveu tacite .
→ Un deuxième portrait intervient immédiatement, devenant l’objet de la querelle entre Arlequin et Dubois et
assurant ainsi une progression dramatique (==, 10).
Arlequin, manipulé par Dubois, rapporte ce qui s’est passé en
hors -scène : il a été le témoin d’une extase quasi mystique et mentionne un « tableau qui est tout à fait gracieux,
que [s] on maître considérait il n’y avait qu’un moment avec toute la satisfaction possible ».
Ces scènes sont éloquentes : grâce aux portraits, Aramint e est convaincue de l’amour que lui porte Dorante et n’y
est pas insensible.
Face aux railleries de sa mère et du comte, elle feint l’indifférence mais s’engage pourtant.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture linéraire : Marivaux, Les Fausses Confidences, Texte intégral De « Dorante : Cette femme-ci » à « Dubois : L’amour et moi nous ferons le reste »
- Marivaux, Les Fausses confidence Questions - Acte I Scène 2
- Étude linéaire n°2 – Les Fausses Confidences, Marivaux, 1737 – Acte II, scène 13 : le stratagème d’Araminte
- fiche analyse linéaire les fausses confidences Marivaux - scène 2 de l'acte I
- Etude linéaire Marivaux, Les fausses confidences - – Acte I, scène 2