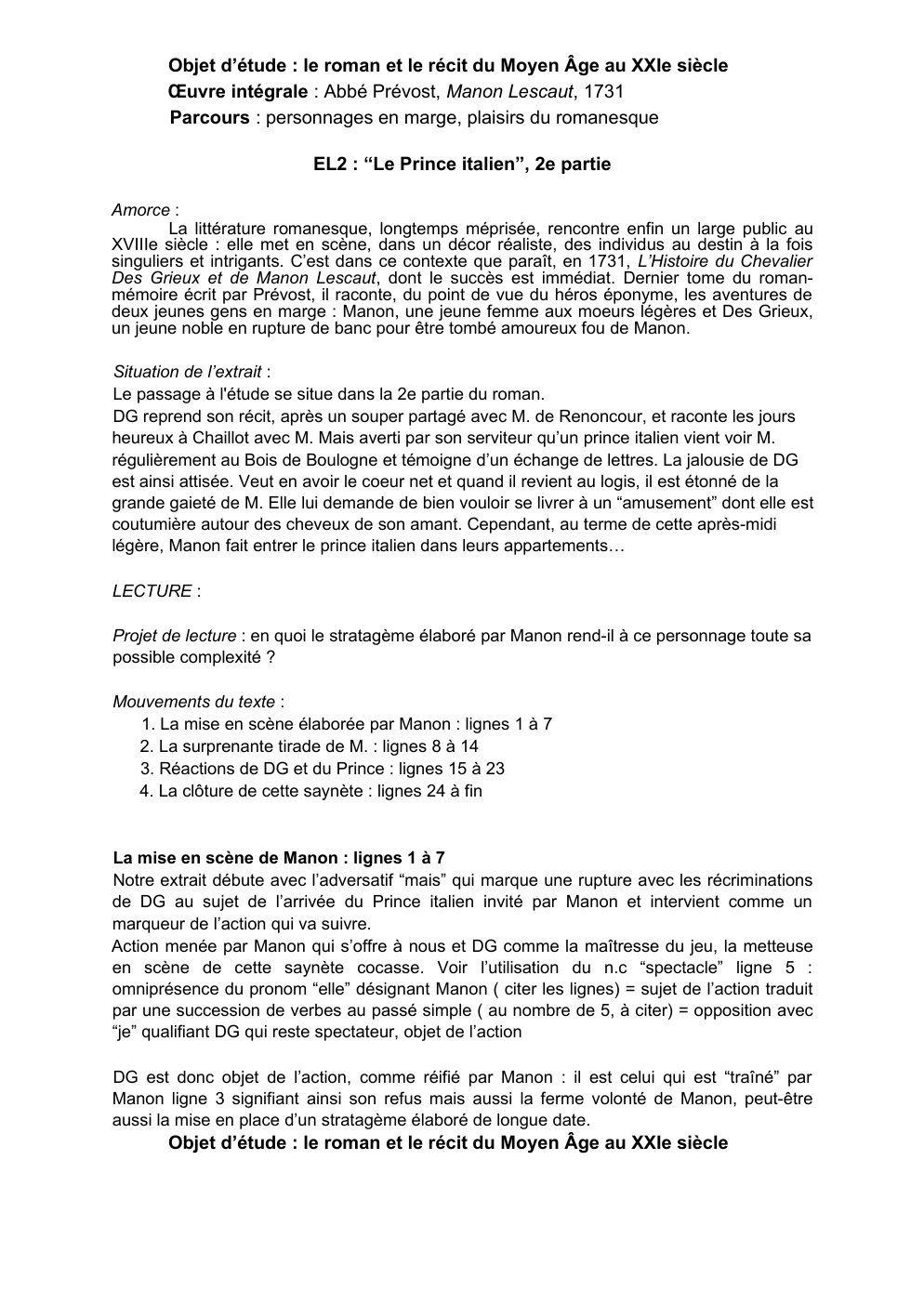Etude Linéaire Manon Lescaut, Prince Italien
Publié le 02/05/2025
Extrait du document
«
Objet d’étude : le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
Œuvre intégrale : Abbé Prévost, Manon Lescaut, 1731
Parcours : personnages en marge, plaisirs du romanesque
EL2 : “Le Prince italien”, 2e partie
Amorce :
La littérature romanesque, longtemps méprisée, rencontre enfin un large public au
XVIIIe siècle : elle met en scène, dans un décor réaliste, des individus au destin à la fois
singuliers et intrigants.
C’est dans ce contexte que paraît, en 1731, L’Histoire du Chevalier
Des Grieux et de Manon Lescaut, dont le succès est immédiat.
Dernier tome du romanmémoire écrit par Prévost, il raconte, du point de vue du héros éponyme, les aventures de
deux jeunes gens en marge : Manon, une jeune femme aux moeurs légères et Des Grieux,
un jeune noble en rupture de banc pour être tombé amoureux fou de Manon.
Situation de l’extrait :
Le passage à l'étude se situe dans la 2e partie du roman.
DG reprend son récit, après un souper partagé avec M.
de Renoncour, et raconte les jours
heureux à Chaillot avec M.
Mais averti par son serviteur qu’un prince italien vient voir M.
régulièrement au Bois de Boulogne et témoigne d’un échange de lettres.
La jalousie de DG
est ainsi attisée.
Veut en avoir le coeur net et quand il revient au logis, il est étonné de la
grande gaieté de M.
Elle lui demande de bien vouloir se livrer à un “amusement” dont elle est
coutumière autour des cheveux de son amant.
Cependant, au terme de cette après-midi
légère, Manon fait entrer le prince italien dans leurs appartements…
LECTURE :
Projet de lecture : en quoi le stratagème élaboré par Manon rend-il à ce personnage toute sa
possible complexité ?
Mouvements du texte :
1.
La mise en scène élaborée par Manon : lignes 1 à 7
2.
La surprenante tirade de M.
: lignes 8 à 14
3.
Réactions de DG et du Prince : lignes 15 à 23
4.
La clôture de cette saynète : lignes 24 à fin
La mise en scène de Manon : lignes 1 à 7
Notre extrait débute avec l’adversatif “mais” qui marque une rupture avec les récriminations
de DG au sujet de l’arrivée du Prince italien invité par Manon et intervient comme un
marqueur de l’action qui va suivre.
Action menée par Manon qui s’offre à nous et DG comme la maîtresse du jeu, la metteuse
en scène de cette saynète cocasse.
Voir l’utilisation du n.c “spectacle” ligne 5 :
omniprésence du pronom “elle” désignant Manon ( citer les lignes) = sujet de l’action traduit
par une succession de verbes au passé simple ( au nombre de 5, à citer) = opposition avec
“je” qualifiant DG qui reste spectateur, objet de l’action
DG est donc objet de l’action, comme réifié par Manon : il est celui qui est “traîné” par
Manon ligne 3 signifiant ainsi son refus mais aussi la ferme volonté de Manon, peut-être
aussi la mise en place d’un stratagème élaboré de longue date.
Objet d’étude : le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
Œuvre intégrale : Abbé Prévost, Manon Lescaut, 1731
Parcours : personnages en marge, plaisirs du romanesque
Cette volonté ferme s’exprime également par la rudesse avec laquelle elle “empoigna” ( l.1)
= étym.
prendre avec rudesse
Idée de rudesse réitérée, renforcée par le COD = “toute sa force”, “je faisais des efforts
inutiles pour me dégager” lignes 16-17 + l’objet de la rudesse : “mes cheveux” (l.2) ==}
inversion des rôles masculins / féminins = Manon du côté de la force et DG du côté de la
faiblesse.
DG est un spectateur passif, il devient une forme d’ objet scénique au service de la mise en
scène de Manon.
-miroir + DG = objets scéniques -> Manon est metteuse en scène, elle donne le LA de cette
saynète ( Petite farce en un acte du théâtre espagnol, en vogue du début du xviie siècle à la fin du
xixe siècle.
D’abord simple intermède, la saynète, notamment sous l’influence de Ramon de la Cruz,
devint un genre à part entière mêlant à la danse et au chant une vive critique sociale.
▪ Par extension.
Pièce courte, le plus souvent légère et comptant peu de personnages, jouée par des
artistes comiques, des comédiens amateurs, etc.)
- Scène qui s’affiche telle une scène de comédie voire de farce = ici, comique de situation et
de gestes.
Rire/sourire appuyé du spectateur devant le caractère cocasse de cette scène où
un jeune noble, DG, est amené par les cheveux devant un autre noble, le Prince italien, qui
s’attend vraisemblablement à tout autre chose de la part de cette belle jeune femme du
peuple “ jeter dans l’embarras”, “arrêté au milieu de la chambre” + “l’ouvrant du genou” :
CCmanière qui nous fait imaginer les contorsions comiques de la jeune femme pour mener à
bien son dessein.
Ce moment comique est l’occasion pour DG de brosser le portrait du prince= “fort bien mis”
importance de l’apparence = code vestimentaire l’affilie à la noblesse / “mauvaise mine” qui
dit sa laideur physique et explique sans doute le dégoût de Manon, esthète/ DG,
manifestement bel homme : “Faites la comparaison vous-même” ligne 12
- traits de caractères du Prince en filigrane = le prince est un aristocrate italien.
Malgré la
situation inconfortable, il doit sauver les apparences, conserver la figure de l'honnête homme
en dépit de sa stupeur, de son “étonnement” ligne 179 : “ profonde révérence”.
L'utilisation
de l’adjectif évaluation “profonde” marque son obséquiosité en toutes circonstances ( voir
plus loin le GN prép “ avec un sourire forcé” ligne 20).
Dans ce monde des apparences
qu’est l’aristocratie, il s’agit de conserver la face, de sauvegarder les apparences.
Critique de
ces codes sociaux/candeur, naturel de Manon ? En filigrane, Prévost ne se range-t-il pas du
côté de Manon ? Le Prince Italien est manifestement humilié, qui plus est devant un de ses
pairs ( DG) = affront, impudence, il apparaît tel le dindon de la farce amère dont la metteuse
en scène est Manon, fille du peuple.
Le stratagème mis en place par Manon surprend le lecteur aussi bien que DG et le Prince.
Le caractère particulièrement comique de cette scène cède cependant la place à une
“harangue” de Manon, véritable tirade qui termine de surprendre les spectateurs (le lecteur,
DG, Le Prince) tant par sa forme que par son contenu
Objet d’étude : le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
Œuvre intégrale : Abbé Prévost, Manon Lescaut, 1731
Parcours : personnages en marge, plaisirs du romanesque
La surprenante tirade de M.
: lignes 8 à 14
-”ne lui donna pas le temps d’ouvrir la bouche ” =utilisation de la négation totale à travers les
deux adverbes de négation “ne”...”pas” = ne donne pas le choix au prince mais de manière
radicale.
Le prend de court et d’une manière qui rompt avec les codes sociaux de la
bienséance, qui plus est à l’endroit d’une personnalité....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ETUDE LINEAIRE MANON LESCAUT Le coup de foudre
- etude linéaire préambule et arcticle 1-4 DDFC
- Etude linéaire princesse de Clèves: « Sitôt que la nuit fut venue »
- Etude linéaire Annie Ernaux « La femme gelée »
- Etude linéaire Marivaux, Les fausses confidences - – Acte I, scène 2