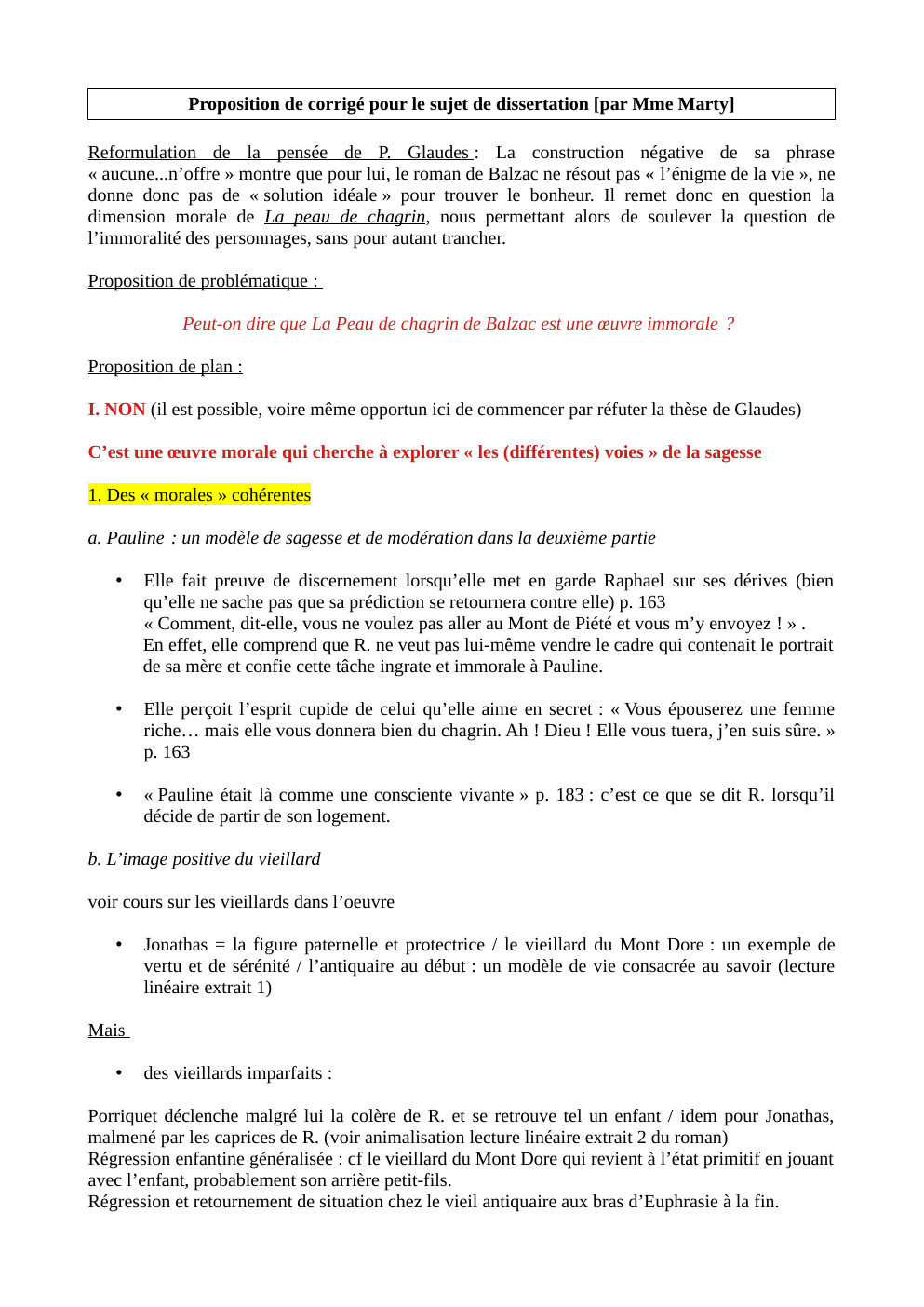dissertation Balzac
Publié le 28/05/2025
Extrait du document
«
Proposition de corrigé pour le sujet de dissertation [par Mme Marty]
Reformulation de la pensée de P.
Glaudes : La construction négative de sa phrase
« aucune...n’offre » montre que pour lui, le roman de Balzac ne résout pas « l’énigme de la vie », ne
donne donc pas de « solution idéale » pour trouver le bonheur.
Il remet donc en question la
dimension morale de La peau de chagrin, nous permettant alors de soulever la question de
l’immoralité des personnages, sans pour autant trancher.
Proposition de problématique :
Peut-on dire que La Peau de chagrin de Balzac est une œuvre immorale ?
Proposition de plan :
I.
NON (il est possible, voire même opportun ici de commencer par réfuter la thèse de Glaudes)
C’est une œuvre morale qui cherche à explorer « les (différentes) voies » de la sagesse
1.
Des « morales » cohérentes
a.
Pauline : un modèle de sagesse et de modération dans la deuxième partie
•
Elle fait preuve de discernement lorsqu’elle met en garde Raphael sur ses dérives (bien
qu’elle ne sache pas que sa prédiction se retournera contre elle) p.
163
« Comment, dit-elle, vous ne voulez pas aller au Mont de Piété et vous m’y envoyez ! » .
En effet, elle comprend que R.
ne veut pas lui-même vendre le cadre qui contenait le portrait
de sa mère et confie cette tâche ingrate et immorale à Pauline.
•
Elle perçoit l’esprit cupide de celui qu’elle aime en secret : « Vous épouserez une femme
riche… mais elle vous donnera bien du chagrin.
Ah ! Dieu ! Elle vous tuera, j’en suis sûre.
»
p.
163
•
« Pauline était là comme une consciente vivante » p.
183 : c’est ce que se dit R.
lorsqu’il
décide de partir de son logement.
b.
L’image positive du vieillard
voir cours sur les vieillards dans l’oeuvre
•
Jonathas = la figure paternelle et protectrice / le vieillard du Mont Dore : un exemple de
vertu et de sérénité / l’antiquaire au début : un modèle de vie consacrée au savoir (lecture
linéaire extrait 1)
Mais
•
des vieillards imparfaits :
Porriquet déclenche malgré lui la colère de R.
et se retrouve tel un enfant / idem pour Jonathas,
malmené par les caprices de R.
(voir animalisation lecture linéaire extrait 2 du roman)
Régression enfantine généralisée : cf le vieillard du Mont Dore qui revient à l’état primitif en jouant
avec l’enfant, probablement son arrière petit-fils.
Régression et retournement de situation chez le vieil antiquaire aux bras d’Euphrasie à la fin.
2.
Des « voies » sans issues (on rejoint la thèse de Glaudes)
a.
La voie du retrait
L’isolement de R.
ne lui réussit pas : les épisodes de cures thermales sont des fiascos :
-le duel dans lequel il tue Charles
-la marginalisation qu’il subit (Le Cercle le traite tel un paria)
-il ne supporte pas la pitié excessive de l’Auvergnate qui l’héberge
-Sa maladie s’aggrave et il est contraint de quitter les lieux à chaque fois
b.
La voie du profit
-Bien que millionnaire, Raphael est malheureux car il n’est pas libre (il n’a en effet pas mérité cet
argent)
-Rastignac, l’opportuniste qui raconte son futur mariage avec une riche Alsacienne mais finit
« désappointé » car elle ne lui plaît pas et n’est pas si riche qu’il l’espérait.
p.
151 / 181
-la voie du jeu : au début il perd son dernier sou au Palais Royal/ il éprouve de la culpabilité en
jouant l’argent volé à son père qui lui donne pourtant dans la foulée des marques de confiance : il
finit donc par renoncer au jeu et y envoyer Rastignac.
Transition sur la notion d’échec des voies explorées, ce qui conduit à adhérer à la thèse implicite de
Glaudes : une œuvre immorale.
II.
OUI
C’est une œuvre immorale par les personnages qu’elle met en scène
1.
Le triomphe des personnages sans foi ni loi
A.
Les opportunistes & faux amis
•
•
•
Rastignac et les Mémoires de la tante de Raphael (il incite ce dernier à écrire de fausses
Mémoires sous le nom de sa tante pour pouvoir gagner de l’argent) p.
150
« Le monde a des envers bien salement ignobles » se dit R.
à ce moment-là.
Taillefer : le banquier décrit comme un richissime « amphitryon » mais aussi comme « le
meurtrier plein d’or » p.
76 (car il a participé à la mise à mort de ses concitoyens).
Emile qui s’incruste avec R.
chez Taillefer en lui inventant une particule et qui est décrit
comme un imposteur : « Emile était un journaliste qui avait conquis plus de gloire à ne rien
faire que les autres n’en recueillent de leur succès.
» p.
57
B.
« Les femmes sans coeur »
•
Aquilina et Euphrasie : commenter le chiasme de l’expression « l’âme du vice et le vice sans
âme » p.
84
On les retrouve toutes deux à la fin du roman, l’une aux bras de l’antiquaire au théâtre des
Italiens, l’autre à la fête organisée par Jonathas pour divertir R.
sur ses derniers jours.
Elles ont toujours leur place dans la société et leur vision cynique de la vie triomphe !
•
Foedora
➔ Rastignac la décrit comme « avare, vaine et défiante » p.
126,
➔ R.
utilise à plusieurs reprises le terme de « monstre » et de « démon » pour la décrire.
p.
165
Le recul de l’analepse lui permet de voir combien il a été manipulé par cette femme, il en
arrive à la conclusion d’une soumission totale à cet individu froid et apathique.
➔ « tous les jours, près d’elle, j’étais un esclave, un jouet sans cesse à ses ordres.
» La
déshumanisation contenue dans la métaphore du jouet montre à quel point cet être cruel jouit
des effets que sa méchanceté produit sur les hommes.
➔ « elle cachait un coeur de bronze sous sa frêle et gracieuse enveloppe.
» p.
160
R.
multiplie les récits d’humiliation, notamment lorsqu’il la met en relation avec son cousin le duc
de Navarreins à sa demande, croyant y voir là une preuve d’amour, réalisant que plus tard qu’il ne
s’agissait que d’intérêt.
De fait, R.
se montre sous un jour peu héroique à travers son récit fait à Emile, tantôt victime des
affres d’une femme à l’abord frigide, tantôt ingrat envers Pauline qui incarne la clémence et la
douceur féminines.
2.
Raphaël : un antihéros
a.
Un individu désenchanté
Le récit est construit sur l’évolution d’un individu malheureux, que rien ni personne ne peut guérir
ni combler.
« aucune » solution ne semble lui convenir (pour reprendre les termes et l’idée de Glaudes) : le
bonheur lui est comme interdit et inaccessible.
- la solution de l’isolement ne lui convient pas : outre l’échec de ses cures, le retrait dans son
appartement parisien ne fonctionne pas : « semblable à tous les malades, il ne songeait qu’à son
mal » p.
219
Par ailleurs, cela ne l’empêche pas d’émettre un vœu (celui fait malencontreusement pour son
ancien professeur) et de voir la peau se réduire.
-la solution du suicide est vite écartée suite à la rencontre de miséreux.
Il change d’avis et entre dans la boutique d’antiquités.
-la solution du rejet s’avère également vaine : il a beau rejeter la peau, son jardinier la lui ramène.
-la solution du travail acharné....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation : « Qui dit art, dit mensonge » - Honoré de Balzac
- La vie privée dans Ferragus, Balzac, Dissertation L1
- Dissertation : « Qui dit art, dit mensonge» - Honoré de Balzac
- Correction dissertation sur le Moyen orient hggsp terminale
- Correction dissertation Baccalauréat 2023.pdf