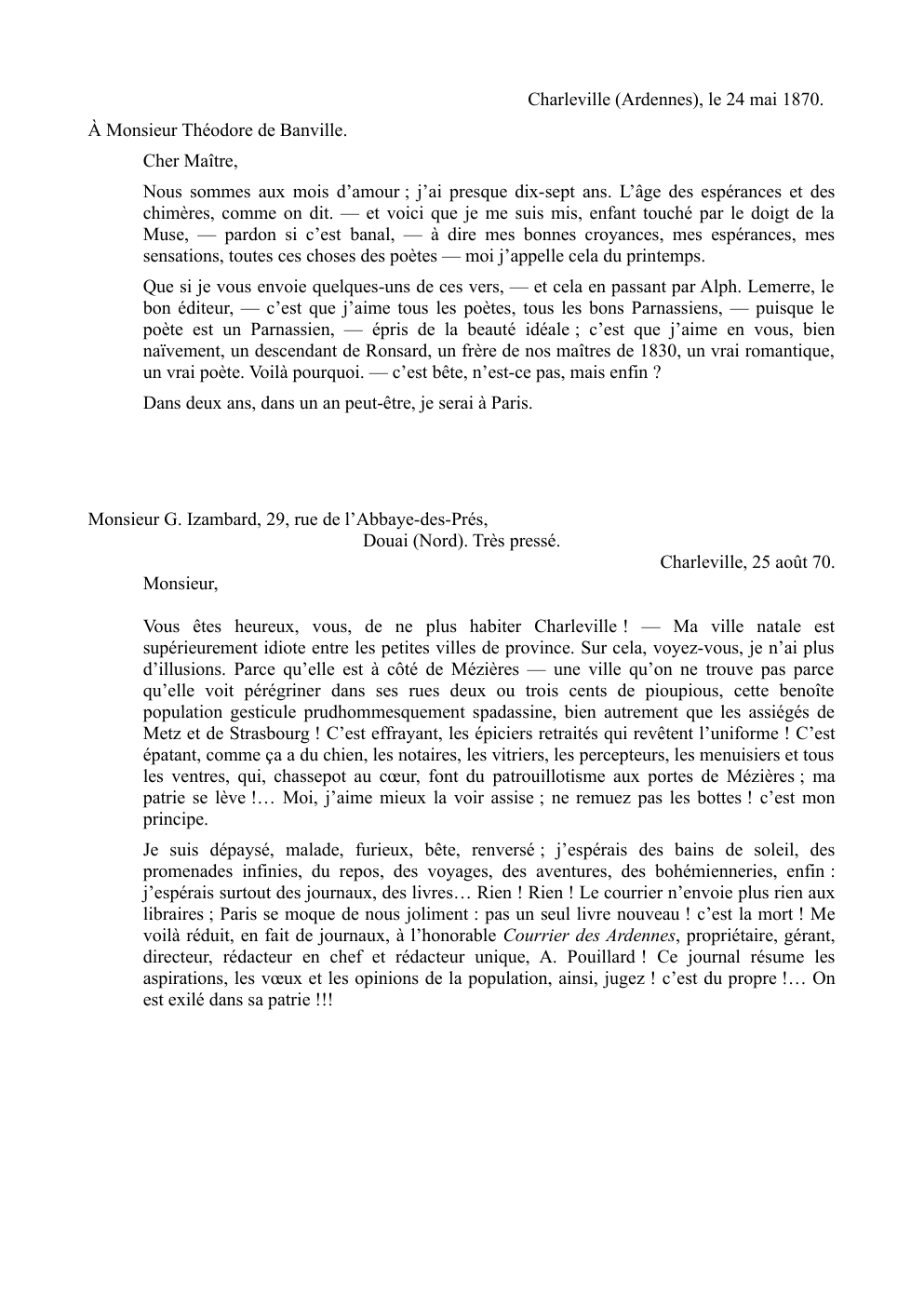cursive lecture L'émancipation créatrice Cahiers de Douai, Arthur Rimbaud
Publié le 30/03/2024
Extrait du document
«
Charleville (Ardennes), le 24 mai 1870.
À Monsieur Théodore de Banville.
Cher Maître,
Nous sommes aux mois d’amour ; j’ai presque dix-sept ans.
L’âge des espérances et des
chimères, comme on dit.
— et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la
Muse, — pardon si c’est banal, — à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes
sensations, toutes ces choses des poètes — moi j’appelle cela du printemps.
Que si je vous envoie quelques-uns de ces vers, — et cela en passant par Alph.
Lemerre, le
bon éditeur, — c’est que j’aime tous les poètes, tous les bons Parnassiens, — puisque le
poète est un Parnassien, — épris de la beauté idéale ; c’est que j’aime en vous, bien
naïvement, un descendant de Ronsard, un frère de nos maîtres de 1830, un vrai romantique,
un vrai poète.
Voilà pourquoi.
— c’est bête, n’est-ce pas, mais enfin ?
Dans deux ans, dans un an peut-être, je serai à Paris.
Monsieur G.
Izambard, 29, rue de l’Abbaye-des-Prés,
Douai (Nord).
Très pressé.
Monsieur,
Charleville, 25 août 70.
Vous êtes heureux, vous, de ne plus habiter Charleville ! — Ma ville natale est
supérieurement idiote entre les petites villes de province.
Sur cela, voyez-vous, je n’ai plus
d’illusions.
Parce qu’elle est à côté de Mézières — une ville qu’on ne trouve pas parce
qu’elle voit pérégriner dans ses rues deux ou trois cents de pioupious, cette benoîte
population gesticule prudhommesquement spadassine, bien autrement que les assiégés de
Metz et de Strasbourg ! C’est effrayant, les épiciers retraités qui revêtent l’uniforme ! C’est
épatant, comme ça a du chien, les notaires, les vitriers, les percepteurs, les menuisiers et tous
les ventres, qui, chassepot au cœur, font du patrouillotisme aux portes de Mézières ; ma
patrie se lève !… Moi, j’aime mieux la voir assise ; ne remuez pas les bottes ! c’est mon
principe.
Je suis dépaysé, malade, furieux, bête, renversé ; j’espérais des bains de soleil, des
promenades infinies, du repos, des voyages, des aventures, des bohémienneries, enfin :
j’espérais surtout des journaux, des livres… Rien ! Rien ! Le courrier n’envoie plus rien aux
libraires ; Paris se moque de nous joliment : pas un seul livre nouveau ! c’est la mort ! Me
voilà réduit, en fait de journaux, à l’honorable Courrier des Ardennes, propriétaire, gérant,
directeur, rédacteur en chef et rédacteur unique, A.
Pouillard ! Ce journal résume les
aspirations, les vœux et les opinions de la population, ainsi, jugez ! c’est du propre !… On
est exilé dans sa patrie !!!
Lettre à Georges Izambard
Cher Monsieur !
27, rue de l’Abbaye-des-Champs, à Douai (Nord)
Charleville, [13] mai 1871.
Vous revoilà professeur.
On se doit à la Société, m’avez-vous dit ; vous faites partie des corps
enseignants : vous roulez dans la bonne ornière.
— Moi aussi, je suis le principe : je me fais
cyniquement entretenir ; je déterre d’anciens imbéciles de collège : tout ce que je puis inventer de
bête, de sale, de mauvais, en action et en paroles, je le leur livre : on me paie en bocks et en filles.
Maintenant, je m'encrapule le plus possible.
Pourquoi ? je veux être poète, et je travaille à me
rendre voyant : vous ne comprendrez pas du tout, et je ne saurais presque vous expliquer.
Il s’agit
d’arriver à l’inconnu par le dérèglement de tous les sens.
Les souffrances sont énormes, mais il faut
être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète.
Ce n’est pas du tout ma faute.
C’est faux de
dire : Je pense.
On devrait dire : On me pense.
Pardon du jeu de mots.
JE est un autre.
Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et Nargue aux inconscients, qui ergotent
sur ce qu’ils ignorent tout à fait !
L'émancipation créatrice
Cahiers de Douai, Arthur Rimbaud 1870
I-
Un poète âgé de 16 ans...
Rimbaud naît en 1854 à Charleville…Il écrit ses Cahiers en 1870
Lettre 1 : A Théodore de Banville, 24 mai 1870
Questions :
• Relevez toutes les images de l'adolescence l'enthousiaste du jeune poète
• Montrez que Rimbaud fait preuve d'une distance critique
• Quelles sont ses sources d'inspiration ? .
Définition : parnassien, parnassienne Littéraire.
Qui relève du Parnasse (l'ensemble des poètes, la
poésie).
2.
Se dit du mouvement de poésie française (xix e siècle) caractérisée, en réaction contre les
épanchements romantiques, par une poésie savante et impersonnelle.
Lettre 2 : A Georges Izambard, 25 août 1870
Contexte : le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à le Prusse
Questions :
• Quels regards porte-t-il sur sa ville, ses habitants ?(patriotisme écoeurant, culture absente...)
• Quelles sont les aspirations du jeune homme ?
Partir ; d'ailleurs il fera plusieurs fugue en 1870, vers Paris et Bruxelles
•
Lettre 3 : A Georges Izambard, mai 1871
Relever deux phrases ou deux expressions qui sont pour vous les plus marquantes, les plus
mystérieuses...et essayer des les expliquer
II- Et après les Cahiers de Douai...
Rimbaud en quelques dates...
1871 : Rencontre avec Verlaine à Paris : avant le coup de foudre amoureux, admiration
réciproque, chacun connaissait l’œuvre de l’autre
1873 : Verlaine tire sur Rimbaud à Bruxelles ; retour de Rimbaud dans les Ardennes, il écrit
Une saison en enfer
1875 : Dernière rencontre avec Verlaine à qui il remet son manuscrit des Illuminations.
(le
recueil ne sera publié qu’en 1886) Rimbaud n’écrira plus
1876 : Il s’engage dans l’armée hollandaise, errances à travers l’Europe, à travers le monde
1880 à 1890 Rimbaud vit au Yeman puis en Ethiopie, il vit de commerces divers, de
trafics…
1891 : Mort de Rimbaud à Marseilles
Ecoute de quelques passages d’émissions
La compagnie des auteurs, émission 1, La vie errante, 38ième minute et 47ième minute
Arthur Rimbaud en Mille morceaux Emission 1 : Le génie
III- Première lecture du recueil
1.
De combien de poèmes se compose ce recueil ?
2.
Quelle est la forme poétique la plus répandue ?
3.
Quels sont les thèmes récurrents ? Associez des titres aux différents thèmes que vous
repérez.
Correction :
• L'amour et la sensualité
• Poèmes politiques ou révoltés
• Bohème et liberté
• Poèmes aux références littéraires et mythologiques
IV- Les sources d'inspiration : Rimbaud et la tradition poétique
1.
Rimbaud reste fidèle au sonnet : 12 des 22 poèmes sont des sonnets
2.
Les auteurs qui l'ont inspiré
Ophélie : influence romantique de Hugo dans sa fascination pour la mort et la fascination pour la
nature (deux thèmes de prédilection chez les romantiques)
« La rage de César » : on retrouve la satire de Napoléon III (même satire dans les Châtiments)
Roman ; inspiration de Flaubert
Le bal des pendus s'inspirent de Villon
Tartuffe inspiration de Molière
Le mal s'inspire de Voltaire notamment de Candide
Il imite Baudelaire : le Buffet
Soleil et Chair : idéalisation entre en contraste avec le temps présent
Ne pas oublier la place de l'ironie !!!
V- En quoi peut-on dire que la création poétique est un acte d'émancipation chez
Rimbaud ?
1.
L'émancipation personnelle à travers la poésie
a.
Quête identitaire et désir de liberté
Exploration de la façon dont Rimbaud utilise la poésie pour explorer son identité et exprimer son
désir de liberté (référence à "Ma Bohème", illustrant son désir d'évasion).
Discussion sur la manière dont ces poèmes reflètent les luttes personnelles de Rimbaud et son désir
d'indépendance.
b.
Affranchissement des contraintes sociales et familiales
Analyse des poèmes où Rimbaud exprime son rejet des attentes familiales et sociales (comme dans
"Roman", où il rejette le chemin traditionnel tracé pour lui).
Réflexion sur la manière dont la poésie devient un espace de liberté personnelle pour Rimbaud.
c- Lecture linéaire : Ma bohème
2 - L'émancipation par la rupture avec les conventions poétiques
a.
Innovation formelle
•
Analyse des structures poétiques non conventionnelles : absence de rime régulière :
Exemples précis de poèmes démontrant cette rupture (comme "Le Dormeur du Val", avec
son utilisation surprenante des rimes).
Il déconstruit l'alexandrin et multiplie les rejets et contre rejets et les enjambements.
Ce ne sont
pas des éléments nouveaux mais Rimbaud les utilise à outrance.
Ex : « Ma bohème » est un sonnet libertin (le second quatrain n'est pas grammaticalement
indépendant du premier tercet) nous pouvons observer un contre-rejet avec « des rimes » et des
césures irrégulières comme dans le « Dormeur du Val »....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de lecture, Arthur Rimbaud, Cahiers de Douai.
- Arthur Rimbaud : Les Cahiers de Douai
- Arthur Rimbaud, « Vénus anadyomène », Les Cahiers de Douai, 1870, EAF
- Les Cahiers de Douai Créativité et émancipation ?
- Présentation des cahiers de douai de Rimbaud