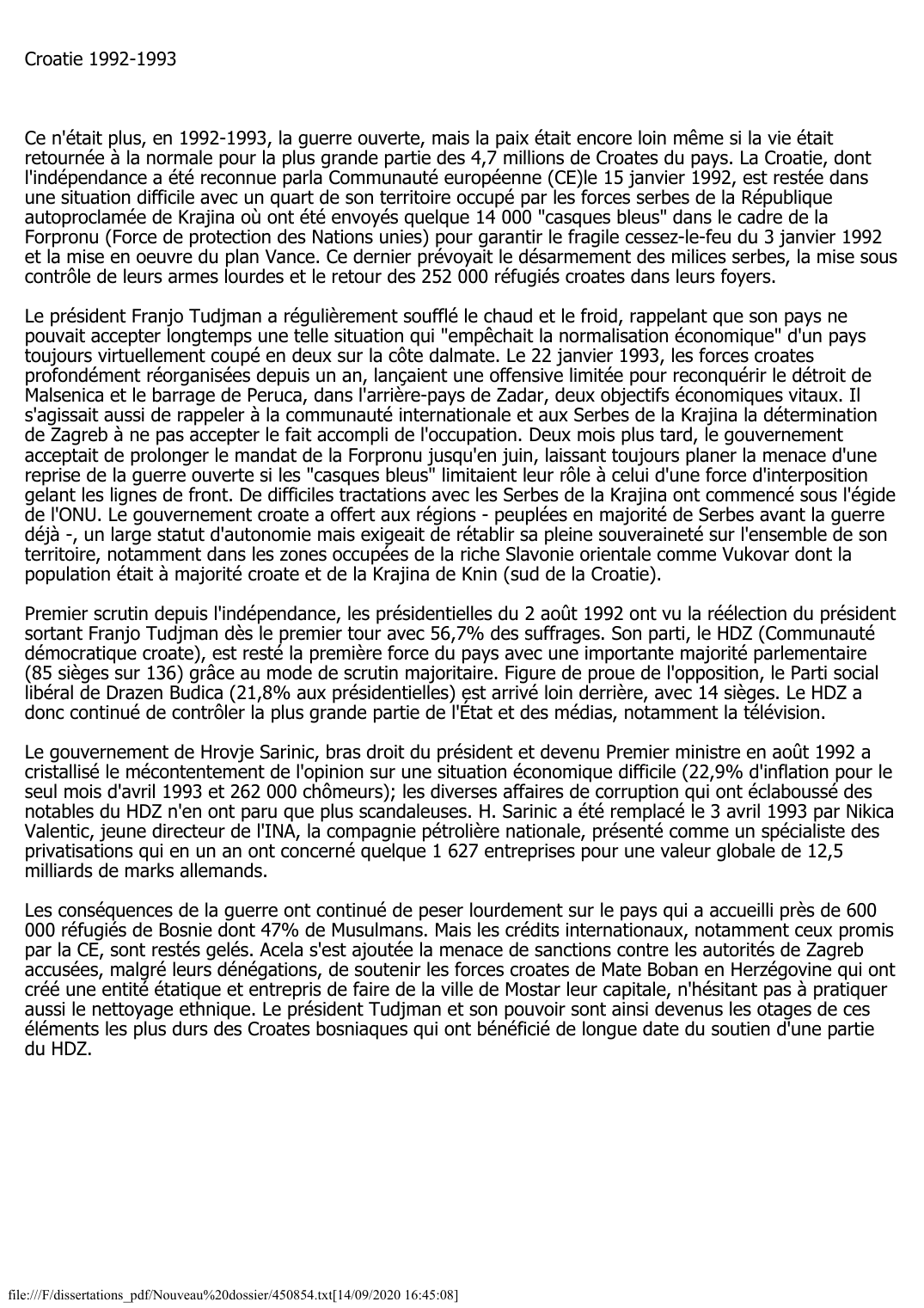Croatie (1992-1993)
Publié le 14/09/2020

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Croatie (1992-1993). Ce document contient 749 mots soit 2 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format PDF sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en: Histoire-géographie.
«
file:///F/dissertations_pdf/Nouveau%20dossier/450854.txt[14/09/2020 16:45:08]
Croatie 1992-1993
Ce n'était plus, en 1992-1993, la guerre ouverte, mais la paix éta
it encore loin même si la vie était
retournée à la normale pour la plus grande partie des 4,7 millions
de Croates du pays.
La Croatie, dont
l'indépendance a été reconnue parla Communauté européenne
(CE)le 15 janvier 1992, est restée dans
une situation difficile avec un quart de son territoire occupé par le
s forces serbes de la République
autoproclamée de Krajina où ont été envoyés quelque 14 00
0 "casques bleus" dans le cadre de la
Forpronu (Force de protection des Nations unies) pour garantir le frag
ile cessez-le-feu du 3 janvier 1992
et la mise en oeuvre du plan Vance.
Ce dernier prévoyait le désarm
ement des milices serbes, la mise sous
contrôle de leurs armes lourdes et le retour des 252 000 réfugié
s croates dans leurs foyers.
Le président Franjo Tudjman a régulièrement soufflé le chaud
et le froid, rappelant que son pays ne
pouvait accepter longtemps une telle situation qui "empêchait la norm
alisation économique" d'un pays
toujours virtuellement coupé en deux sur la côte dalmate.
Le 22 ja
nvier 1993, les forces croates
profondément réorganisées depuis un an, lançaient une offens
ive limitée pour reconquérir le détroit de
Malsenica et le barrage de Peruca, dans l'arrière-pays de Zadar, deux
objectifs économiques vitaux.
Il
s'agissait aussi de rappeler à la communauté internationale et aux
Serbes de la Krajina la détermination
de Zagreb à ne pas accepter le fait accompli de l'occupation.
Deux mo
is plus tard, le gouvernement
acceptait de prolonger le mandat de la Forpronu jusqu'en juin, laissant
toujours planer la menace d'une
reprise de la guerre ouverte si les "casques bleus" limitaient leur rô
le à celui d'une force d'interposition
gelant les lignes de front.
De difficiles tractations avec les Serbes de
la Krajina ont commencé sous l'égide
de l'ONU.
Le gouvernement croate a offert aux régions - peuplées e
n majorité de Serbes avant la guerre
déjà -, un large statut d'autonomie mais exigeait de rétablir s
a pleine souveraineté sur l'ensemble de son
territoire, notamment dans les zones occupées de la riche Slavonie or
ientale comme Vukovar dont la
population était à majorité croate et de la Krajina de Knin (s
ud de la Croatie).
Premier scrutin depuis l'indépendance, les présidentielles du 2 ao
ût 1992 ont vu la réélection du président
sortant Franjo Tudjman dès le premier tour avec 56,7% des suffrages.
Son parti, le HDZ (Communauté
démocratique croate), est resté la première force du pays avec
une importante majorité parlementaire
(85 sièges sur 136) grâce au mode de scrutin majoritaire.
Figure
de proue de l'opposition, le Parti social
libéral de Drazen Budica (21,8% aux présidentielles) est arrivé
loin derrière, avec 14 sièges.
Le HDZ a
donc continué de contrôler la plus grande partie de l'État et d
es médias, notamment la télévision.
Le gouvernement de Hrovje Sarinic, bras droit du président et devenu
Premier ministre en août 1992 a
cristallisé le mécontentement de l'opinion sur une situation éc
onomique difficile (22,9% d'inflation pour le
seul mois d'avril 1993 et 262 000 chômeurs); les diverses affaires d
e corruption qui ont éclaboussé des
notables du HDZ n'en ont paru que plus scandaleuses.
H.
Sarinic a été
remplacé le 3 avril 1993 par Nikica
Valentic, jeune directeur de l'INA, la compagnie pétrolière nation
ale, présenté comme un spécialiste des
privatisations qui en un an ont concerné quelque 1 627 entreprises po
ur une valeur globale de 12,5
milliards de marks allemands.
Les conséquences de la guerre ont continué de peser lourdement sur
le pays qui a accueilli près de 600
000 réfugiés de Bosnie dont 47% de Musulmans.
Mais les crédits
internationaux, notamment ceux promis
par la CE, sont restés gelés.
Acela s'est ajoutée la menace de
sanctions contre les autorités de Zagreb
accusées, malgré leurs dénégations, de soutenir les forces c
roates de Mate Boban en Herzégovine qui ont
créé une entité étatique et entrepris de faire de la ville d
e Mostar leur capitale, n'hésitant pas à pratiquer
aussi le nettoyage ethnique.
Le président Tudjman et son pouvoir sont
ainsi devenus les otages de ces
éléments les plus durs des Croates bosniaques qui ont bénéfi
cié de longue date du soutien d'une partie
du HDZ..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Tuvalu (1992-1993)
- Turkménistan (1992-1993)
- Trinidad et Tobago (1992-1993)
- Thaïlande (1992-1993): Un pas vers la démocratie
- Sri Lanka (1992-1993)