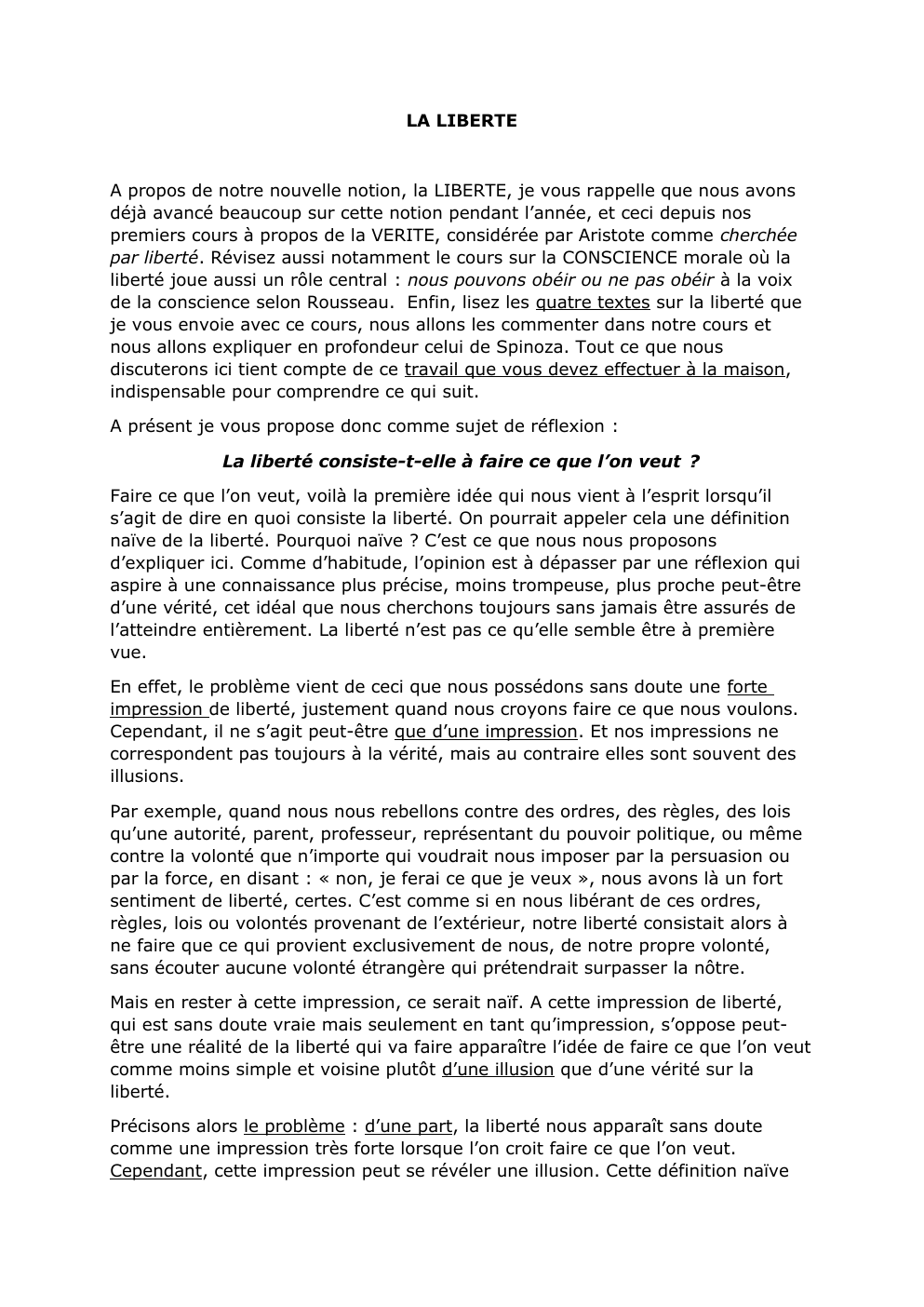Cours sur la liberté
Publié le 22/05/2025
Extrait du document
«
LA LIBERTE
A propos de notre nouvelle notion, la LIBERTE, je vous rappelle que nous avons
déjà avancé beaucoup sur cette notion pendant l’année, et ceci depuis nos
premiers cours à propos de la VERITE, considérée par Aristote comme cherchée
par liberté.
Révisez aussi notamment le cours sur la CONSCIENCE morale où la
liberté joue aussi un rôle central : nous pouvons obéir ou ne pas obéir à la voix
de la conscience selon Rousseau.
Enfin, lisez les quatre textes sur la liberté que
je vous envoie avec ce cours, nous allons les commenter dans notre cours et
nous allons expliquer en profondeur celui de Spinoza.
Tout ce que nous
discuterons ici tient compte de ce travail que vous devez effectuer à la maison,
indispensable pour comprendre ce qui suit.
A présent je vous propose donc comme sujet de réflexion :
La liberté consiste-t-elle à faire ce que l’on veut ?
Faire ce que l’on veut, voilà la première idée qui nous vient à l’esprit lorsqu’il
s’agit de dire en quoi consiste la liberté.
On pourrait appeler cela une définition
naïve de la liberté.
Pourquoi naïve ? C’est ce que nous nous proposons
d’expliquer ici.
Comme d’habitude, l’opinion est à dépasser par une réflexion qui
aspire à une connaissance plus précise, moins trompeuse, plus proche peut-être
d’une vérité, cet idéal que nous cherchons toujours sans jamais être assurés de
l’atteindre entièrement.
La liberté n’est pas ce qu’elle semble être à première
vue.
En effet, le problème vient de ceci que nous possédons sans doute une forte
impression de liberté, justement quand nous croyons faire ce que nous voulons.
Cependant, il ne s’agit peut-être que d’une impression.
Et nos impressions ne
correspondent pas toujours à la vérité, mais au contraire elles sont souvent des
illusions.
Par exemple, quand nous nous rebellons contre des ordres, des règles, des lois
qu’une autorité, parent, professeur, représentant du pouvoir politique, ou même
contre la volonté que n’importe qui voudrait nous imposer par la persuasion ou
par la force, en disant : « non, je ferai ce que je veux », nous avons là un fort
sentiment de liberté, certes.
C’est comme si en nous libérant de ces ordres,
règles, lois ou volontés provenant de l’extérieur, notre liberté consistait alors à
ne faire que ce qui provient exclusivement de nous, de notre propre volonté,
sans écouter aucune volonté étrangère qui prétendrait surpasser la nôtre.
Mais en rester à cette impression, ce serait naïf.
A cette impression de liberté,
qui est sans doute vraie mais seulement en tant qu’impression, s’oppose peutêtre une réalité de la liberté qui va faire apparaître l’idée de faire ce que l’on veut
comme moins simple et voisine plutôt d’une illusion que d’une vérité sur la
liberté.
Précisons alors le problème : d’une part, la liberté nous apparaît sans doute
comme une impression très forte lorsque l’on croit faire ce que l’on veut.
Cependant, cette impression peut se révéler une illusion.
Cette définition naïve
2
doit alors être soumise à examen.
Et cela pour trois raisons, trois soupçons que
nous devons explorer.
Tout d’abord, en morale, faire ce que l’on veut peut conduire, paradoxalement,
au contraire de la liberté, à devenir esclaves de nous-même, de nos désirs (voir
cours sur le DESIR).
Deuxièmement, en politique, si chacun fait ce qu’il veut en société, nous
trouvons un nouveau paradoxe : la liberté s’autodétruit à cause du chaos
résultant du heurt des libertés des uns et des autres.
Enfin, une troisième dimension de la liberté que nous allons appeler, nous
verrons pourquoi, métaphysique, semble également nous obliger à repenser la
définition naïve.
Faire ce que l’on veut correspond peut-être à une liberté
possible, mais celle-ci suppose, troisième paradoxe, de se libérer de l’illusion de
la liberté comme faire ce que l’on veut.
C’est fort étrange, à expliquer !
I) Certes, la liberté consiste à faire ce que l’on veut au sens courant de
cette expression, mais seulement à première vue, parce qu’au fond ce
comportement nous rend au contraire esclave de nos désirs.
a) La définition naïve de liberté provient de l’impression de liberté que
l’on éprouve à faire ou imaginer faire tout ce que l’on veut.
Reprenons donc pour commencer l’impression de liberté la plus naïve et
évidente, et encore la plus réelle en tant qu’impression : on se sent libre quand
l’on peut faire ce que l’on veut.
Sans écouter ni règles ni préceptes moraux, ni
lois ni personne, cette situation ressemble presque à un rêve où tous nos désirs
nous guideraient dans une recherche effrénée de ce qui nous donne envie, de ce
qui nous tente, sans aucune réserve, censure, sentiment d’inhibition, de
transgression, de péché ou de culpabilité.
La liberté consisterait alors à pouvoir
agir comme si la conscience morale n’existait pas, ou au moins, comme si on
pouvait la réduire à un mutisme temporaire ou définitif.
Voici une expérience de
pensée, une situation que nous pouvons concevoir et analyser, même si dans la
réalité elle peut bien être impossible à expérimenter.
C’est pourquoi intervient ici
le mythe.
PLAT0N, au livre II de sa République, nous raconte le mythe de
l’anneau de Gygès, quelqu’un qui serait en possession d’un anneau qui le rend
invisible et lui permettrait ainsi de commettre le mal impunément.
Serait-il
amené à assouvir tous les désirs que seule la peur du châtiment le retenait
jusqu’alors de réaliser sans aucun frein ? Ou bien écouterait-il tout de même une
voix intérieure, sa conscience morale, ce témoin qui voit toujours ce qui peut
rester invisible aux autres ? Nous nous rendons compte que faire ce que l’on
veut en ce sens-là équivaut à se libérer de la conscience morale, comme si la
morale, la notion du DEVOIR, nous empêchaient d’être libres et d’atteindre le
BONHEUR en réalisant tous nos DESIRS.
b) Mais le rêve de liberté en faisant ce que l’on veut mène à son
contraire, l’esclavage.
Cependant, nous l’avons vu quand nous avons traité le désir : en fait le rapport
entre DESIR, LIBERTE et BONHEUR est tout autre dès qu’on l’examine de plus
près.
Pourquoi ? C’est qu’écouter ses désirs sans réserve mène forcément à tout
3
le contraire de la liberté.
L’illusion d’atteindre le bonheur par la réalisation
débridée de tous nos désirs mène facilement, non pas à la liberté, mais à
l’esclavage.
Voilà un excellent exemple du proverbe déjà commenté : Perversio
optimi pessima (« la perversion du meilleur donne le pire »).
Si nous cherchons
le bonheur sans sagesse, les désirs, au lieu de nous fournir la liberté promise,
nous plongent dans un esclavage par rapport à nous-même, ou si l’on veut, à la
partie de nous-même qui échappe, en partie, à notre contrôle rationnel, au
corps, à l’animalité en nous-même.
C’est pourquoi EPICTETE, dans le texte
commenté la dernière fois en classe virtuelle, nous rappelle, avec les autres
Stoïciens en général, que sans liberté nous ne pouvons pas être heureux et que
la liberté exige d’être maître de soi, définition stoïcienne de la liberté morale.
c) Toutefois, la liberté consiste bien à faire ce que l’on veut si on entend
ici le verbe vouloir au sens fort et propre de « volonté », et non pas au
sens affaibli et habituel de purement « désirer ».
A présent nous sommes à même de reconnaître que la liberté ne consiste pas à
faire ce que l’on « veut » au sens où vouloir équivaudrait à désirer.
Nous
pensons ici au désir associé aux instincts et non pas au désir comme une
dimension profonde de nous-même revendiquée surtout par la pensée
contemporaine.
Il est évident que se laisser tirailler par toutes les tentations
n’est pas un état libre.
Au contraire, si nous accordons au terme vouloir le sens
fort de volonté, alors la liberté consiste bien, certes, à mettre en œuvre notre
volonté, qui est plus que le désir, pour réaliser ce que notre liberté a choisi et se
propose d’accomplir : « Je le veux, je le ferai ».
Quelle est la clé pour
comprendre cette idée ? Elle est double :
1.
La première clé : révisez la distinction conceptuelle déjà étudiée entre
« désir » et « volonté ».
Cette dernière, rappelez-vous, peut être définie
comme un désir auquel s’ajoute la raison (Cicéron et les Stoïciens : « désir
raisonné »).
Celui qui désire peut désirer tout et n’importe quoi sans se
donner les moyens d’obtenir l’objet de ses désirs (velléité) ; mais celui qui
veut véritablement, celui-là est déjà sur le chemin d’obtenir parce qu’il
réfléchit, applique sa raison, se donne les moyens d’obtenir l’objet.
Désirer
une mention très bien au Bac sans travailler, c’est purement désirer ; mais
si on fait des efforts réfléchis pour l’obtenir, cela s’appelle vouloir.
2.
La deuxième clé : nous présupposons ici que nous nous identifions à ce
qu’on a pu concevoir comme la partie rationnelle en nous, parce que c’est
nous-même qui raisonnons quand nous pensons et réfléchissons à nos
actions ; par contre, le corps agit et décide en grande partie
indépendamment de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre 1 : Mers et océans : au cœur de la mondialisation Cours 2 : Entre appropriation, protection et liberté de circulation
- La liberté - cours : l'homme dispose t il des moyens pour accéder à la liberté ?
- Cours 4 philo morale et politique: Descartes et la liberté d'indifférence
- La liberté (résumé de cours)
- QUESTIONS DE COURS LA VOLONTÉ - LA LIBERTÉ