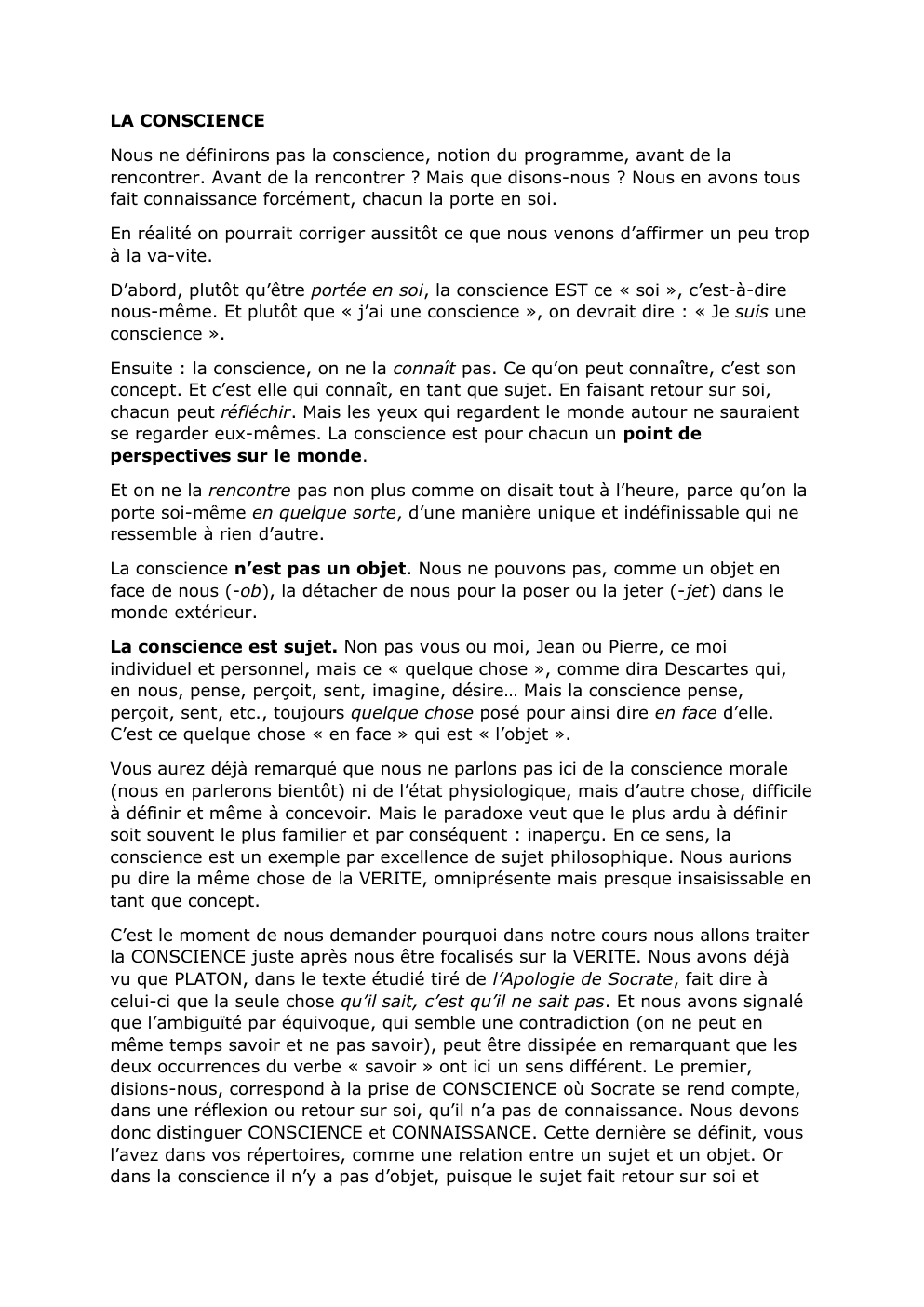Cours conscience
Publié le 22/05/2025
Extrait du document
«
LA CONSCIENCE
Nous ne définirons pas la conscience, notion du programme, avant de la
rencontrer.
Avant de la rencontrer ? Mais que disons-nous ? Nous en avons tous
fait connaissance forcément, chacun la porte en soi.
En réalité on pourrait corriger aussitôt ce que nous venons d’affirmer un peu trop
à la va-vite.
D’abord, plutôt qu’être portée en soi, la conscience EST ce « soi », c’est-à-dire
nous-même.
Et plutôt que « j’ai une conscience », on devrait dire : « Je suis une
conscience ».
Ensuite : la conscience, on ne la connaît pas.
Ce qu’on peut connaître, c’est son
concept.
Et c’est elle qui connaît, en tant que sujet.
En faisant retour sur soi,
chacun peut réfléchir.
Mais les yeux qui regardent le monde autour ne sauraient
se regarder eux-mêmes.
La conscience est pour chacun un point de
perspectives sur le monde.
Et on ne la rencontre pas non plus comme on disait tout à l’heure, parce qu’on la
porte soi-même en quelque sorte, d’une manière unique et indéfinissable qui ne
ressemble à rien d’autre.
La conscience n’est pas un objet.
Nous ne pouvons pas, comme un objet en
face de nous (-ob), la détacher de nous pour la poser ou la jeter (-jet) dans le
monde extérieur.
La conscience est sujet.
Non pas vous ou moi, Jean ou Pierre, ce moi
individuel et personnel, mais ce « quelque chose », comme dira Descartes qui,
en nous, pense, perçoit, sent, imagine, désire… Mais la conscience pense,
perçoit, sent, etc., toujours quelque chose posé pour ainsi dire en face d’elle.
C’est ce quelque chose « en face » qui est « l’objet ».
Vous aurez déjà remarqué que nous ne parlons pas ici de la conscience morale
(nous en parlerons bientôt) ni de l’état physiologique, mais d’autre chose, difficile
à définir et même à concevoir.
Mais le paradoxe veut que le plus ardu à définir
soit souvent le plus familier et par conséquent : inaperçu.
En ce sens, la
conscience est un exemple par excellence de sujet philosophique.
Nous aurions
pu dire la même chose de la VERITE, omniprésente mais presque insaisissable en
tant que concept.
C’est le moment de nous demander pourquoi dans notre cours nous allons traiter
la CONSCIENCE juste après nous être focalisés sur la VERITE.
Nous avons déjà
vu que PLATON, dans le texte étudié tiré de l’Apologie de Socrate, fait dire à
celui-ci que la seule chose qu’il sait, c’est qu’il ne sait pas.
Et nous avons signalé
que l’ambiguïté par équivoque, qui semble une contradiction (on ne peut en
même temps savoir et ne pas savoir), peut être dissipée en remarquant que les
deux occurrences du verbe « savoir » ont ici un sens différent.
Le premier,
disions-nous, correspond à la prise de CONSCIENCE où Socrate se rend compte,
dans une réflexion ou retour sur soi, qu’il n’a pas de connaissance.
Nous devons
donc distinguer CONSCIENCE et CONNAISSANCE.
Cette dernière se définit, vous
l’avez dans vos répertoires, comme une relation entre un sujet et un objet.
Or
dans la conscience il n’y a pas d’objet, puisque le sujet fait retour sur soi et
devient pour ainsi dire un objet pour lui-même, sans être aucunement un objet
pour autant.
(Sujet Bac : « Peut-on se connaître soi-même » ; la clé consiste ici
à distinguer justement conscience et connaissance.)
Mais retenons ceci : pour chercher la VERITE, la première condition selon le
Socrate de Platon, consiste en cette prise de CONSCIENCE.
Nous devons
approfondir le rapport entre ces deux notions.
Remarquons tout d’abord que la vérité existe, est toujours là pour ainsi dire,
indépendamment de toute conscience qui puisse l’apercevoir : deux et deux font
toujours quatre et la terre est toujours ronde même s’il n’y avait aucune
conscience pour le savoir.
C’est l’état d’ignorance : je ne sais pas que je ne sais
pas.
Ensuite, la prise de conscience socratique nous mène plus près de la vérité
recherchée.
En effet, celui qui sait qu’il ne sait pas, sans sortir de l’ignorance
totale, n’est plus dans l’erreur qui consiste à croire savoir alors qu’on ne sait pas,
caractéristique comme on l’a vu de l’opinion, ce cache-misère de l’ignorance, un
état dans lequel nous vivons tous la plupart du temps, aussi bien dans la vie
quotidienne qu’aux moments des grands choix de notre vie.
Enfin, savoir et savoir que l’on sait, ce serait la situation ou nous réussissons à
saisir une vérité tout en en ayant conscience.
(Remarquons que la quatrième
possibilité : savoir et ne pas savoir que l’on sait, correspondrait à la notion
d’INCONSCIENT, que nous allons étudier plus tard.)
Nous avons donc dans ce jeu de cache-cache entre la CONSCIENCE et la VERITE
(rappelez-vous ARISTOTE, Métaphysique A, 1, texte étudié : « tous les hommes
désirent par nature savoir ») :
1.
Une vérité sans conscience (situation qui pose le problème de comparer
vérité et réalité) ;
2.
La conscience comme point de départ nécessaire dans la recherche de la
vérité ;
3.
Le point d’arrivée du désir humain de vérité, l’accomplissement de la
recherche, où la vérité est acquise et où nous en avons conscience.
(Les élèves forts en dessin peuvent tenter ici une bande dessinée explicative.
A
vos cahiers de brouillon !)
Or, voici ma proposition sidérante : peut-on poser la CONSCIENCE pas
seulement comme un point de départ, mais en elle-même comme une forme de
VERITE et une sorte de vérité par excellence, le modèle de toute vérité ?
Autrement dit :
En quel sens peut-on dire que la conscience est une vérité ?
C’est ici que nous allons voir comment DESCARTES, Discours de la méthode, IV,
semble proposer quelque chose dans ce genre : la conscience serait la vérité
parfaite et absolue.
Bref, nous allons étudier le texte où Descartes pose son
célèbre :
« Je pense donc je suis » (en latin : Cogito ergo sum).
(Vous avez déjà ce texte en photocopie ou sur le cahier de textes.)
DESCARTES, Discours de la méthode, IV
Vous savez déjà que le plus important est de trouver un problème et d’expliquer
celui-ci ainsi que la thèse (solution au problème) proposée par le texte.
N’exposez jamais, dans une explication de texte, l’histoire de la philosophie pour
elle-même.
Cependant, ici en classe, aborder rapidement certains aspects du
contexte historique dans lequel Descartes élabore sa philosophie peut s’avérer
utile pour comprendre justement le problème et la thèse du texte.
Sans doute
l’un des textes les plus célèbres de toute la philosophie a-t-il reçu une infinité
d’interprétations.
Nous avons choisi ici une manière parmi cette infinité
d’approches, en fonction des besoins de notre cours.
Vous devez vous focaliser
sur l’enchaînement des problèmes que nous traitons ici et en l’occurrence, sur le
rapport entre VERITE et CONSCIENCE.
Avant l’explication, quelques éléments historiques
Soyons brefs.
Descartes, philosophe et mathématicien, l’un des plus grands
penseurs de tous les temps, fondateur de la science moderne, a ouvert la voie à
la modernité dans l’histoire des idées.
Rien ne sera plus pareil après Descartes.
Il
a vécu, au milieu du XVIIe siècle (situez toujours chaque auteur mentionné dans
le tableau chronologique distribué en classe ou dans celui du manuel), un
moment charnière, un moment de crise de la science et des idées philosophiques
à la base de la science.
Nous allons simplifier beaucoup : avant lui, le Moyen-Age
dominé par la scolastique, une philosophie qui suit dogmatiquement deux
autorités, Aristote et la Bible.
Après lui, la science moderne qui, après les
découvertes apportées par le recours à l’expérience, va devenir jusqu’à
aujourd’hui, une science basée tout entière sur les mathématiques.
Et la
philosophie pour sa part sera dominée fortement par le problème de la
CONSCIENCE.
Nous avons dit : moment de crise.
Grâce au télescope, par exemple, on
découvrait les tâches solaires.
Que répondait la scolastique à ces savants
révolutionnaires qui commençaient à avoir recours à l’observation au lieu de se
fonder exclusivement sur l’autorité de « ceux qui disent savoir », comme nous
avons lu dans le texte de Russell quand il caractérise le dogmatisme ? Ils disaient
plus ou moins : vous devez vous tromper, le télescope n’apporte pas la VERITE,
celle-ci ne peut provenir que d’Aristote ou de la Bible et nulle part n’y est écrit
que le Soleil puisse avoir des taches.
Vous connaissez peut-être le conflit entre
Galilée et l’Eglise (et les aristotéliciens) lorsque le savant a osé affirmer que la
Terre se meut (les idées de Copernic, l’héliocentrisme, contredisaient la science
admise).
Et le savant italien Giordano Bruno a été brulé vif pour avoir soutenu
des idées similaires.
Une crise amène une instabilité : le monde ancien n’est plus soutenable, mais le
monde moderne n’est pas encore suffisamment fondé pour réussir à le
remplacer.
C’est ainsi que Descartes se propose de chercher ceci : une base
philosophique solide, suffisamment ferme pour pouvoir fonder une nouvelle
science… qui sera notre science moderne, celle que vous étudiez et qui est
appliquée par la TECHNIQUE qui transforme notre monde chaque jour.
Explication de texte :....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA CONSCIENCE (résumé de cours de philosophie)
- Cours de philo sur la conscience - Chapitre 1 : Que-ce qu’un sujet ?
- cours conscience
- La conscience (cours de la notion)
- Cours détaillé sur la Conscience et l'inconscient