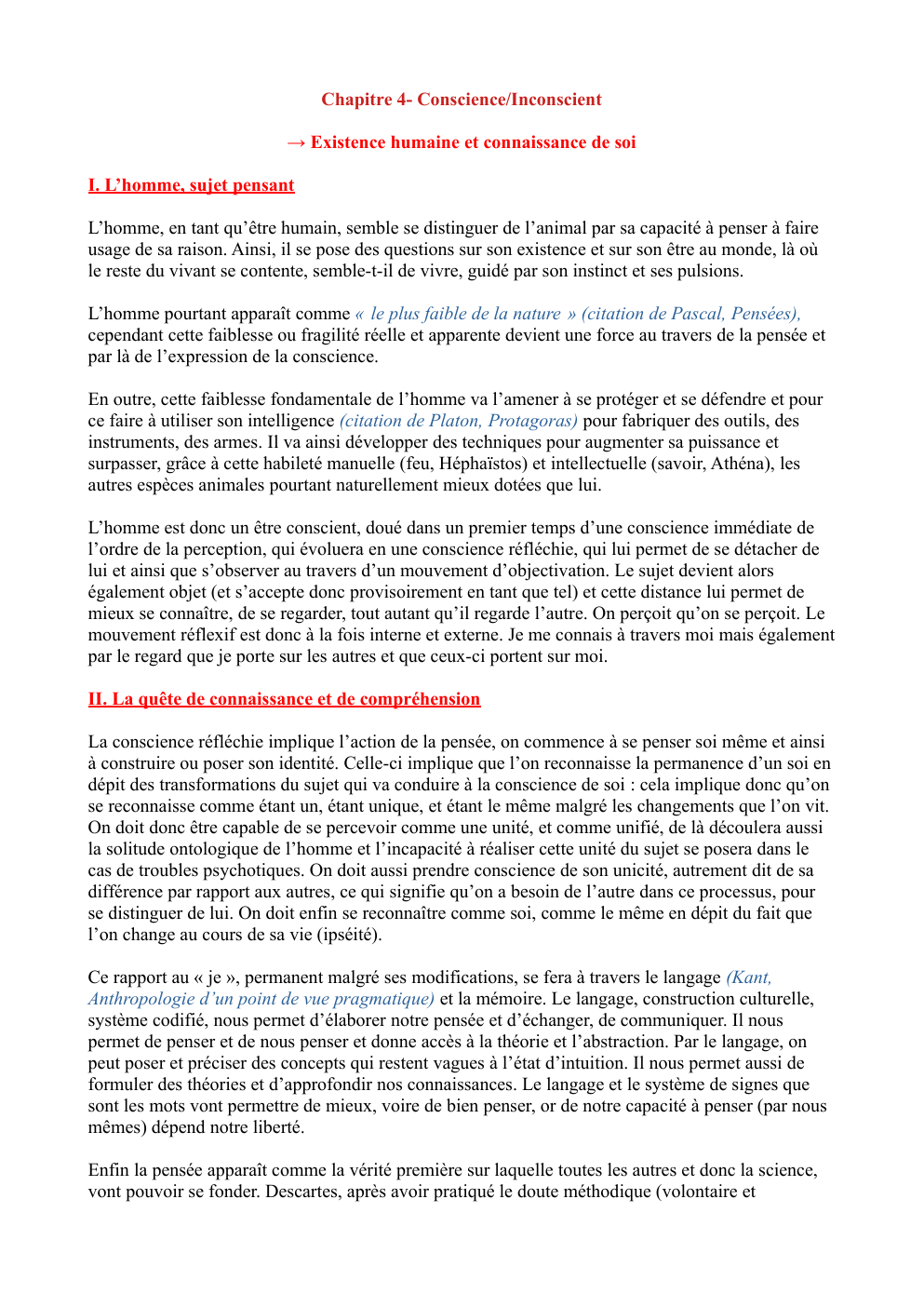connaissance de soi
Publié le 05/03/2025
Extrait du document
«
Chapitre 4- Conscience/Inconscient
→ Existence humaine et connaissance de soi
I.
L’homme, sujet pensant
L’homme, en tant qu’être humain, semble se distinguer de l’animal par sa capacité à penser à faire
usage de sa raison.
Ainsi, il se pose des questions sur son existence et sur son être au monde, là où
le reste du vivant se contente, semble-t-il de vivre, guidé par son instinct et ses pulsions.
L’homme pourtant apparaît comme « le plus faible de la nature » (citation de Pascal, Pensées),
cependant cette faiblesse ou fragilité réelle et apparente devient une force au travers de la pensée et
par là de l’expression de la conscience.
En outre, cette faiblesse fondamentale de l’homme va l’amener à se protéger et se défendre et pour
ce faire à utiliser son intelligence (citation de Platon, Protagoras) pour fabriquer des outils, des
instruments, des armes.
Il va ainsi développer des techniques pour augmenter sa puissance et
surpasser, grâce à cette habileté manuelle (feu, Héphaïstos) et intellectuelle (savoir, Athéna), les
autres espèces animales pourtant naturellement mieux dotées que lui.
L’homme est donc un être conscient, doué dans un premier temps d’une conscience immédiate de
l’ordre de la perception, qui évoluera en une conscience réfléchie, qui lui permet de se détacher de
lui et ainsi que s’observer au travers d’un mouvement d’objectivation.
Le sujet devient alors
également objet (et s’accepte donc provisoirement en tant que tel) et cette distance lui permet de
mieux se connaître, de se regarder, tout autant qu’il regarde l’autre.
On perçoit qu’on se perçoit.
Le
mouvement réflexif est donc à la fois interne et externe.
Je me connais à travers moi mais également
par le regard que je porte sur les autres et que ceux-ci portent sur moi.
II.
La quête de connaissance et de compréhension
La conscience réfléchie implique l’action de la pensée, on commence à se penser soi même et ainsi
à construire ou poser son identité.
Celle-ci implique que l’on reconnaisse la permanence d’un soi en
dépit des transformations du sujet qui va conduire à la conscience de soi : cela implique donc qu’on
se reconnaisse comme étant un, étant unique, et étant le même malgré les changements que l’on vit.
On doit donc être capable de se percevoir comme une unité, et comme unifié, de là découlera aussi
la solitude ontologique de l’homme et l’incapacité à réaliser cette unité du sujet se posera dans le
cas de troubles psychotiques.
On doit aussi prendre conscience de son unicité, autrement dit de sa
différence par rapport aux autres, ce qui signifie qu’on a besoin de l’autre dans ce processus, pour
se distinguer de lui.
On doit enfin se reconnaître comme soi, comme le même en dépit du fait que
l’on change au cours de sa vie (ipséité).
Ce rapport au « je », permanent malgré ses modifications, se fera à travers le langage (Kant,
Anthropologie d’un point de vue pragmatique) et la mémoire.
Le langage, construction culturelle,
système codifié, nous permet d’élaborer notre pensée et d’échanger, de communiquer.
Il nous
permet de penser et de nous penser et donne accès à la théorie et l’abstraction.
Par le langage, on
peut poser et préciser des concepts qui restent vagues à l’état d’intuition.
Il nous permet aussi de
formuler des théories et d’approfondir nos connaissances.
Le langage et le système de signes que
sont les mots vont permettre de mieux, voire de bien penser, or de notre capacité à penser (par nous
mêmes) dépend notre liberté.
Enfin la pensée apparaît comme la vérité première sur laquelle toutes les autres et donc la science,
vont pouvoir se fonder.
Descartes, après avoir pratiqué le doute méthodique (volontaire et
provisoire), fait valoir que seule la pensée résiste à cette remise en cause de tout.
« Je pense donc je
suis », en d’autres termes constater l’existence du mouvement de la pensée confirme notre existence
en tant que sujet.
Nous sommes donc une chose pensante, un sujet pensant (Descartes, Méditations
métaphysiques).
Ce serait donc par l’entremise de la raison que l’on accéderait à la connaissance et
à la vérité, et non, par exemple, grâce aux sens et à l’expérience, comme le considère l’empirisme.
III.
Conscience morale et devoir
Par ailleurs, nous acquérons une conscience morale qui apparaît comme une conséquence de la
conscience réfléchie ainsi que de notre capacité acquise à distinguer le bien du mal.
La conscience
morale correspond alors à notre aptitude à analyser et juger de chacune de nos actions en notre âme
et conscience.
La conscience morale vient de nous et non des autres, même si notre rapport à la
morale et à ce que nous considérons comme moral est induit par notre environnement.
On peut
considérer que de cette conscience morale découle notre culpabilité, la conscience de nos fautes, on
peut aussi y voir un lien avec la religion ou le transcendant par exemple de l’œil de la conscience
(Victor Hugo, « La Conscience » dans La légende des siècles).
Il y aurait donc un rapport entre la
morale et le regard, celui que l’on porte sur soi-même, celui que l’autre porte ou pourrait porter sur
nous.
Si la morale se heure à des critiques en ce qu’elle est considérée comme subjective, relative, Kant
essaie de l’en extraire en posant des règles morales sous la forme d’impératifs catégoriques qui
l’universalise.
Ainsi, pour lui, est moralement bon ce qui peut être universalisé.
Au travers de trois
formulations de ces maximes d’action, Kant pose une philosophie morale où le devoir prévaut
(Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs).
Tout homme se doit d’agir en visant une
cohérence universelle de sorte que son « action soit érigée par [sa] volonté en loi universelle de la
nature », en respectant l’égale dignité de toute personne humaine de sorte qu’il s’astreigne à
« traite[r] l’humanité, aussi bien dans [sa] personne que dans celle de tout autre, toujours comme
une fin, jamais simplement comme un moyen » et en appliquant un principe d’autonomie lui
permettant de se considérer comme l’auteur de la loi morale, qui doit être universalisable.
IV.
L’inconscient, obstacle éclairant
Pourtant, certaines zones d’ombres subsistent dans notre psychisme et certains maux ne peuvent
être expliqués par des causes somatiques, cela amène Freud à poser l’existence d’un inconscient
psychique (Freud, Métapsychologie ), auquel notre conscience n’a pas accès et qui renferme tous
les évènements refoulés, lesquels peuvent se remanifester à notre conscience ou à travers nos rêves
de façon travestie, ce qui implique de les interpréter.
Ce qui sera la tâche du psychanalyste.
La psychanalyse s’organise autour de concepts spécifiques tels que le complexe d’œdipe, le
refoulement, la question du symptôme, la triade névrose-psychose-perversion, l’interprétation des
rêves et d’une pratique ou cure, fondée sur la talking cure qui repose sur la libre association d’idées
et la non-omission.
Freud va représenter métaphoriquement le psychisme humain dans 2 topiques, la première au début
du XXe siècle, la seconde 20 ans plus tard.
Le psychisme....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La connaissance de l'homme ne peut pas s'étendre au-delà de son expérience propre. Locke.
- L'art est-il un mode de connaissance ?
- Géopolitique : l’enjeu de la connaissance
- « Je ne connais rien de plus délectable, a dit Sainte-Beuve, ni de plus profitable pour la connaissance des oeuvres littéraires qu'une biographie bien faite ». Commentez cette opinion.
- Dans quelle mesure le personnage de roman donne-t-il au lecteur un accès privilégié à la connaissance du coeur humain ? Vous répondrez à cette question dans un développement argumenté en vous appuyant sur les textes qui vous sont proposés, ceux que vous avez étudiés en classe et vos lectures personnelles.