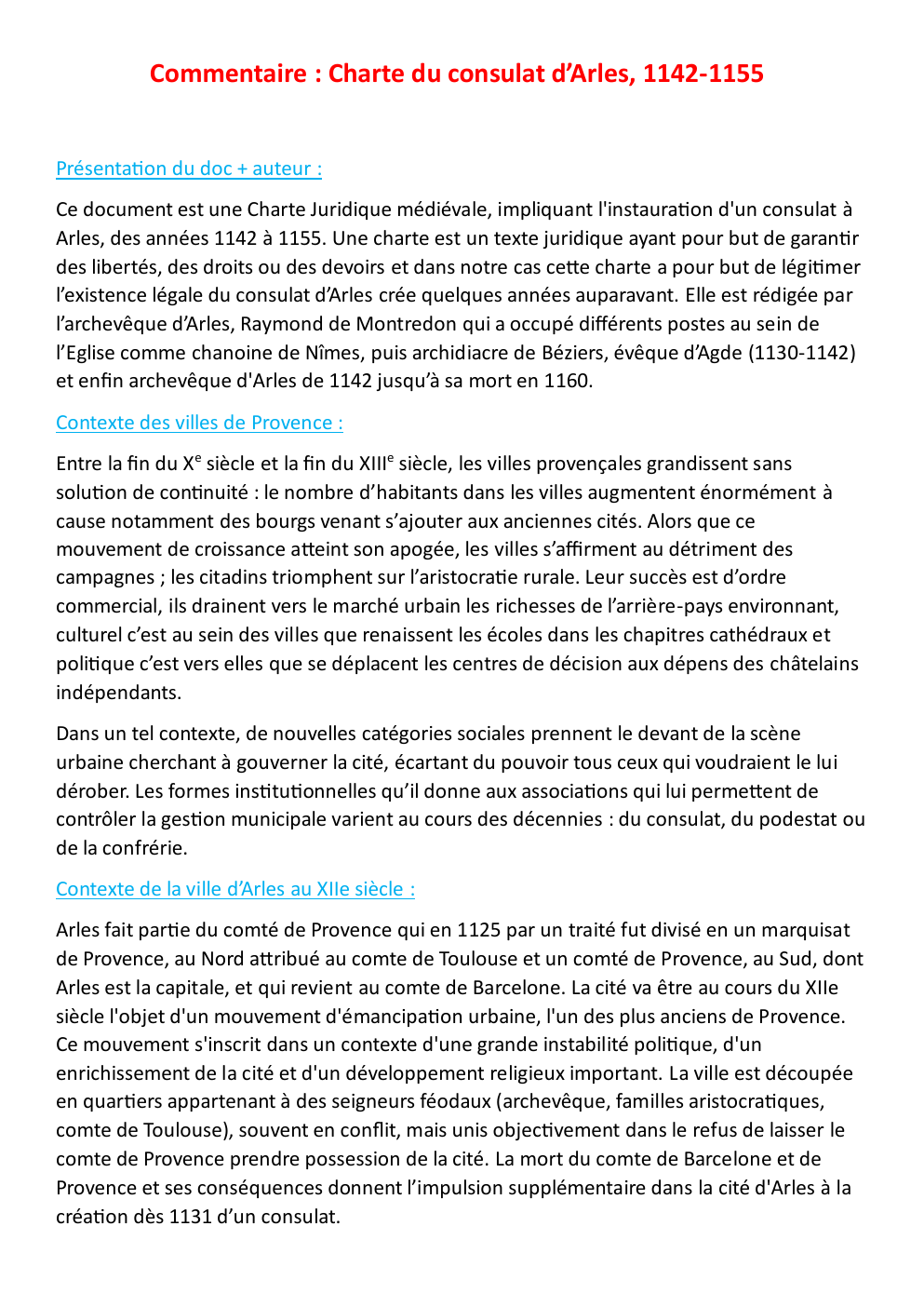commentaire de la charte du consulat d'Arles 1142-1155
Publié le 04/05/2025
Extrait du document
«
Commentaire : Charte du consulat d’Arles, 1142-1155
Présentation du doc + auteur :
Ce document est une Charte Juridique médiévale, impliquant l'instauration d'un consulat à
Arles, des années 1142 à 1155.
Une charte est un texte juridique ayant pour but de garantir
des libertés, des droits ou des devoirs et dans notre cas cette charte a pour but de légitimer
l’existence légale du consulat d’Arles crée quelques années auparavant.
Elle est rédigée par
l’archevêque d’Arles, Raymond de Montredon qui a occupé différents postes au sein de
l’Eglise comme chanoine de Nîmes, puis archidiacre de Béziers, évêque d’Agde (1130-1142)
et enfin archevêque d'Arles de 1142 jusqu’à sa mort en 1160.
Contexte des villes de Provence :
Entre la fin du Xe siècle et la fin du XIIIe siècle, les villes provençales grandissent sans
solution de continuité : le nombre d’habitants dans les villes augmentent énormément à
cause notamment des bourgs venant s’ajouter aux anciennes cités.
Alors que ce
mouvement de croissance atteint son apogée, les villes s’affirment au détriment des
campagnes ; les citadins triomphent sur l’aristocratie rurale.
Leur succès est d’ordre
commercial, ils drainent vers le marché urbain les richesses de l’arrière-pays environnant,
culturel c’est au sein des villes que renaissent les écoles dans les chapitres cathédraux et
politique c’est vers elles que se déplacent les centres de décision aux dépens des châtelains
indépendants.
Dans un tel contexte, de nouvelles catégories sociales prennent le devant de la scène
urbaine cherchant à gouverner la cité, écartant du pouvoir tous ceux qui voudraient le lui
dérober.
Les formes institutionnelles qu’il donne aux associations qui lui permettent de
contrôler la gestion municipale varient au cours des décennies : du consulat, du podestat ou
de la confrérie.
Contexte de la ville d’Arles au XIIe siècle :
Arles fait partie du comté de Provence qui en 1125 par un traité fut divisé en un marquisat
de Provence, au Nord attribué au comte de Toulouse et un comté de Provence, au Sud, dont
Arles est la capitale, et qui revient au comte de Barcelone.
La cité va être au cours du XIIe
siècle l'objet d'un mouvement d'émancipation urbaine, l'un des plus anciens de Provence.
Ce mouvement s'inscrit dans un contexte d'une grande instabilité politique, d'un
enrichissement de la cité et d'un développement religieux important.
La ville est découpée
en quartiers appartenant à des seigneurs féodaux (archevêque, familles aristocratiques,
comte de Toulouse), souvent en conflit, mais unis objectivement dans le refus de laisser le
comte de Provence prendre possession de la cité.
La mort du comte de Barcelone et de
Provence et ses conséquences donnent l’impulsion supplémentaire dans la cité d'Arles à la
création dès 1131 d’un consulat.
Les Arlésiens s'inspirent des villes italiennes Pise et Gênes dont les marchands fréquentent
leur port, et de la ville d’Avignon qui a instauré un consulat deux ans plus
tôt.
D’après Mathieu Louis Anibert, historien arlésien du XVIIIe siècle, le consulat aurait été
créé en réponse à la montée des menaces de conflit entre la Maison des Baux et celle des
comtes de Provence : « Les préparatifs de guerre que faisaient sourdement les seigneurs
des Baux, contre la Maison de Barcelone durent décider les Arlésiens à ce grand
changement, et engager l’archevêque à s’y prêter.
Les circonstances exigeaient qu’on
donnât à la ville des chefs capables de porter les armes au besoin ».
(Extrait du livre
Mémoires historiques et critiques sur l’ancienne République d’Arles en 1779).
Analyse du texte :
Cette charte qui légitime le consulat d’Arles traite des lignes 1 à 8 de l’établissement de ce
consulat, des acteurs qui ont décidé de reconnaitre son existence légale et ce qu’est a
proprement parlé ce consulat.
Des lignes 9 à 19, il est question du rôle des consuls qui sont
à la tête de ce nouveau gouvernement avec la description des pouvoirs qu’ils possèdent, de
qui peut être consul et du mode de désignation.
Des lignes 20 à 33, il est évoqué les
serments que doivent prêter les consuls lors de leur nomination à ce poste.
Problématisation :
Cette charte donne plus de libertés à la ville qui s’administre de manière autonome par
rapport au seigneur avec un nouvelle autorité importante qui est celle des consuls.
Mais
c’est une liberté relative, ce consulat est autorisé par l’archevêque donc un seigneur qui
garde un certain contrôle sur le gouvernement de la ville.
Nous allons donc nous demander
en quoi cette charte légitimant la création du consulat donne une plus grande autonomie à
la ville d’Arles tout en restant sous le contrôle de seigneurs féodaux.
Plan :
Dans une première partie, nous traiterons de ce nouveau type de gouvernement le consulat
et de l’étendue des pouvoirs qu’il possède.
Dans une seconde partie, nous évoquerons la
nouvelle autorité à la tête de la ville, les consuls.
Dans une troisième partie, nous verrons
que la liberté accordée à la ville est une liberté relative, la présence de l’Eglise reste
importante avec notamment le rôle de l’archevêque.
I.
Un nouveau type de gouvernement : le consulat
a) le consulat, un mode de gouvernement spécifique des villes provençales
Le consulat est un mode de gouvernement qui est présent, notamment dans les pays de
langue occitane, des villes ou territoires s'administrant de manière plus ou moins autonome
par rapport au seigneur.
Il est souvent établi dans le cadre d’une charte de franchise
accordé par le seigneur comme nous le montre cette citation de la ligne 5 à 7 « nous
établissons et nous ordonnons de fonder dans la cité et le bourg d’Arles, un consulat,
valable, légal et convenable ».
Le terme consulatus est formé à partir de consul qui veut dire conseil.
Il indique la capacité
d'une communauté d'habitants à délibérer en commun au sein d'une assemblée qui reçoit
également le nom de consulat.
La tradition de liberté du droit romain associée aux régimes
seigneuriaux moins rigoureux du Midi permettent de les distinguer nettement
des communes du Nord (qui élisent des maires et des échevins) ou du sud-ouest (qui élisent
des jurats).
Les agglomérations ayant un consulat peuvent prendre le nom de ville ou de
cité.
Elles peuvent être très importantes et très anciennes, comme Toulouse (où les consuls
ont pris le nom de capitouls) et Montpellier ou très petites.
Elles sont toujours pourvues
d'un marché, et très souvent de foires.
Les limites territoriales de ces consulats englobent
toujours des pâturages, hameaux et terres agricoles associées.
Les consulats nés à la fin du
XIIe siècle et qui ne se maintiennent pas au-delà du milieu du XIIIe siècle, apparaissent pour
la plupart dans des cités épiscopales ou des villes d’une certaine importance.
Il y a une
diffusion de ville en ville d’Ouest en Est à partir d’Arles et d’Avignon en Provence
occidentale.
b) les pouvoirs dont disposent le consulat
Dans les moyennes et grandes villes, le consulat exerçait souvent une fonction
d'administration.
Il s'occupait de la police des rues, des places, des approvisionnements, des
marchés, des métiers, des permis de construire, des poids et mesures, de l'entretien des
murs, des portes, des bâtiments, et des places publiques.
Il possédait un sceau et le droit de
lever une taxe sur certaines denrées entrant dans la ville, de percevoir des loyers pour la
concession de biens ou de droits appartenant à la commune.
Mais il s’occupe
principalement des affaires judiciaires comme le montre ces deux citations de la ligne 9 à
10 : « que chacun, en vérité, dans ce consulat, ait son droit, obtienne justice par la main des
consuls et fasse justice » et de la ligne 14 à 16 : « le gouvernement du consulat étant
accepté, ils auront le pouvoir de juger et de mettre à exécution les jugements, tant au sujet
des héritages que des injures et de tous autres délits ».
Dans les premiers consulats « français », comme dans les consulats italiens qui leur ont servi
de modèle, les consuls ont obtenu une compétence juridictionnelle à peu près complète,
qu’il s’agisse de justice « civile » ou de justice criminelle.
Mais ensuite, au fur et à mesure
que le régime consulaire s’est diffusé, puis s’est intégré dans des structures territoriales plus
vastes (comté de Provence ou royaume de France), le lien originel entre consulat et justice
s’est diversifié.
Si l’on considère l’ensemble des consulats du Midi entre les années 1150 et
la fin du Moyen Âge, l’implication du consulat en tant que tel dans les fonctions judiciaires a
pris des formes extrêmement variables.
Elle se décline en une série de degrés, entre d’une
part la situation la plus favorable, qui est celle où les consuls sont les seuls maîtres d’une
cour municipale jouissant de la plénitude de la juridiction et d’autre part la situation la plus
défavorable, celle où les consuls n’ont aucune part à la justice, celle-ci étant restée une
compétence exclusive du seigneur.
Dans l’hypothèse la plus favorable aux villes par exemple celle des consulats provençaux
jusqu’au début du XIIIe siècle, les consuls rendent seuls la justice dans tous les domaines : ils
disposent à la fois d’une compétence....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire d'Histoire de l'art sur le Galate mourant
- COMMENTAIRE DE TEXTE : “Stances à Marquise”, Pierre Corneille (1658)
- commentaire regrets sur ma vieille robe de chambre diderot
- Commentaire de texte Olympe de Gouges - A partir de « Homme, es tu capable d’être juste ? »
- Commentaire de texte, Bardamu à la guerre de Céline