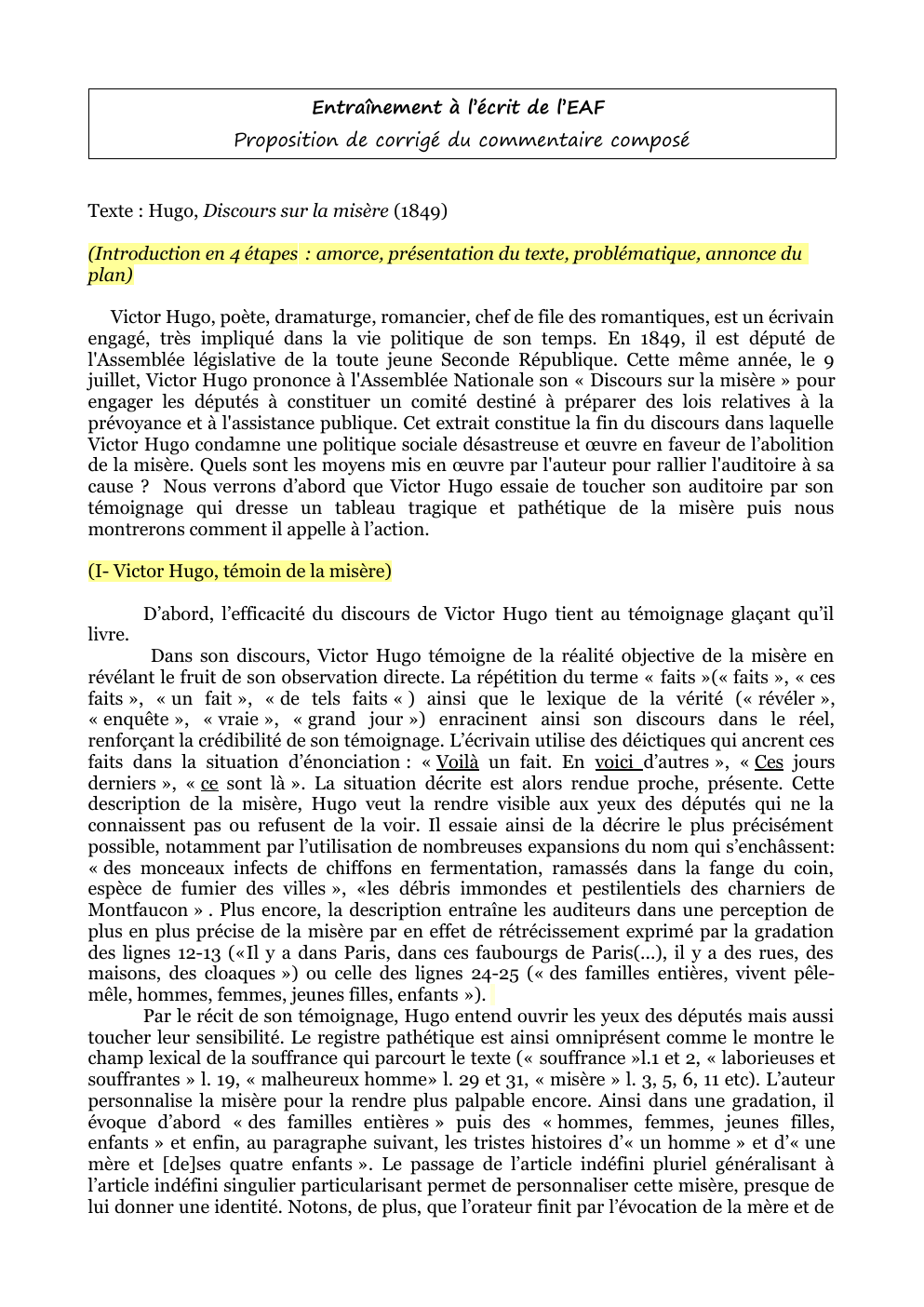Commentaire composé Discours sur la misère Hugo
Publié le 19/01/2024
Extrait du document
«
Entraînement à l’écrit de l’EAF
Proposition de corrigé du commentaire composé
Texte : Hugo, Discours sur la misère (1849)
(Introduction en 4 étapes : amorce, présentation du texte, problématique, annonce du
plan)
Victor Hugo, poète, dramaturge, romancier, chef de file des romantiques, est un écrivain
engagé, très impliqué dans la vie politique de son temps.
En 1849, il est député de
l'Assemblée législative de la toute jeune Seconde République.
Cette même année, le 9
juillet, Victor Hugo prononce à l'Assemblée Nationale son « Discours sur la misère » pour
engager les députés à constituer un comité destiné à préparer des lois relatives à la
prévoyance et à l'assistance publique.
Cet extrait constitue la fin du discours dans laquelle
Victor Hugo condamne une politique sociale désastreuse et œuvre en faveur de l’abolition
de la misère.
Quels sont les moyens mis en œuvre par l'auteur pour rallier l'auditoire à sa
cause ? Nous verrons d’abord que Victor Hugo essaie de toucher son auditoire par son
témoignage qui dresse un tableau tragique et pathétique de la misère puis nous
montrerons comment il appelle à l’action.
(I- Victor Hugo, témoin de la misère)
livre.
D’abord, l’efficacité du discours de Victor Hugo tient au témoignage glaçant qu’il
Dans son discours, Victor Hugo témoigne de la réalité objective de la misère en
révélant le fruit de son observation directe.
La répétition du terme « faits »(« faits », « ces
faits », « un fait », « de tels faits « ) ainsi que le lexique de la vérité (« révéler »,
« enquête », « vraie », « grand jour ») enracinent ainsi son discours dans le réel,
renforçant la crédibilité de son témoignage.
L’écrivain utilise des déictiques qui ancrent ces
faits dans la situation d’énonciation : « Voilà un fait.
En voici d’autres », « Ces jours
derniers », « ce sont là ».
La situation décrite est alors rendue proche, présente.
Cette
description de la misère, Hugo veut la rendre visible aux yeux des députés qui ne la
connaissent pas ou refusent de la voir.
Il essaie ainsi de la décrire le plus précisément
possible, notamment par l’utilisation de nombreuses expansions du nom qui s’enchâssent:
« des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin,
espèce de fumier des villes », «les débris immondes et pestilentiels des charniers de
Montfaucon » .
Plus encore, la description entraîne les auditeurs dans une perception de
plus en plus précise de la misère par en effet de rétrécissement exprimé par la gradation
des lignes 12-13 («Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris(...), il y a des rues, des
maisons, des cloaques ») ou celle des lignes 24-25 (« des familles entières, vivent pêlemêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants »).
Par le récit de son témoignage, Hugo entend ouvrir les yeux des députés mais aussi
toucher leur sensibilité.
Le registre pathétique est ainsi omniprésent comme le montre le
champ lexical de la souffrance qui parcourt le texte (« souffrance »l.1 et 2, « laborieuses et
souffrantes » l.
19, « malheureux homme» l.
29 et 31, « misère » l.
3, 5, 6, 11 etc).
L’auteur
personnalise la misère pour la rendre plus palpable encore.
Ainsi dans une gradation, il
évoque d’abord « des familles entières » puis des « hommes, femmes, jeunes filles,
enfants » et enfin, au paragraphe suivant, les tristes histoires d’« un homme » et d’« une
mère et [de]ses quatre enfants ».
Le passage de l’article indéfini pluriel généralisant à
l’article indéfini singulier particularisant permet de personnaliser cette misère, presque de
lui donner une identité.
Notons, de plus, que l’orateur finit par l’évocation de la mère et de
ses enfants , figures de fragilité et d’innocence, propres à susciter la compassion des plus
endurcis.
Ces deux anecdotes sont l’occasion d’exposer les conditions de vie épouvantables
des miséreux.
L’impact sur les auditeurs est d’autant plus grand que ces récits sont différés
par l’utilisation de points de suspension (« Il y a...
») et les commentaires d’Hugo (lignes
16-20) suscitant un effet d’attente.
Plus encore, les champs lexicaux de la souillure et de la
pourriture utilisés (« monceaux infects », « fermentation », « fange », « fumier »,
« immondes », « pestilentiels », « charniers ») de même que la métaphore de la maladie
(« maladie », « lèpre », « mal », « sonde », « plaies », « choléra ») contribuent à créer une
sensation de dégoût propre à susciter l’empathie de l’auditoire.
Par ce témoignage saisissant, Victor Hugo suscite la pitié mais aussi l’effroi en
présentant la misère comme une fatalité contre laquelle ses victimes ne peuvent pas lutter.
La chiasme des lignes 29-31 symbolise cet enfermement tragique : « un malheureux
homme de lettres » (…) un malheureux homme est mort de faim, mort de faim à la lettre ».
De même, la répétition du nom « misère » en début et en fin de phrase l.11-12 (« La misère,
messieurs, j’aborde ici le vif de la question, voulez-vous savoir où elle en est la misère ? »)
suggère l’impossibilité tragique pour le peuple de sortir de cet état qui l’emprisonne.
Quant
au lexique du mouvement associé à la personnification (« où elle en est », « elle peut
aller », « elle va »), il présente la misère comme une force agissante qui se propage
inéluctablement.
Par contraste, la gradation descendante dans « des rues, des maisons, des
cloaques » l.24 suggère un resserrement progressif comme si l’environnement des
miséreux se restreignait inévitablement jusqu’à les enfermer.
Hugo utilise aussi le registre
fantastique pour renforcer le sentiment d’horreur.
Ainsi, chez les misérables, la frontière
entre la vie et la mort est floue.
Le lexique de la vie et de la mort se côtoient.
Les pauvres
sont associés à des morts-vivants (« des créatures humaines s’enfouissent toutes vivantes
pour échapper au froid de l’hiver »), ou évoluent parmi les cadavres en décomposition
(« une mère et ses quatre enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris
immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon »).
Néanmoins, l’auteur souhaite montrer que la misère n’est pas une donnée
inévitable de l’homme : c’est une maladie sociale qui peut être traitée.
Il compare ainsi la
société à un corps humain et la misère à une maladie : « La misère est une maladie du
corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain ».
Cette analogie est
classique dans la philosophie politique (chez Rousseau, par exemple) qui représente
souvent la société comme un corps dont le souverain est la tête et le peuple les membres.
Mais par la métaphore de la maladie, Hugo suggère aussi que la misère est une altération
du corps social guérissable comme l’affirme la proposition « la misère peut disparaître
comme la lèpre a disparu ».
Si Victor Hugo partage un témoignage glaçant sur les conditions de vie des
misérables, c’est bien pour encourager les députés à l’action.
L’écrivain fait ainsi de ce texte
un « cri »visant à faire évoluer la situation.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire composé 'Chanson' Victor Hugo
- Jersey, Grouville, avril 1855. V. Hugo, Les Contemplations, Pasteurs et troupeaux. Ses agneaux, dans le pré plein de fleurs qui l'encense, Bondissent, et chacun, au soleil s'empourprant, Laisse aux buissons, à qui la bise le reprend, Un peu de sa toison, comme un flocon d'écume. Je passe; enfant, troupeau, s'effacent dans la brume; Le crépuscule étend sur les longs sillons gris Ses ailes de fantôme et de chauve-souris; J'entends encore au loin dans la plaine ouvrière Chanter derrière m
- Commentaire composé - (Les contemplations) – jeune fille, la grâce... de Victor Hugo
- Aimé Césaire - Discours Sur Le Colonialisme: Correction du commentaire composé.
- Victor Hugo, Hernani (1830), Acte I scène 4 (Commentaire composé)