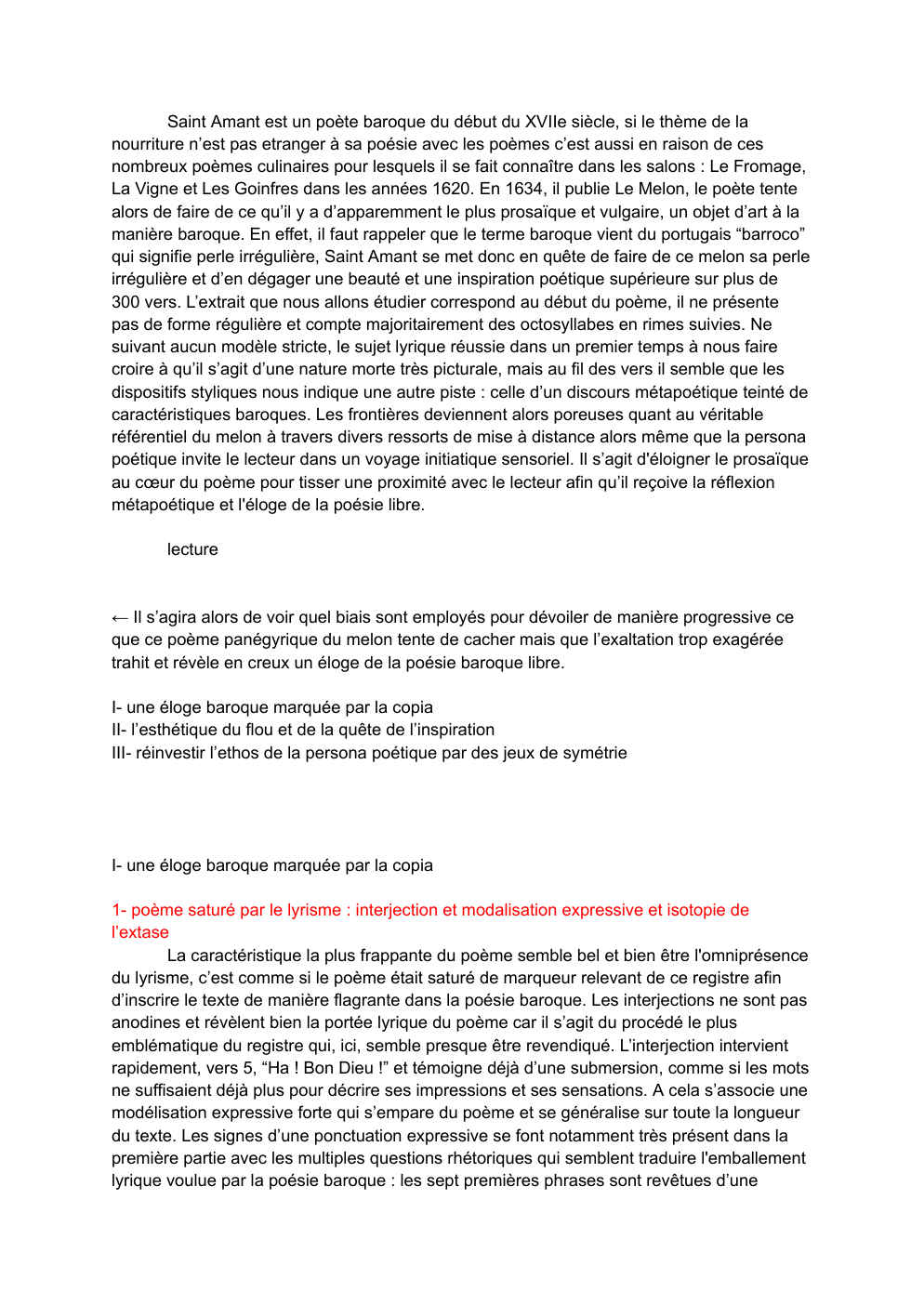analyse stylistique du melon de saint amant
Publié le 19/03/2024
Extrait du document
«
Saint Amant est un poète baroque du début du XVIIe siècle, si le thème de la
nourriture n’est pas etranger à sa poésie avec les poèmes c’est aussi en raison de ces
nombreux poèmes culinaires pour lesquels il se fait connaître dans les salons : Le Fromage,
La Vigne et Les Goinfres dans les années 1620.
En 1634, il publie Le Melon, le poète tente
alors de faire de ce qu’il y a d’apparemment le plus prosaïque et vulgaire, un objet d’art à la
manière baroque.
En effet, il faut rappeler que le terme baroque vient du portugais “barroco”
qui signifie perle irrégulière, Saint Amant se met donc en quête de faire de ce melon sa perle
irrégulière et d’en dégager une beauté et une inspiration poétique supérieure sur plus de
300 vers.
L’extrait que nous allons étudier correspond au début du poème, il ne présente
pas de forme régulière et compte majoritairement des octosyllabes en rimes suivies.
Ne
suivant aucun modèle stricte, le sujet lyrique réussie dans un premier temps à nous faire
croire à qu’il s’agit d’une nature morte très picturale, mais au fil des vers il semble que les
dispositifs styliques nous indique une autre piste : celle d’un discours métapoétique teinté de
caractéristiques baroques.
Les frontières deviennent alors poreuses quant au véritable
référentiel du melon à travers divers ressorts de mise à distance alors même que la persona
poétique invite le lecteur dans un voyage initiatique sensoriel.
Il s’agit d'éloigner le prosaïque
au cœur du poème pour tisser une proximité avec le lecteur afin qu’il reçoive la réflexion
métapoétique et l'éloge de la poésie libre.
lecture
← Il s’agira alors de voir quel biais sont employés pour dévoiler de manière progressive ce
que ce poème panégyrique du melon tente de cacher mais que l’exaltation trop exagérée
trahit et révèle en creux un éloge de la poésie baroque libre.
I- une éloge baroque marquée par la copia
II- l’esthétique du flou et de la quête de l’inspiration
III- réinvestir l’ethos de la persona poétique par des jeux de symétrie
I- une éloge baroque marquée par la copia
1- poème saturé par le lyrisme : interjection et modalisation expressive et isotopie de
l’extase
La caractéristique la plus frappante du poème semble bel et bien être l'omniprésence
du lyrisme, c’est comme si le poème était saturé de marqueur relevant de ce registre afin
d’inscrire le texte de manière flagrante dans la poésie baroque.
Les interjections ne sont pas
anodines et révèlent bien la portée lyrique du poème car il s’agit du procédé le plus
emblématique du registre qui, ici, semble presque être revendiqué.
L’interjection intervient
rapidement, vers 5, “Ha ! Bon Dieu !” et témoigne déjà d’une submersion, comme si les mots
ne suffisaient déjà plus pour décrire ses impressions et ses sensations.
A cela s’associe une
modélisation expressive forte qui s’empare du poème et se généralise sur toute la longueur
du texte.
Les signes d’une ponctuation expressive se font notamment très présent dans la
première partie avec les multiples questions rhétoriques qui semblent traduire l'emballement
lyrique voulue par la poésie baroque : les sept premières phrases sont revêtues d’une
ponctuation expressive qui est par ailleurs renforcée par l’usage de déterminant exclamatif
dès le vers 1 “quelle” et vers 2 “quel”.
Ainsi le poème tend vers l’exaltation de par la
modalisation mais aussi de par le lexique employé.
Il semble que l’isotopie de l’extase serve
aussi le lyrisme dans ce poème avec les références “réjouir” vers 3 placé en rime riche avec
“épanouir” au vers 4.
La prédominance du lyrisme caractéristique de la poésie baroque
contribue à l’exaltation générale et offre un éclairage complet de la nature expressive du
poème l’inscrivant d’office dans la tradition du poème baroque.
2- le développement d’une logique de l’abondance poétique : reprises sonores et
synesthésies corne d’abondance (style cornucopien) : nature (idée d’abondance par
débordement)
A travers ce poème, une réflexion s’ouvre sur la puissance évocatrice de la poésie et sa
capacité à transcender les frontières du langage pour exprimer des expériences sensorielles
riches et profondes.
Lorsque le sujet poétique évoque un paysage sensoriel complexe et
nuancé, où les odeurs se mêlent à la douceur et au plaisir, il invite le lecteur à plonger dans
un monde où les sens sont en éveil constant.
On note une importante variété de
synesthésies qui illustrent le pouvoir conférer à la nature à travers les fleurs, ainsi que la
référence à des éléments sensoriels tels que la pastille et le vin, enrichissent l’expérience
sensorielle du lecteur, plongeant celui- ci dans les sensations et les émotions du sujet
poétique.
La métaphore de « ce panier rempli de vert » donne l’impression d’une corne
d’abondance, symbolisant en somme la fertilité de l’esprit ou de l’âme, évoquant une nature
qui déborde de richesse ainsi que de générosité.
Cette métaphore est en partie renforcée
par l’allitération en -s des vers 17 à 21, créant une douce musicalité, renforcée d’ailleurs par
la répétition du son -è permettant de renforcer la beauté représentée.
D’ailleurs cette
impression est renforcée par les reprises sonores et les rimes riches qui accentuent les
sensations et l’aspect pictural.
Le style cornucopien se développe aussi par le recours à
plusieurs adjectifs antéposés comme « doux parfum », qui s’ajoute à une accumulation
introduite par l’expression : « tous les mets que le désir/ puisse imaginer et choisir » La
construction des phrases met en valeur le cocotier comme source unique et suffisante de
satisfaction et la relative explicative étend la portée de ce que le cocotier représente.
La
syntaxe de l'extrait joue un rôle crucial dans la mise en relief de ses thèmes.
L’utilisation
d’une structure clause qui lie directement le cocotier à sa capacité à satisfaire "tous les mets
que le désir / Puisse imaginer et choisir" établit une relation de cause à effet, soulignant
l'idée d'une source unique de satisfaction qui dépasse l'entendement.
Il se manifeste comme
une source inépuisable qui transcende les limites de l'imaginaire.
La description transforme
le cocotier en une entité invraisemblable, capable de satisfaire tout désir.
L’anaphore de “ni”
nous donne à envisager la nourriture comme quelque chose qui ne cesse de procréer.
Il
s’agit d’un trait du style baroque, qui célèbre les plaisirs simples de la vie et l’abondance des
plaisirs terrestres dans un contexte de profusion et de générosité de la nature.
Cette notion
transcende le simple paysage physique pour englober une richesse sensorielle et
émotionnelle qui déborde de chaque vers et la nature dans sa globalité inspire en ce sens
inspiration et émerveillement.
3- hubris et excès : hyperbole et exagération et accumulation
Il apparaît ainsi presque comme symptomatique que le style soit imprégné par la
notion de l’hubris et d'excès, c’est à dire qu’il semble que tout ce qui est abordé dans le
poème soit envisagé sous l’angle de la démesure qui s’exprime principalement par une
plume hyperbolique.
Le texte s’applique véritablement à rendre compte de l’intensité quitte à
exagérer pour mettre davantage en emphase la jouissance présente.
L’expression
hyperbolique “j’en tombe en extase” illustre bien un usage abusif de la sémantique des
mots.
D’ailleurs on note un recours fréquent à l’adjectif indéfini “toutes” “elle enserre toutes
les aimables vertus” qui a justement une visée englobante d’une totalité, c’est un projet
fondamentalement orgueilleux et révélateur des traces de l’hubris au sein du texte.
La
démesure se dévoile aussi par la longue répétition anaphorique de la conjonction de
coordination négative “ni” sur 10 vers, ce qui nous paraît évidemment trop long pour n’être
qu’une insistance et non pas un marqueur d’exagération, étendant l’ampleur de ce qu’il
décrit, insistant sur l’idée d’une perfection totale et absolue qui englobe tout.
Cette technique
crée un effet d’exhaustivité et de plénitude, renforçant ainsi l’idée de l’excès.
De la même
façon, une majorité de signifiants sont aux pluriels et dont les quantités semblent grossies
“mille plaisant chiffres d’amour” afin d’ajouter une profondeur et une densité extrêmes.Cet
usage de l’exagération permet non seulement l’amplification mais suggère également une
sorte d’élargissement des limites conventionnelles de l’expression, reflétant ainsi l’esprit
extravagant et audacieux de la poésie baroque.
D’autant plus qu’au fur et à mesure, une
certaine théâtralité se dégage de cette nature morte qui est comme mise en scène par une
dramatisation des éléments qui nous apparaît comme incontrôlable avec “tombe”
“travaillant” ← participe présent qui marque la simultanéité
Le Melon se fait donc parfaite reprise du modèle baroque.
II- l’esthétique du flou et de la quête de l’inspiration
1- dispositif de retardement : question et la monté crescendo du suspense (surtout au début)
Afin de maintenir l'intérêt du lecteur, le menant progressivement vers la révélation finale, le
sujet poétique passe par divers effets de style.
La série initiale d'interrogations permettant le
commencement du poème engage le lecteur dans une quête olfactive mystérieuse, chaque
question se construisant sur la précédente pour intensifier la curiosité et l'expectative.
Ce
procédé interrogatif, crée une dynamique de recherche et d'anticipation qui capte l'attention
du lecteur dès les premières lignes.
Cette série de questions rhétoriques qui se déplient
avec « Quelle odeur....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ANALYSE LINéAIRE Extrait de Terre des hommes, d’Antoine de Saint-Exupéry, 1939
- L'amant de Duras (analyse et résumé)
- MARC-ANTOINE GIRARD, SIEUR DE SAINT-AMANT
- VENTS. Poème de Saint-John Perse (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- ANONYMEdu Scriptorium de Winchester:Saint Eustache (analyse).