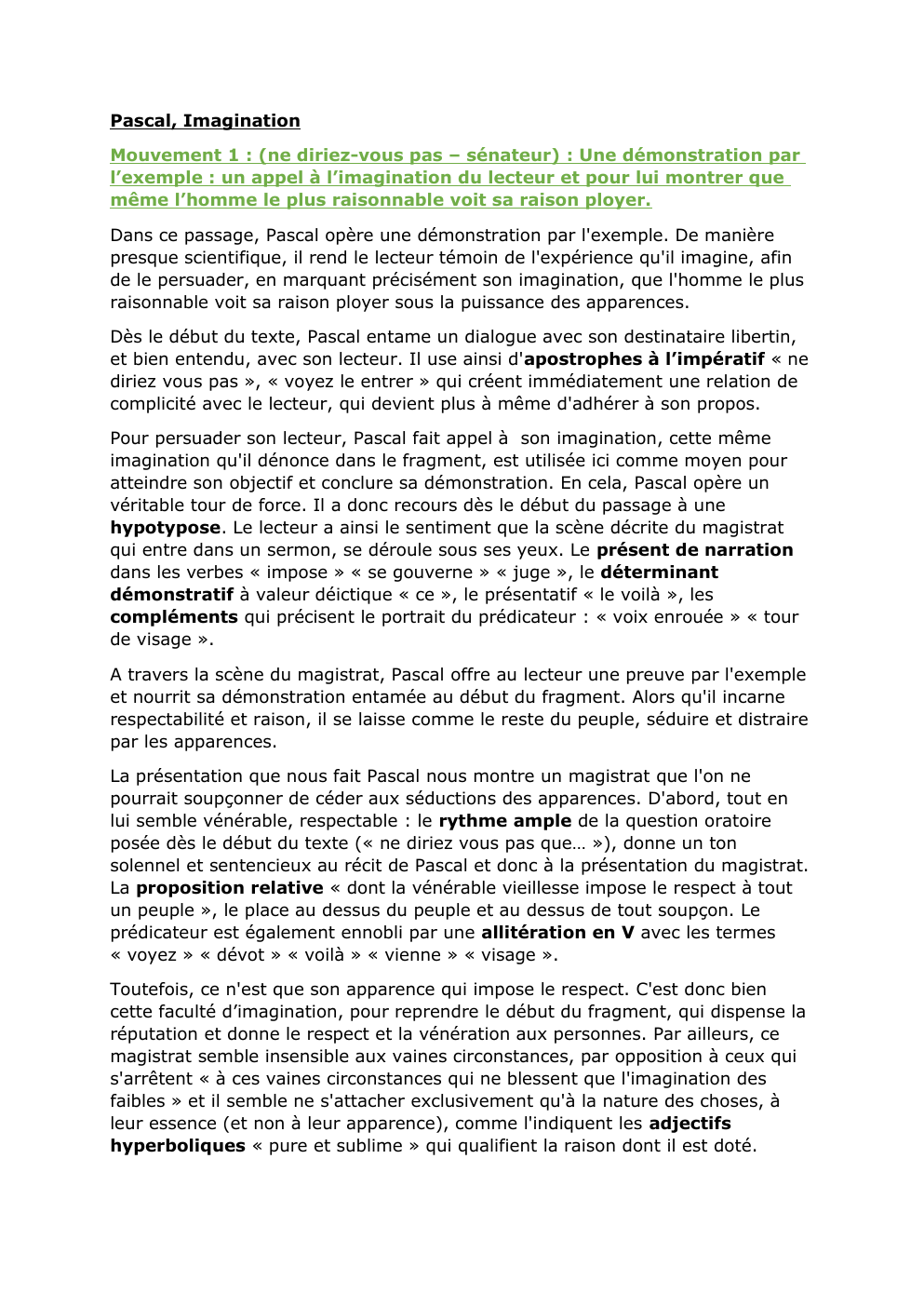analyse linéaire pascal Imagination
Publié le 21/07/2025
Extrait du document
«
Pascal, Imagination
Mouvement 1 : (ne diriez-vous pas – sénateur) : Une démonstration par
l’exemple : un appel à l’imagination du lecteur et pour lui montrer que
même l’homme le plus raisonnable voit sa raison ployer.
Dans ce passage, Pascal opère une démonstration par l'exemple.
De manière
presque scientifique, il rend le lecteur témoin de l'expérience qu'il imagine, afin
de le persuader, en marquant précisément son imagination, que l'homme le plus
raisonnable voit sa raison ployer sous la puissance des apparences.
Dès le début du texte, Pascal entame un dialogue avec son destinataire libertin,
et bien entendu, avec son lecteur.
Il use ainsi d'apostrophes à l’impératif « ne
diriez vous pas », « voyez le entrer » qui créent immédiatement une relation de
complicité avec le lecteur, qui devient plus à même d'adhérer à son propos.
Pour persuader son lecteur, Pascal fait appel à son imagination, cette même
imagination qu'il dénonce dans le fragment, est utilisée ici comme moyen pour
atteindre son objectif et conclure sa démonstration.
En cela, Pascal opère un
véritable tour de force.
Il a donc recours dès le début du passage à une
hypotypose.
Le lecteur a ainsi le sentiment que la scène décrite du magistrat
qui entre dans un sermon, se déroule sous ses yeux.
Le présent de narration
dans les verbes « impose » « se gouverne » « juge », le déterminant
démonstratif à valeur déictique « ce », le présentatif « le voilà », les
compléments qui précisent le portrait du prédicateur : « voix enrouée » « tour
de visage ».
A travers la scène du magistrat, Pascal offre au lecteur une preuve par l'exemple
et nourrit sa démonstration entamée au début du fragment.
Alors qu'il incarne
respectabilité et raison, il se laisse comme le reste du peuple, séduire et distraire
par les apparences.
La présentation que nous fait Pascal nous montre un magistrat que l'on ne
pourrait soupçonner de céder aux séductions des apparences.
D'abord, tout en
lui semble vénérable, respectable : le rythme ample de la question oratoire
posée dès le début du texte (« ne diriez vous pas que… »), donne un ton
solennel et sentencieux au récit de Pascal et donc à la présentation du magistrat.
La proposition relative « dont la vénérable vieillesse impose le respect à tout
un peuple », le place au dessus du peuple et au dessus de tout soupçon.
Le
prédicateur est également ennobli par une allitération en V avec les termes
« voyez » « dévot » « voilà » « vienne » « visage ».
Toutefois, ce n'est que son apparence qui impose le respect.
C'est donc bien
cette faculté d’imagination, pour reprendre le début du fragment, qui dispense la
réputation et donne le respect et la vénération aux personnes.
Par ailleurs, ce
magistrat semble insensible aux vaines circonstances, par opposition à ceux qui
s'arrêtent « à ces vaines circonstances qui ne blessent que l'imagination des
faibles » et il semble ne s'attacher exclusivement qu'à la nature des choses, à
leur essence (et non à leur apparence), comme l'indiquent les adjectifs
hyperboliques « pure et sublime » qui qualifient la raison dont il est doté.
Enfin, sa piété est un autre gage de sagesse, puisqu'il apparaît comme un
modèle de vertu, entrant au sermon avec « un zèle tout dévot ».
Cependant, le
choix de l'adjectif qualificatif « dévot », souvent employé dans un sens
péjoratif, laisse poindre l'ironie de Pascal, et laisse deviner la chute de la
saynète racontée.
En effet, par ce choix, l'auteur dénonce tout en subtilité une
religiosité ostentatoire, qui joue le jeu de l'apparence précisément.
Toutes ces raisons énoncées renforcent l'exemple choisi par Pascal.
Le magistrat
a toutes les qualités présumées pour rester maître de son esprit et de sa raison.
Mais devant l'éventualité de raisons insignifiantes, toutes ces qualités ne font pas
le poids.
La proposition subordonnée circonstancielle de temps au subjonctif « que
le prédicateur vienne à paraître...
», permet une entrée abrupte, théâtralisée de
notre prédicateur, un peu comme un élément perturbateur d'une saynète, sur le
point d'advenir, et de faire basculer le récit vers une suite inattendue.
L'enchainement de deux propositions subordonnées circonstancielles
d’hypothèse montre le caractère aléatoire et contingent de ces cas de figures.
Ce sont des éventualités parmi d'autres.
Qu'il s'agisse d'un défaut physique
« tour de visage bizarre », d'un problème de voix ou d'apparence « voix
enrouée », « mal rasé », ces cas se soldent par la même conclusion : le sénateur
perdra de son sérieux, sera distrait par ces vaines circonstances, et n'écoutera
pas.
L'ironie de Pascal s'exprime à travers la tonalité basse, la trivialité des
situations choisies « une barbe mal rasée », une salissure quelconque, qui
contraste avec les « grandes vérités annoncées par le prédicateur » et avec la
raison « pure et sublime » dont le sénateur était affublé au début du paragraphe.
L’ironie s'exprime également à travers le déterminant possessif « notre
sénateur », qui lui ôte cette vénérable respectabilité dont il était auréolé au
début.
Le sénateur perdra donc son sérieux, et cela n'est pas discutable selon Pascal.
La
conviction engagée par le choix du verbe « parie », l'implication de l'auteur à
travers l'emploi du pronom personnel sujet « je » sont des marqueurs de la
certitude de Pascal.
Mouvement 2 : Poursuite de l’entreprise de persuasion : choix de la
figure du philosophe, incarnation de la raison (le plus grand – suer).
Dans les lignes qui suivent, Pascal poursuit son entreprise de persuasion et la
renforce en choisissant cette fois, la figure d'un philosophe.
Si la raison était
affaiblie dans le premier paragraphe, elle signe sa défaite dans le second.
Pascal radicalise ici sa position, et intensifie sa démonstration.
Il prend l'exemple
d'un philosophe, qui par définition, est habitué à exercer sa raison et attaché à
saisir l'essence des choses.
Comment le soupçonner de se laisser dominer par
son imagination ? D'autant que la formule hyperbolique de « plus grand
philosophe du monde », accentue la gradation : on passe du magistrat au
philosophe, cela lui confère une place suprême au dessus de ses confrères.
Cet homme, le plus rationnel qui soit, va pourtant céder à une peur irrationnelle
lorsqu'il éprouve du vertige.
Sa raison, ancrée et solide, vacille pourtant face au
vide, bien que l'auteur prenne soin de préciser à travers la tournure
comparative de supériorité que la planche sur laquelle il est placé est « plus
large qu'il ne faut ».
Pascal emprunte cet exemple à Montaigne, qui dans ses
Essais, livre II, chap.
12, montrait déjà que la raison d'un homme bascule face à
la peur du vide.
Pascal s'empare d'un exemple ancré dans les consciences....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- analyse de texte Pascal, Pensées "Imagination"
- Analyse linéaire des Pensées de Pascal: fragment 41 de la liasse « Vanité »
- Analyse linéaire Théodote, La Bruyère
- Préparation à l’oral du baccalauréat de français Analyse linéaire n°4 - Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, 1990 (épilogue)
- Objet d'étude : La poésie du XIX et du XX siècle. Parcours complémentaire : Alchimie poétique : réinventer le monde. Analyse linéaire 2/2 « Le Pain », Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942