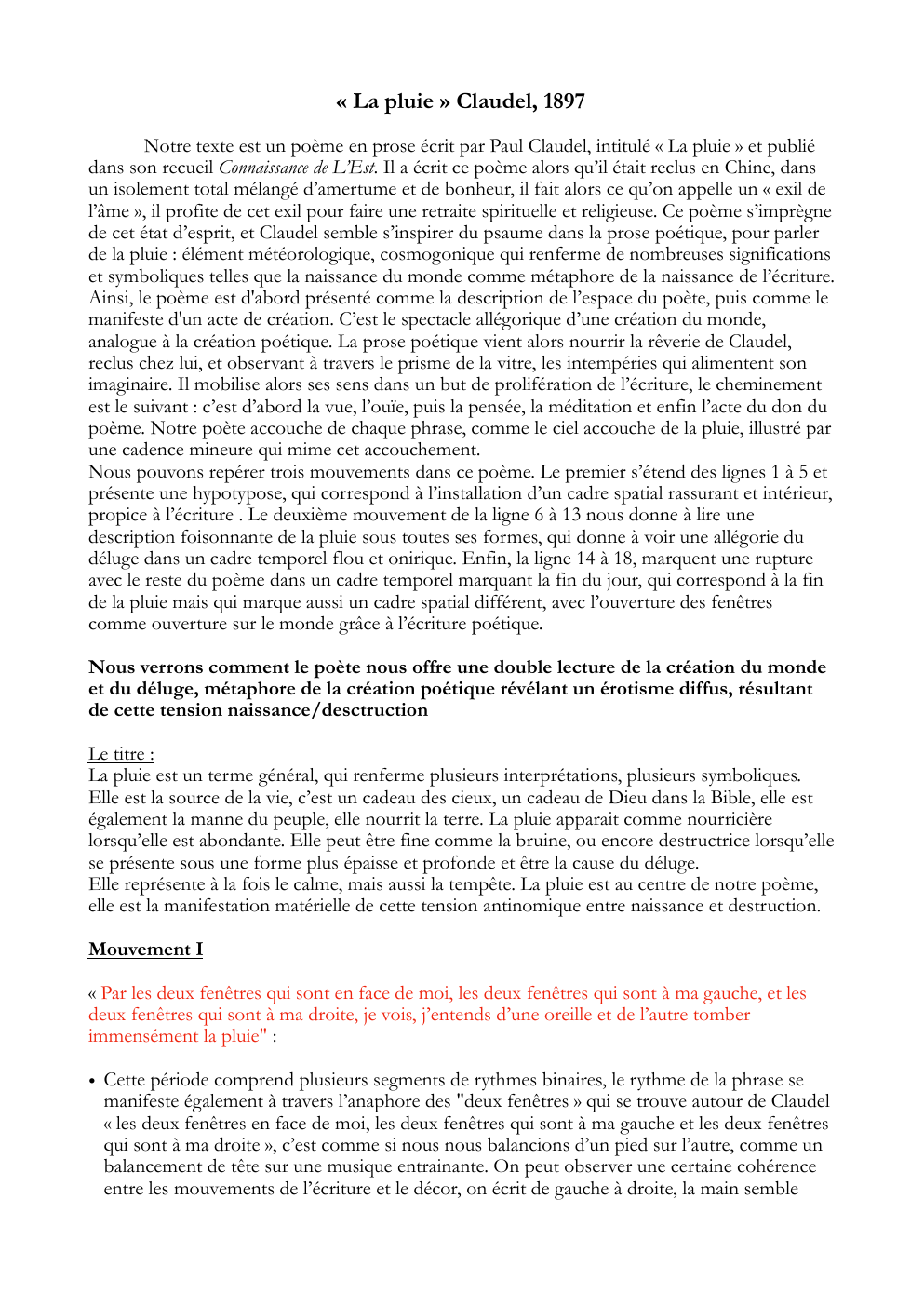Analyse linéaire de Paul Claudel La Pluie
Publié le 02/11/2023
Extrait du document
«
« La pluie » Claudel, 1897
Notre texte est un poème en prose écrit par Paul Claudel, intitulé « La pluie » et publié
dans son recueil Connaissance de L’Est.
Il a écrit ce poème alors qu’il était reclus en Chine, dans
un isolement total mélangé d’amertume et de bonheur, il fait alors ce qu’on appelle un « exil de
l’âme », il profite de cet exil pour faire une retraite spirituelle et religieuse.
Ce poème s’imprègne
de cet état d’esprit, et Claudel semble s’inspirer du psaume dans la prose poétique, pour parler
de la pluie : élément météorologique, cosmogonique qui renferme de nombreuses significations
et symboliques telles que la naissance du monde comme métaphore de la naissance de l’écriture.
Ainsi, le poème est d'abord présenté comme la description de l’espace du poète, puis comme le
manifeste d'un acte de création.
C’est le spectacle allégorique d’une création du monde,
analogue à la création poétique.
La prose poétique vient alors nourrir la rêverie de Claudel,
reclus chez lui, et observant à travers le prisme de la vitre, les intempéries qui alimentent son
imaginaire.
Il mobilise alors ses sens dans un but de prolifération de l’écriture, le cheminement
est le suivant : c’est d’abord la vue, l’ouïe, puis la pensée, la méditation et enfin l’acte du don du
poème.
Notre poète accouche de chaque phrase, comme le ciel accouche de la pluie, illustré par
une cadence mineure qui mime cet accouchement.
Nous pouvons repérer trois mouvements dans ce poème.
Le premier s’étend des lignes 1 à 5 et
présente une hypotypose, qui correspond à l’installation d’un cadre spatial rassurant et intérieur,
propice à l’écriture .
Le deuxième mouvement de la ligne 6 à 13 nous donne à lire une
description foisonnante de la pluie sous toutes ses formes, qui donne à voir une allégorie du
déluge dans un cadre temporel flou et onirique.
Enfin, la ligne 14 à 18, marquent une rupture
avec le reste du poème dans un cadre temporel marquant la fin du jour, qui correspond à la fin
de la pluie mais qui marque aussi un cadre spatial différent, avec l’ouverture des fenêtres
comme ouverture sur le monde grâce à l’écriture poétique.
Nous verrons comment le poète nous offre une double lecture de la création du monde
et du déluge, métaphore de la création poétique révélant un érotisme diffus, résultant
de cette tension naissance/desctruction
Le titre :
La pluie est un terme général, qui renferme plusieurs interprétations, plusieurs symboliques.
Elle est la source de la vie, c’est un cadeau des cieux, un cadeau de Dieu dans la Bible, elle est
également la manne du peuple, elle nourrit la terre.
La pluie apparait comme nourricière
lorsqu’elle est abondante.
Elle peut être fine comme la bruine, ou encore destructrice lorsqu’elle
se présente sous une forme plus épaisse et profonde et être la cause du déluge.
Elle représente à la fois le calme, mais aussi la tempête.
La pluie est au centre de notre poème,
elle est la manifestation matérielle de cette tension antinomique entre naissance et destruction.
Mouvement I
« Par les deux fenêtres qui sont en face de moi, les deux fenêtres qui sont à ma gauche, et les
deux fenêtres qui sont à ma droite, je vois, j’entends d’une oreille et de l’autre tomber
immensément la pluie" :
• Cette période comprend plusieurs segments de rythmes binaires, le rythme de la phrase se
manifeste également à travers l’anaphore des "deux fenêtres » qui se trouve autour de Claudel
« les deux fenêtres en face de moi, les deux fenêtres qui sont à ma gauche et les deux fenêtres
qui sont à ma droite », c’est comme si nous nous balancions d’un pied sur l’autre, comme un
balancement de tête sur une musique entrainante.
On peut observer une certaine cohérence
entre les mouvements de l’écriture et le décor, on écrit de gauche à droite, la main semble
suivre les mouvements physiques du poète dont la tête se balance de gauche à droite pour
observer les fenêtres.
Son ouïe suit le même mouvement : « j’entends d’une oreille et de
l’autre » : c’est toujours un mouvement binaire très musical qui se retrouve dans le décor,
dans les mouvements, et dans les sens.
Le rythme lourd du balancement de tête est analogue à
cette pluie qui tombe immensément : le macrocosme et le microcosme sont en tension.
L’ordre de la phrase est par ailleurs bouleversé en cadence mineure à la manière de Baudelaire
dans « À une passante » : « la rue assourdissante autour de moi hurlait », l’acmée sur « je vois,
j’entends » insiste sur le « je » du poète qui se définit comme un je sensuel, un je sensible.
« Je
vois » : il se définit comme un peintre, « j’entends » ( il a d’ailleurs écrit « Cent phrases pour
Évantails » ) et comme un musicien.
Le poème en prose est une combinaison d’un axe
poétique et descriptif, c’est pour ça qu’on a « je vois et j’entends ».
• Paul Claudel semble dresser une hypotypose de ce qu’il voit, et une chanson de ce qu’il
entend, qu’il retranscrit par l’écriture, tout est art et sensibilité.
Le sommet « je vois,
j’entends » chute sur la clausule de l’apodose « la pluie » qui mime en réalité la pluie qui tombe
immensément, cette chute initiale de la pluie qui tombe du ciel, la pluie qui est d’ailleurs le
titre de notre poème.
La pluie, agent fécondateur de la terre, est symbole des influences
célestes reçues par la terre.
Les rites pour déclencher la pluie sont innombrables.
Mais ce qui
descend du ciel en terre, c'est aussi la fertilité de l'esprit, la lumière, les influences célestes.
• Dans l'union sacrée ciel-terre, la pluie est le sperme fécondant.
La pluie, fille des nuées et de l'orage, réunit les symboles du feu (éclair) et de l'eau.
Elle a donc
une double signification : fertilisation spirituelle et matérielle.
Tombant du ciel, elle exprime
aussi une faveur des dieux, tout aussi spirituelle que matérielle.
D’ailleurs, en Inde, on dit que la
femme féconde est la pluie.
Elle est source de toute prospérité.
En ce sens, elle exprime à la fois la naissance de la Terre mais aussi celle de l’écriture.
• Le cadre spatial est dressé : il est reclus, à l’intérieur mais des fenêtres lui permettent une vue
sur le monde, non une ouverture puisque ces fenêtres sont fermées, sa vision est délimitée
par le rectangle des fenêtres.
« Je pense qu’il est un quart d’heure de l’après-midi : autour de moi, tout est lumière et eau » :
Le « je » du poète n’est plus seulement un « je » qui voit et entend, mais un « je » qui pense,
spirituel.
De plus, le verbe « penser » témoigne d’un rapport au temps, incertain, immatériel.
C’est par le macrocosme, grâce à la nature qui l’entoure, qu’il jauge le temps.
C’est parce
qu’autour de lui, tout est lumière et eau qu’il pense qu’il est un quart d’heure de l’après midi.
Le
cadre temporel est dressé mais il est flou, cette incertitude se poursuit par la forme, dans un
rythme binaire qui est l’expression de l’instabilité : notre poète semble noyé dans un océan
d’éléments naturels, entouré par le macrocosme, en antéposant le complément circonstanciel
« autour de moi » il met davantage l’accent sur « tout est lumière et eau » : sa perception est
altérée, d’ailleurs, notre poète est encerclé par des fenêtres, qui sont un médium entre le monde
intérieur et extérieur, mais qui est déformée par le prisme de la vitre, l’image du songe ambiguë
apparait alors, celle de l’illusion.
Cette binarité stylistique se marie avec l’union binaire eau/terre
qui est la manifestation d’une grande rêverie spirituelle chez Claudel de cette alliance terrestre/
céleste : « lumière et eau ».
L’eau est, d’ailleurs, propice au rêve et à l’imagination pour
Bachelard, "des eaux claires, brillantes où naissent des images fugitives, jusqu’aux profondeurs
obscures, où gisent mythes et fantasmes.
»
« Je porte ma plume à l’encrier, et jouissant de la sécurité de mon emprisonnement, intérieur,
aquatique, tel qu’un insecte dans le milieu d’une bulle d’air, j’écris ce poëme.
» :
• La cadence mineure permet de concrétiser l’apodose sur le segment « j’écris ce poème », qui
nous fait penser à la première phrase, dont l’apodose s’achevait sur « la pluie ».
Nous pouvons
imaginer qu’un parallélisme se construit entre la pluie et l’écriture du poème, ce qui renvoie à
cette idée de pluie fécondatrice et nourricière ( la pluie comme la manne du peuple ) de la
Terre et de l’écriture ( la goutte de pluie qui coule sur la terre est analogue à la goutte d’encre
qui coule sur la feuille )
De plus, les nombreuses virgules donnent un effet de pauses, montantes dans la protase qui
semblent mimer les contractions de plus en plus fortes de la femme lors de son accouchement.
Le clausule : « J’écris ce poëme....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Pluie de Ponge (analyse linéaire)
- Cinq Grandes Odes de Paul CLAUDEL (Résumé & Analyse)
- Tête d'Or de Paul CLAUDEL (Résumé & Analyse)
- Le Soulier de satin de Paul CLAUDEL (Résumé & Analyse)
- Analyse linéaire Théodote, La Bruyère