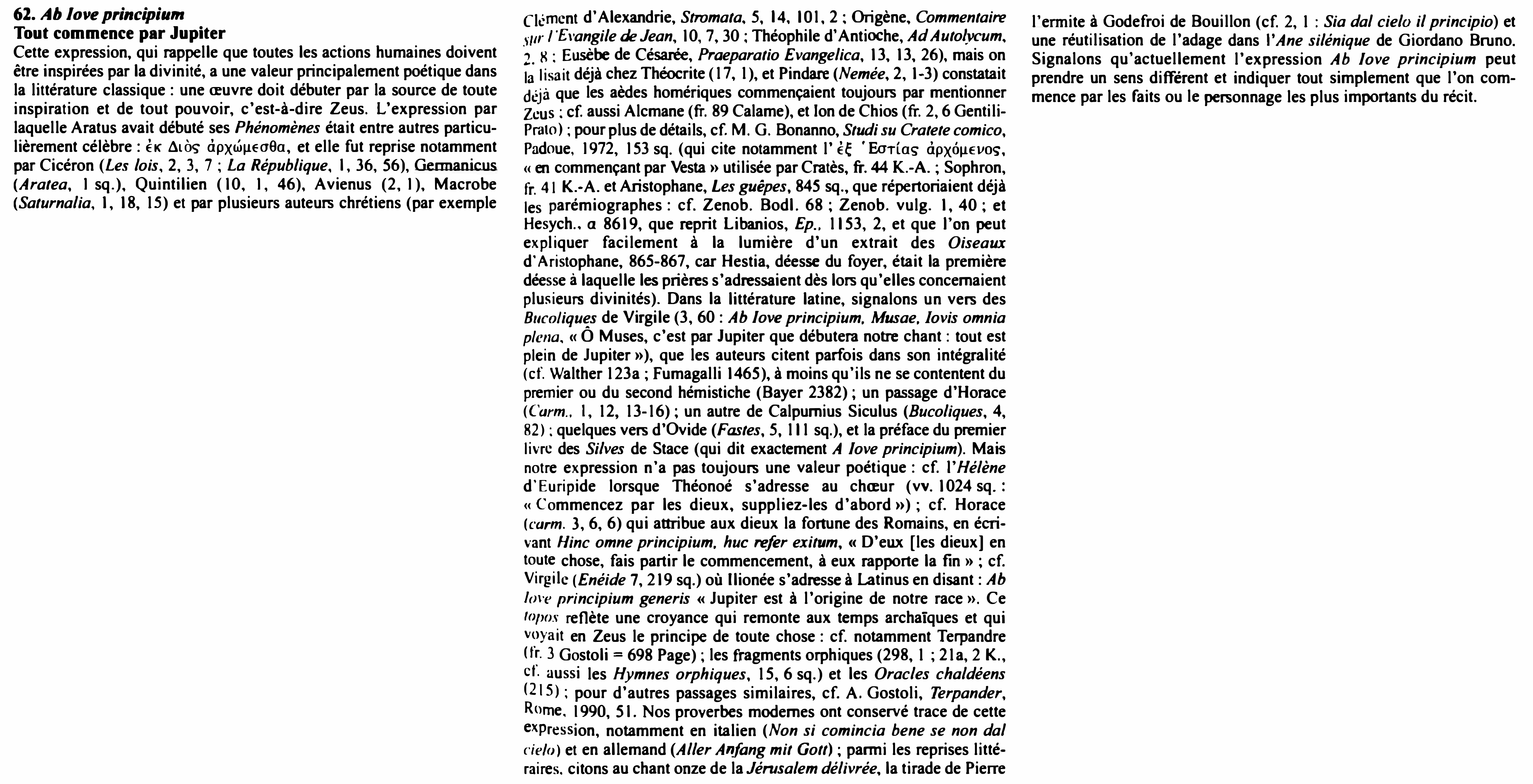Ab love principium Tout commence par Jupiter
Publié le 17/12/2021

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Ab love principium Tout commence par Jupiter. Ce document contient 181 mots soit 1 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format PDF sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en: Citations.
«
62.
Ab love principium
Tout commence par Jupiter
Cette expression, qui rappelle que toutes les actions humaines doivent
être inspirées par la divinité, a une valeur principalement poétique dans
la littérature classique: une œuvre doit débuter par la source de toute
inspiration et de tout pouvoir, c'est-à-dire Zeus.
L'expression par
laquelle Aratus avait débuté ses Phénomènes était entre autres particu
lièrement célèbre: ÈK âLÔ5' àpxwµEa8a,
et elle
fut reprise notamment
par Cicéron (les lois, 2, 3, 7 : la République
,.
1,
36, 56), Ge11nanicus
(Aratea, 1
sq.).
Quintilien (
10, 1, 46), Avienus (2, 1 ), Macrobe
(Saturnalia, 1, 18, 15) et par plusieurs auteurs chrétiens (par exemple Clé
ment
d'Alexandrie,
Stromata, S, 14,
101, 2; Origène, Commentaire
...
,,,· / ·E,·angile de Jean, 10, 7, 30 : Théophile d'Antioche, Ad
Auto(vcum,
2.
8: Eusèbe de
Césarée, Praeparatio Evange/ica, 13 ..
13 ..
26),
mais on
la lisait
déjà
chez
Théocrite ( 17, 1
), et Pindare
(Nemée, 2, 1-3)
constatait
déjà que les
aèdes homériques commençaient toujours par mentionner
zcu s: cf.
aussi
Alcmane (fr.
89 Calame), et Ion de Chios (fr.
2, 6 Gentili
Prato) ; pour
plus de détails, cf.
M.
G.
Bonanno, Studi su Cratete comico,
Padoue, 1972, 153
sq.
(
qui cite notamment l' È e 'EaT(as apxoµEVOS'.
> utilisée par Cratès, fr.
44 K.-A.
; Sophron,
fr.
41 K.-A.
et
Aristophane, Les guêpes, 84S sq., que répe�oriaient déjà
les parémiographes:
cf.
Zenob.
Bodl.
68; Zenob.
vulg.
1,
40; et
Hesych ...
a
8619, que reprit Libanios, Ep.
, 11
S3, 2, et que l'on
peut
expliquer facilement à la lumière d'un extrait
des Oiseaux
d"Aristophane, 865-867, c-ar Hestia, déesse du foyer, était la première
dées se à laquelle
les prières s'adressaient dès lors qu'elles concernaient
plusieurs divinités).
Dans la
littérature latine, signalons un vers des
81,coliques de
Virgile (3, 60: Ah love
principium, Musae, lovis omnia
ple11a ..
> ),
que les auteurs citent parfois dans son intégralité
(et·.
Walther 123a; Fumagalli 146S), à moins qu'ils ne se contentent du
premier ou
du second hémistiche (Bayer 2382) ; un passage d'Horace
(C,arm., 1, 12, 13-16); un autre
de Calpurnius
Siculus (Bucoliques, 4,
82) :
quelques vers d'Ovide (Fastes, S, 111 sq.), et la préface du premier
livre des Silves
de Stace (qui dit exactement A love principium).
Mais
notre expression n'a
pas toujours une valeur
poétique: cf.
l'Hélène
d'Euripide lorsque Théonoé
s'adresse au chœur (vv.
1024 sq.:
> ); cf.
Horace
(l·arm.
3, 6, 6)
qui attribue aux dieux la fortune des Romains, en écïi
vant Hinc omne
principium, hue refer exit�m
,.
>; cf.
Virgil e (Enéide 1,219 sq.) où llionée s'adresse à Latinus
en disant : Ah
/,J,·e principium generis >.
Ce
'''l'.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « La cérémonie commence » s'écrie un personnage au début de la représentation de la pièce d'Ionesco, Le Roi se meurt. Ne pensez-vous pas qu'on puisse dire de toute représentation qu'elle est elle-même une cérémonie ? Vous vous interrogerez sur ce jugement en vous référant aux oeuvres littéraires que vous avez appréciées et à votre expérience théâtrale.
- Quale principium talis est clausula Tel début, telle fin
- « Une des grandes causes du malentendu entre pères et fils, éducateurs et élèves, tient aux Jugements différents que chaque génération commence à porter sur le concept de travail ».
- Avec Voltaire, c'est un monde qui finit; avac Rousseau c'est un siècle qui commence (Goethe) ?
- « C'est fait pour que le public se pose des questions. Car lorsqu'un homme se pose des questions, il commence à changer et il a des chances un jour de changer le monde. »