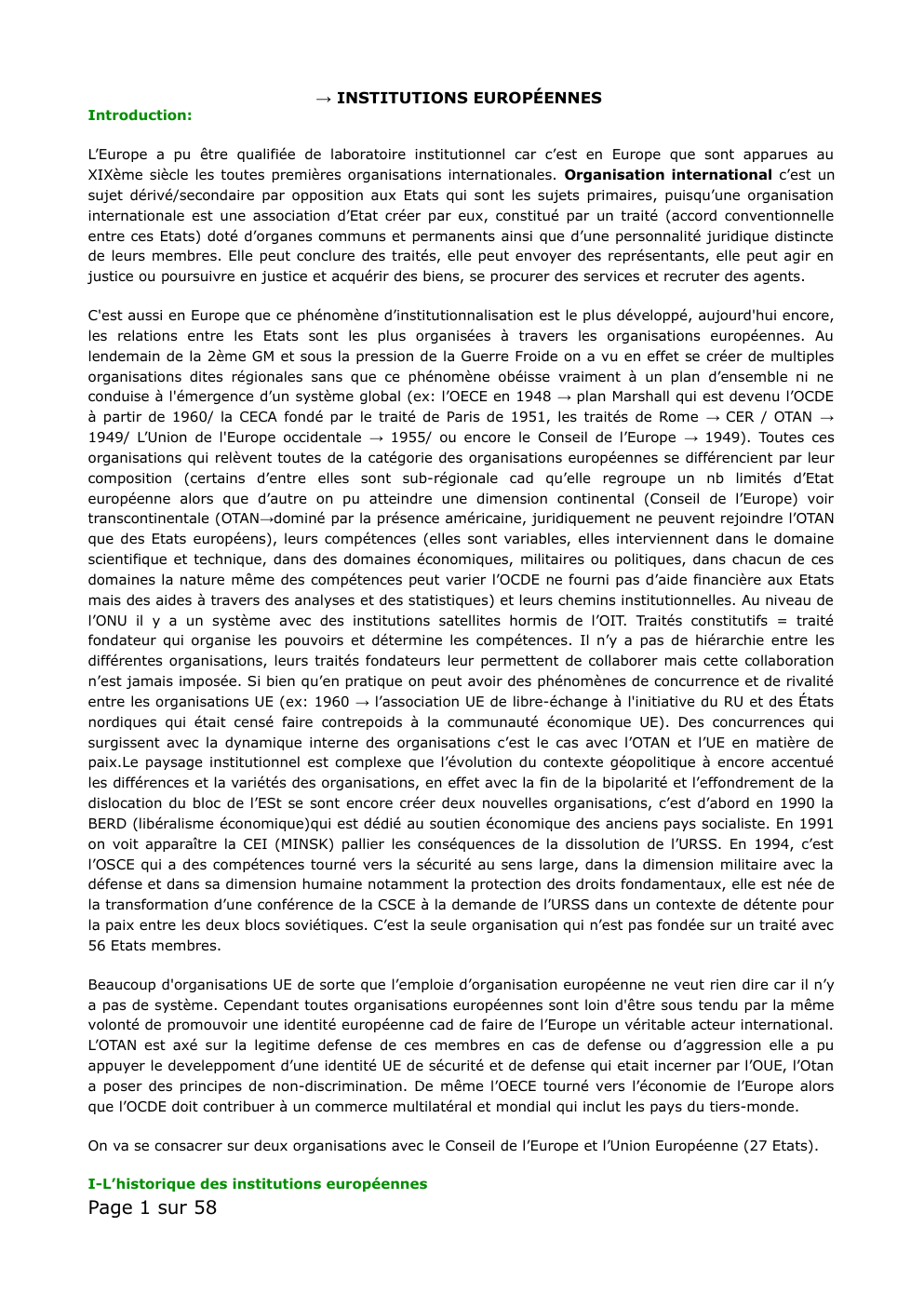→ INSTITUTIONS EUROPÉENNES
Publié le 04/10/2025
Extrait du document
«
Introduction:
→ INSTITUTIONS EUROPÉENNES
L’Europe a pu être qualifiée de laboratoire institutionnel car c’est en Europe que sont apparues au
XIXème siècle les toutes premières organisations internationales.
Organisation international c’est un
sujet dérivé/secondaire par opposition aux Etats qui sont les sujets primaires, puisqu’une organisation
internationale est une association d’Etat créer par eux, constitué par un traité (accord conventionnelle
entre ces Etats) doté d’organes communs et permanents ainsi que d’une personnalité juridique distincte
de leurs membres.
Elle peut conclure des traités, elle peut envoyer des représentants, elle peut agir en
justice ou poursuivre en justice et acquérir des biens, se procurer des services et recruter des agents.
C'est aussi en Europe que ce phénomène d’institutionnalisation est le plus développé, aujourd'hui encore,
les relations entre les Etats sont les plus organisées à travers les organisations européennes.
Au
lendemain de la 2ème GM et sous la pression de la Guerre Froide on a vu en effet se créer de multiples
organisations dites régionales sans que ce phénomène obéisse vraiment à un plan d’ensemble ni ne
conduise à l'émergence d’un système global (ex: l’OECE en 1948 → plan Marshall qui est devenu l’OCDE
à partir de 1960/ la CECA fondé par le traité de Paris de 1951, les traités de Rome → CER / OTAN →
1949/ L’Union de l'Europe occidentale → 1955/ ou encore le Conseil de l’Europe → 1949).
Toutes ces
organisations qui relèvent toutes de la catégorie des organisations européennes se différencient par leur
composition (certains d’entre elles sont sub-régionale cad qu’elle regroupe un nb limités d’Etat
européenne alors que d’autre on pu atteindre une dimension continental (Conseil de l’Europe) voir
transcontinentale (OTAN→dominé par la présence américaine, juridiquement ne peuvent rejoindre l’OTAN
que des Etats européens), leurs compétences (elles sont variables, elles interviennent dans le domaine
scientifique et technique, dans des domaines économiques, militaires ou politiques, dans chacun de ces
domaines la nature même des compétences peut varier l’OCDE ne fourni pas d’aide financière aux Etats
mais des aides à travers des analyses et des statistiques) et leurs chemins institutionnelles.
Au niveau de
l’ONU il y a un système avec des institutions satellites hormis de l’OIT.
Traités constitutifs = traité
fondateur qui organise les pouvoirs et détermine les compétences.
Il n’y a pas de hiérarchie entre les
différentes organisations, leurs traités fondateurs leur permettent de collaborer mais cette collaboration
n’est jamais imposée.
Si bien qu’en pratique on peut avoir des phénomènes de concurrence et de rivalité
entre les organisations UE (ex: 1960 → l’association UE de libre-échange à l'initiative du RU et des États
nordiques qui était censé faire contrepoids à la communauté économique UE).
Des concurrences qui
surgissent avec la dynamique interne des organisations c’est le cas avec l’OTAN et l’UE en matière de
paix.Le paysage institutionnel est complexe que l’évolution du contexte géopolitique à encore accentué
les différences et la variétés des organisations, en effet avec la fin de la bipolarité et l’effondrement de la
dislocation du bloc de l’ESt se sont encore créer deux nouvelles organisations, c’est d’abord en 1990 la
BERD (libéralisme économique)qui est dédié au soutien économique des anciens pays socialiste.
En 1991
on voit apparaître la CEI (MINSK) pallier les conséquences de la dissolution de l’URSS.
En 1994, c’est
l’OSCE qui a des compétences tourné vers la sécurité au sens large, dans la dimension militaire avec la
défense et dans sa dimension humaine notamment la protection des droits fondamentaux, elle est née de
la transformation d’une conférence de la CSCE à la demande de l’URSS dans un contexte de détente pour
la paix entre les deux blocs soviétiques.
C’est la seule organisation qui n’est pas fondée sur un traité avec
56 Etats membres.
Beaucoup d'organisations UE de sorte que l’emploie d’organisation européenne ne veut rien dire car il n’y
a pas de système.
Cependant toutes organisations européennes sont loin d'être sous tendu par la même
volonté de promouvoir une identité européenne cad de faire de l’Europe un véritable acteur international.
L’OTAN est axé sur la legitime defense de ces membres en cas de defense ou d’aggression elle a pu
appuyer le develeppoment d’une identité UE de sécurité et de defense qui etait incerner par l’OUE, l’Otan
a poser des principes de non-discrimination.
De même l’OECE tourné vers l’économie de l’Europe alors
que l’OCDE doit contribuer à un commerce multilatéral et mondial qui inclut les pays du tiers-monde.
On va se consacrer sur deux organisations avec le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne (27 Etats).
I-L’historique des institutions européennes
Page 1 sur 58
Il y a deux manières de penser l’Union entre les Etats européens, il y a deux méthodes pour la réaliser,
on touche à un point essentiel.
D’un côté la coopération et de l’autre l’intégration.
C’est deux concepts
se distinguent fondamentalement par leur rapport à la S de l’Etat en DI, cad le pouvoir de décider de ses
propres compétences la plénitude et l’exclusivité de la compétence sur son territoire:
La coopération n’affecte pas la S étatique, l’Etat va accepter de se créer des obligations mais va garder
la main sur leur définition et il ne perd jamais ces compétences sur son territoire.
L’Etat FR s’est liée par
des traités mais quand on est au stable de la coopération le gouv FR va décider de la manière d'appliquer
certains engagements internationaux.
La coopération va rester dans le registre de l’international des
rapports entre les Nations, juridiquement c’est la coopération intergouvernementale (OIG).
En DI l’Etat
est représenté par le gouv, c’est l’exécutif qui engage l’Etat sur la SI, ce sont d'abord les gouv des
différents Etat-membres qui se concentrent au sein des organisations et qui votent les actes qui seront
ensuite attribués à l'organisation.
Mode de gestion de relation entre les Etats.
- L'intégration vise un échelon supra-nationale, un pouvoir qui se situe au-dessus des Etats,
pouvoir central capable d’imposer des choix et des normes aux Etats.
Cette méthode a été développé par
J.Monnet qui dès 1943 lors d’un discours devant le comité de libération national souligné qu’il ny aura pas
de pays en Europe si les Etats se construise sur une base de S nationale avec ce que cela entraîne de
politique, de prestige et de protection économique, il va falloir dépasser la S national.
L’intégration est un
processus singulier qui a été théorisé par plusieurs auteurs tels que Paul Reuter et P.
Pescator l’un comme
l’autre dégage 4 critères cumulatifs l'intégration par opposition à la coopérations:
- la mise en place d’institutions indépendantes des Etats, cad appelé à représenter d’autre
intérêt que l'intérêt national défendu par tel ou tel gouv.
Ces organes sont appelés à participer au pouvoir
décisionnel
- un transfert de compétence de l’échelon national vers l'échelon supra-national, l’Etat peut se
trouver dessaisis de certaines de ces compétences, il peut perdre le pouvoir de légiférer sur certaines
questions sur son propre territoire, ou perd le pouvoir de légiférer autrement par la norme commune
défini par l'échelon supranational.
Il est gradué et variable d’une question à une autre (ex:monnaie).
Il y
a un réaménagement de la S national, avec une S partagé.
- le pouvoir héteronormateur c’est le pouvoir de décisions, de pouvoir dicter des normes
générales, des règles de droits obligatoire pour et dans les Etats Les 2 principes majeures: la primauté
c’est une règle de conflit (arrêt Costa), en cas de conflit on laisse tomber la norme national au profit de la
norme UE.
- Le pouvoir de décision, la capacité de créer des actes juridiques obligatoire pour les etats, ils sont
adoptés à la majorité qualifiée, la règle de l’unanimité est le principe de coopération de sorte que chacun
à un droit de veto par son seul vote négatif chaque état peut s’opposer.
Un état même si il s’oppose ne
peut pas bloquer à lui seul l’adoption d’une norme commune dans un schéma de l’intégration.
L’unanimité
y a un vote alors que le consensus il n’y a pas de vote on négocie et on discute et puis il y a une décision
qui convient à tout le monde.
C’est le mode diplomatique par excellence.
Chapitre 1: La construction européenne par la coopération
politiques → Conseil de l’Europe
Le conseil de l’europe d’un point de vue chronologique et la première O dont l'ambition et l'objectif a été
de rassembler les etats européennes autour non seulement d'intérêt mutuelle mais surtout de valeurs
communes.
Pour mieux comprendre sa place dans le paysage institutionnel européen et sa nature, il faut
voir les bases sur lesquelles il s’est créé pour après parler de ses activités.
Section 1: Les bases du Conseil de l’Europe
§1:La naissance
Historiquement il est possible de faire remonter les origine du CE jusqu’a l’entre de guerre et plus
précisément au projet d’UE qui avait été initié en 1929 par le ministre FR des affaire étrangères de
l'époque A.Briand pour proposer aux etats européens membres de la société des nations de former dans
Page 2 sur 58
ce cadre un système régional qui harmonisera les intérêts européens et viserait à établir entre elles pays
une sorte de lien federals.
Si le....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Institutions internationales et européennes
- Cours: Histoire des institutions politiques
- Les défiance à l’égard de la représentation politique et les institutions politique qui cimente la société
- UE et politiques européennes
- Athènes et Sparte et les institutions