METTERNICH Klemens Wenzel, prince de
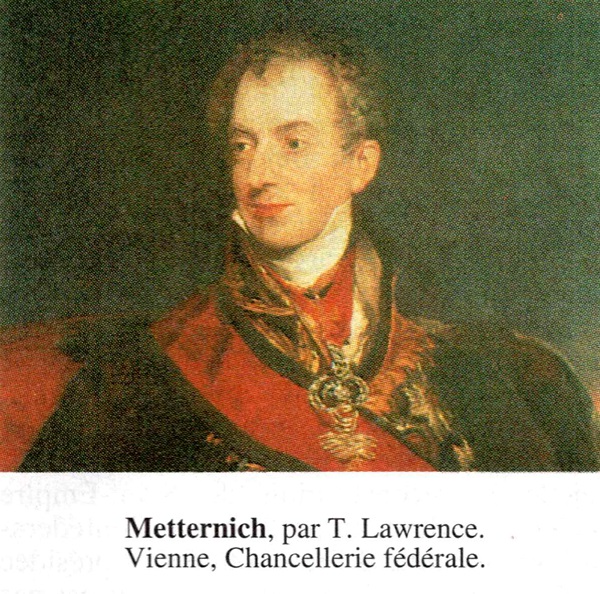 Homme politique autrichien. Il était issu d'une famille de la noblesse rhénane et son père fut l'un des collaborateurs de Kaunitz (v.). En 1794, il entra dans la diplomatie autrichienne, devint ambassadeur à Paris, puis en 1809 ministre des Affaires étrangères. Il appliqua alors une politique qui tendait à rétablir la puissance des Habsbourg et à restaurer un équilibre européen menacé par l'impérialisme napoléonien. Toutefois, conscient des ambitions prussiennes et russes, il ne voulait nullement écraser la France, qu'il souhaitait simplement ramener à ses frontières de 1792. Il accepta le mariage de Napoléon et de Marie-Louise, et c'est seulement devant l'obstination de Napoléon qu'il se rallia à la restauration des Bourbons. Le traité de Vienne fut son triomphe, puisqu'il rétablissait la puissance de l'Autriche en Allemagne et en Italie.
Après 1815, il s'appliqua à préserver le statu quo, qu'il regardait comme intangible. Il y parvint à peu près jusqu'en 1848. Toutefois, le mouvement d'unification de l'Allemagne, dont la Prusse prit de plus en plus clairement la tête, la montée du Risorgimento en Italie, l'agitation libérale dans toute l'Europe minèrent sa politique. Devenu chancelier de l'Autriche, mais resté avant tout un diplomate, le vieil homme d'État prêta peu d'attention à tous ces mouvements qu'il comprenait mal. Les troubles de mars 1848 à Vienne l'obligèrent à fuir, et il n'exerça plus aucune influence jusqu'à sa mort.
Homme politique autrichien. Il était issu d'une famille de la noblesse rhénane et son père fut l'un des collaborateurs de Kaunitz (v.). En 1794, il entra dans la diplomatie autrichienne, devint ambassadeur à Paris, puis en 1809 ministre des Affaires étrangères. Il appliqua alors une politique qui tendait à rétablir la puissance des Habsbourg et à restaurer un équilibre européen menacé par l'impérialisme napoléonien. Toutefois, conscient des ambitions prussiennes et russes, il ne voulait nullement écraser la France, qu'il souhaitait simplement ramener à ses frontières de 1792. Il accepta le mariage de Napoléon et de Marie-Louise, et c'est seulement devant l'obstination de Napoléon qu'il se rallia à la restauration des Bourbons. Le traité de Vienne fut son triomphe, puisqu'il rétablissait la puissance de l'Autriche en Allemagne et en Italie.
Après 1815, il s'appliqua à préserver le statu quo, qu'il regardait comme intangible. Il y parvint à peu près jusqu'en 1848. Toutefois, le mouvement d'unification de l'Allemagne, dont la Prusse prit de plus en plus clairement la tête, la montée du Risorgimento en Italie, l'agitation libérale dans toute l'Europe minèrent sa politique. Devenu chancelier de l'Autriche, mais resté avant tout un diplomate, le vieil homme d'État prêta peu d'attention à tous ces mouvements qu'il comprenait mal. Les troubles de mars 1848 à Vienne l'obligèrent à fuir, et il n'exerça plus aucune influence jusqu'à sa mort.
Metternich, Klemens Wenzel Nepomuk Lothar, comte puis prince de (Coblence 1773-Vienne 1859); diplomate et homme politique autrichien.
Pour les uns, c’est un réaliste cynique qui recouvre les besoins de la raison d’État autrichienne du manteau des principes ; pour les autres, un homme de pouvoir dogmatique mais aveugle aux évolutions politiques de son temps. Beaucoup le considèrent comme un opportuniste froid et sans éthique, pour qui le succès politique est l’unique règle de conduite. Les libéraux voient en lui simplement l’homme de la réaction qui s’oppose au progrès de façon bornée, en fonction de ses préjugés d’aristocrate. D’autres plus conservateurs voient en lui un homme d’État européen plutôt qu’autrichien, auquel l’Europe centrale doit un demi-siècle de développement pacifique. Tous ces jugements vrais et faux à la fois incitent à resituer l’œuvre et la personnalité de cet homme d’État dans le contexte de son époque. Aristocrate allemand cosmopolite, cultivé et hédoniste, M. est et reste un homme et un diplomate de l’Ancien Régime. Son système politique demeure étranger aux idées laissées par la Révolution française dans l’Europe de son temps. Il n’a jamais été touché par le romantisme politique et son aspiration nationale. Noble rhénan entré comme ses ancêtres au service des Habsbourg, il s’impose par son habileté de diplomate. Cependant, comme chancelier, il n’aura jamais en matière d’organisation de l’État d’influence décisive sur François IL Sa politique extérieure peut, dans le cadre de ces limites et des vicissitudes de l’évolution historique, se déchiffrer à partir de deux préoccupations majeures : l’équilibre européen et la vigilance à l’égard de toute rupture hégémonique ; la préservation des intérêts de l’État multinational des Habsbourg, menacé par une dynamique nationale, libérale et sociale qui prend en partie racine dans l’héritage de la Révolution. M. passe sa jeunesse dans les vallées du Rhin et de la Moselle où son père représente l’Autriche auprès des principautés rhénanes. Étudiant à Strasbourg - où il est le condisciple de Benjamin Constant - puis à Mayence où il s’ouvre à l’influence de Vogt, son professeur, et des théories de Burke, il observe sans sympathie aucune les progrès et les excès de la Révolution française : le flot révolutionnaire menace du reste très directement les propriétés des comtes de M., vieille famille de noblesse immédiate d’Empire dont les fiefs se situent en Rhénanie moyenne. M. quitte Mayence pour rejoindre son père affecté dans les Pays-Bas espagnols, puis après leur invasion l’accompagne à Vienne pour entrer comme lui au service de l’empereur. Il effectue en 1794 sa première mission en Grande-Bretagne. Un mariage de raison avec une petite-fille de Kaunitz lui ouvre en 1795 les salons viennois. Le congrès de Rastatt, où ses qualités se révèlent dans une fonction de second plan, cristallise chez lui en programme politique l’idée reprise à Vogt d’équilibre européen et le refus d’une hégémonie universelle en Europe. En 1801, il est envoyé comme ambassadeur à Dresde puis en 1803 à Berlin où il s’efforce d’entraîner la Prusse dans une coalition générale contre la France. L’effondrement de l’Autriche en 1805 et le désastre prussien en 1806, pour M. prévisible, réduisent à néant le fruit de cette activité diplomatique. L’amitié nouée à cette époque avec Gentz, théoricien de l’équilibre européen, ne fait qu’affermir une vision politique du monde qui doit tout à l’idéologie conservatrice. Pendant qu’en Prusse Stein et Scharnhorst mettent les forces intellectuelles et morales de la nation au service d’un renouveau intérieur de l’Etat, M., dans l’esprit de la politique de cabinet traditionnelle, croit un moment possible une séparation des sphères d’influence de la France et des puissances de l’Est et une nouvelle version du concert des puissances. Nommé par Stadion ambassadeur à Paris, M. se convainc de la nécessité d’un affrontement avec Napoléon Ier, que l’Autriche lui semble néanmoins pour l’heure incapable de soutenir. Aussi déconseille-t-il une rupture prématurée, tout en encourageant la formation, par un travail sur l’opinion publique, d’un esprit national en Autriche, à l’œuvre dans le malheureux « soulèvement allemand » de 1809. En 1809, la défaite l’amène à la tête de la politique étrangère autrichienne. Tenant compte du rapport de forces du moment, il opère un rapprochement avec la France scellé, en contradiction avec les principes légitimistes, par le mariage de Marie-Louise, fille de l’Empereur, avec Napoléon. A ses yeux, face à la double menace de la Russie et de la France, sa tâche première est de maintenir l’État autrichien par une politique « de louvoiement, de dérobades et de flatteries » jusqu’à ce que se présente la possibilité d’une résistance ouverte. Dès 1811, il préconise une réorganisation de l’Etat autrichien sur une base fédérale, qui se heurte au refus de François IL Contre Stadion, il impose la participation de l’Autriche à la campagne de Russie aux côtés de Napoléon, tout en traitant en secret avec Alexandre Ier et en poursuivant le réarmement autrichien. En 1813, au lieu d’entrer d’emblée dans la coalition des puissances, M., qui connaît les carences de l’armée autrichienne et craint la progression du colosse russe en Europe centrale autant que les appétits prussiens en Allemagne, mène un jeu complexe qui permettra finalement à son pays de s’assurer malgré son engagement tardif une position diplomatique dominante. Il offre ses bons offices pour la négociation de la paix, s’efforçant dans un premier temps de sauver la mise à Napoléon au bénéfice d’une régence de Marie-Louise et au prix d’un retour de la France à ses frontières de 1792. Parallèlement, il s’attache la Bavière et dans son sillage les Etats du sud de l’Allemagne par le traité de Ried, contrecarrant ainsi aussi bien les visées des patriotes allemands que de possibles velléités hégémoniques prussiennes. Devant l’intransigeance de Napoléon, qui l’accuse non sans raison de double jeu, l’Autriche s’associe en août 1813 à la déclaration de guerre. Mais M. a engrangé à la faveur de cette médiation un ascendant diplomatique que reflètent les clauses du traité de Paris, conformes à ses propositions initiales - mais cette fois au bénéfice de la restauration des Bourbons. Le congrès de Vienne, tenu du 1er novembre 1814 au 9 juin 1815, voit le triomphe de M. - que l’empereur a fait prince en octobre 1813 -, organisateur de ses réjouissances et président de ses réunions. Il s’y fait avec Castlereagh le champion d’un équilibre européen contenant la Prusse et la Russie en même temps que le promoteur d’une concertation systématique des puissances européennes. Entreprise à Vienne et consolidée entre 1818 et 1822 par une série de congrès internationaux, la réorganisation de l’Europe met en place pour plus de trente ans, sur une base concertée, un nouveau découpage territorial qui ne se borne pas à la restauration de l’ordre ancien et assure une paix durable. Elle rétablit la puissance autrichienne en Allemagne et en Italie. En Allemagne, M. rejette la reconstitution du Saint-Empire plaidée par Stein au profit d’une Confédération germanique d’Etats souverains présidée et dominée par l’Autriche. Il ne lui est pas possible du fait des réserves de l’empereur d’étendre ce modèle à l’Italie transformée dans sa majeure partie en protectorat autrichien par la constitution de la Lombardie-Vénétie et l’installation de monarques autrichiens. La Sainte-Alliance proposée par le tsar Alexandre Ier, et transformée en une Ligue des princes, devient entre les mains expertes de M. un outil efficace de répression des aspirations nationales et libérales en Allemagne et en Italie. Le maintien du statu quo rationnellement obtenu résume trente ans de diplomatie. Mais, sapé par la défection à partir de 1825 de l’Angleterre, l’intervention de plusieurs puissances européennes dans le soulèvement grec (1827) que M., fidèle à sa doctrine, n’a pas soutenu, et la mort d’Alexandre Ier, le « système de Metternich » est profondément ébranlé par les révolutions de 1830. M. ne régente plus guère que l’Allemagne - surtout par sa maestria personnelle - et l’Italie au prix d’un contrôle répressif qui déconsidère l’Autriche et vaut à son ministre la haine des libéraux. A l’intérieur même de l’Empire autrichien M., chancelier depuis 1821, favorise la résurrection des institutions traditionnelles - diètes et libertés provinciales, comme au Tyrol - et les ordres constitués pour mieux contrer l’émergence de revendications libérales et sociales au plan central. Dépourvu d’autorité sur les affaires intérieures confiées par François II à Anton de Kolovrat, il doit renoncer — et s’en accommode - à doter l’Autriche d’institutions étatiques modernes sur le modèle prussien. Il n’y parvient pas davantage en tant que président du Conseil de régence qui assiste après 1835 Ferdinand le Débonnaire, malgré tout le pouvoir que semblait devoir lui laisser l’incapacité politique du nouvel empereur. Vieilli, imbu de lui-même, M. s’enlise dans le maintien de l’ordre établi. Le système immobile de M. est, comme le perçoit son vieux compagnon et collaborateur Gentz, miné depuis longtemps lorsqu’il est balayé par la révolution de mars 1848. M. se réfugie alors en Angleterre puis à Bruxelles. Après son retour à Vienne en 1851, on ne sollicite plus qu’occasionnellement ses conseils. Son fils, ambassadeur d’Autriche à Paris de 1859 à 1870, publie partiellement ses Mémoires entre 1880 et 1884. Représentant de la culture d’une Europe prérévolutionnaire, l’homme, qui pendant dix ans a gouverné l’Europe et, pendant plus de trente ans, l’Empire autrichien et sa sphère d’influence, est resté aveugle à des transformations économiques et sociales étrangères à son système de pensée. Il a en outre négligé l’irruption de forces nouvelles et incontrôlées, telles les opinions publiques dans le jeu politique et diplomatique traditionnel.
Bibliographie : G. Bertier de Sauvigny, Metternich et son temps, 1959 ; id., Metternich et la France après le Congrès de Vienne, 2 t., 1968 et 1970 ; id., Metternich, 1986 ; H. Vallotton, Metternich, 1965.
Liens utiles
- Klemens Wenzel Fürst von Metternich - Geschichte.
- Klemens Metternich par G.
- Klemens Metternich Metternich naquit à Coblence et passa sa jeunesse dans la région du Rhin etde la Moselle.
- C. E. 19 févr. 1875, PRINCE NAPOLÉON Rec. 155, concl. David (D. 1875.3.18, concl. David) Cons.
- Titre : « Le Petit Prince » Auteur : Antoine de Saint Exupéry Genre du livre : roman et conte































