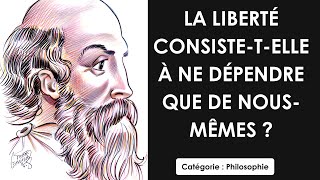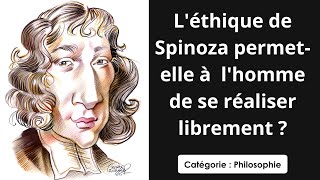La marche vers l'euro vise à parachever le marché unique européen
La marche vers l'euro vise à parachever le marché unique européen
Encadré : Les critères d'entrée en union monétaire
Encadré : Le calendrier de l'euro
La marche vers la monnaie unique européenne, l'euro, apparaissait, à l'automne 1997, à la fois heurtée et inéluctable. Elle apparaissait heurtée car jalonnée d'hésitations, de polémiques et de crises. Ainsi, le débat qui a précédé le Conseil européen d'Amsterdam, en juin 1997, a conduit les pessimistes à juger "irréconciliables" les visions française et allemande de l'union monétaire. Plus fondamentalement encore, les esprits étaient naturellement troublés à l'approche de l'abandon de ces attributs traditionnels de souveraineté que sont les monnaies nationales. Certains ont peut-être même été saisis d'une sorte de vertige face à cette remise en cause de l'"ordre des choses" que représente l'émergence d'une nouvelle monnaie, en mesure de contester la suprématie planétaire du dollar.
Mais l'avènement de l'euro apparaissait en même temps inéluctable, les chefs d'État et de gouvernement des Quinze confirmant à chacune de leurs rencontres que la date butoir fixée par le traité de Maastricht - le 1er janvier 1999 - serait respectée. Comme l'a montré le sommet d'Amsterdam, les polémiques les plus vives débouchent sur des compromis.
L'euro et la mondialisation
Cette persistance étonnante du projet de monnaie unique est liée à la perception de plus en plus nette de la nécessité dans laquelle se trouve l'Europe d'unir ses forces pour compter dans l'économie mondialisée. A l'instar de leurs concurrentes américaines et asiatiques, les entreprises européennes ont besoin d'un vaste marché intérieur pour conforter leur compétitivité. Or, sans monnaie unique, le marché européen reste incomplet et fragile. Incomplet car les commissions de change demeurent, les économies d'échelle ne sont pas pleinement exploitées, la comparabilité des prix n'est pas assurée. Fragile car, dans une zone économique aussi intégrée que l'Union européenne (UE), le commerce, l'investissement, l'activité et l'emploi sont directement pénalisés par l'instabilité des changes. Il n'est donc pas anormal que, confrontés au "triangle d'incompatibilité" mis en évidence par les économistes, les États européens aient choisi d'assurer la stabilité des changes et la libre circulation des capitaux et d'abandonner l'autonomie de leurs politiques monétaires.
Plusieurs de ces pays étant de taille importante et approximativement équivalente, cet abandon ne peut se concevoir que par un partage de la souveraineté monétaire, à travers la création d'une Banque centrale européenne (BCE), d'une politique monétaire et d'une monnaie uniques.
L'euro parachève et consolide donc le marché unique européen. Il constitue ainsi un facteur nécessaire - bien que non suffisant - de compétitivité et de prospérité pour l'Europe: c'est l'une des raisons qui expliquent pourquoi les gouvernements successifs de la grande majorité des pays européens ont poursuivi la marche vers l'euro.
Le chemin parcouru
Les premières étapes du calendrier fixé, en 1992, par le traité de Maastricht ont été pleinement respectées. Cela n'a pas été sans difficultés. Mais, à chaque fois, les compromis nécessaires ont été trouvés.
Sur le plan institutionnel, en 1994, l'Institut monétaire européen (IME), précurseur de la future BCE, a été créé. Fin 1995, à Madrid, il a été décidé que la future monnaie unique s'appellerait l'euro. En décembre 1996 et juin 1997, lors des Conseils européens de Dublin puis d'Amsterdam, les Quinze ont précisé deux aspects importants du fonctionnement de l'union monétaire. Premièrement, un nouveau mécanisme de change devrait lier à l'euro les monnaies des pays qui n'entreront pas immédiatement en union monétaire. Ce mécanisme devrait favoriser la stabilité des changes au sein de l'UE. A ce sujet, on peut d'ailleurs noter que, depuis l'adhésion du mark finlandais et le retour de la lire italienne, fin 1996, douze des quinze pays de l'UE participent à l'actuel mécanisme de change, que l'on disait parfois moribond peu de temps auparavant.
Deuxièmement, le "pacte de stabilité et de croissance" a indiqué le mode d'emploi des dispositions du traité relatives à la nécessité de maintenir des finances publiques saines, une fois l'union monétaire créée.
Sur le plan pratique, les Quinze ont adopté, en 1995, le scénario de passage à l'euro. Ce passage s'effectuera, pour l'essentiel, en deux temps forts: le 1er janvier 1999 pour les marchés de capitaux - déjà habitués à travailler en de nombreuses devises - et fin 2001 - en raison de préparatifs techniques beaucoup plus longs - pour la plupart des opérations bancaires de détail et pour l'émission des billets et des pièces
Toutes ces décisions ont incontestablement accru la crédibilité du projet, au point que la quasi-totalité des banques et des administrations et une grande partie des entreprises européennes ont commencé activement le processus d'adaptation de leurs opérations à l'euro.
Les étapes à franchir
L'échéance majeure a été fixée pour avril-mai 1998, les chefs d'État et de gouvernement devant désigner à cette date les pays admis à faire partie de l'union monétaire dès le 1er janvier 1999. Il s'agira de juger, au vu des résultats de l'année 1997, du caractère durable du respect des critères de convergence fixés par le traité
Il reste à déterminer le rythme de réduction du déficit acceptable pour l'entrée en union monétaire. La décision politique sur le choix des pays devrait-t-elle privilégier l'interprétation "en tendance", pour rassembler le maximum de pays et pour faire coïncider le plus possible, et dès le début, les frontières de l'Union monétaire et celles du Marché unique? Ou devrait-elle privilégier une interprétation plus "stricte", pour que l'euro, monnaie crédible, soit doté de taux d'intérêt faibles? L'histoire de la construction européenne laisse penser que la décision finale pourrait bien éviter les solutions extrêmes. Certains ont ainsi suggéré de fixer des délais d'attente relativement courts (un ou deux ans selon les cas), permettant aux pays jugés out d'améliorer leur degré de convergence durable et de rejoindre l'union monétaire, par exemple, avant la mise en circulation des billets et des pièces en euros, fin 2001.
Par ailleurs, trois autres dossiers font l'objet d'une attention soutenue de la part des responsables et des agents économiques européens: la coordination des politiques économiques, la politique de change de l'euro et l'Europe sociale. Ces dossiers ne donnent pas lieu, à proprement parler, à des échéances précises sur le chemin de l'euro. Mais, sur les trois sujets, le sommet d'Amsterdam a posé des jalons en vue de l'élaboration d'un consensus devant influencer la manière dont fonctionnera l'union monétaire.
Coordination des politiques économiques, change, emploi
La coordination des politiques économiques, prévue par le traité, ne se justifie pas par la "nécessité de contrôler la BCE". Il n'y aura d'ailleurs pas d'union monétaire sans BCE indépendante. La coordination se justifie d'abord par le souci d'efficacité. Dans un espace économique aussi intégré que l'Union européenne - et, a fortiori, que l'union monétaire -, les politiques économiques (c'est-à-dire les politiques budgétaires, des revenus) nationales ont inévitablement des effets sur l'économie des pays partenaires. La coordination permet de maximiser les effets positifs et de minimiser les effets négatifs. Elle se justifie aussi par la nécessité de répondre de manière aussi coopérative que possible aux chocs qui n'affecteraient que l'un des pays membres de l'union monétaire, sachant que la politique monétaire ne pourra prendre en compte que la situation de l'ensemble de la zone. La limite de l'exercice est claire, logique et, d'ailleurs, elle aussi inscrite dans le traité: un pays membre ne doit pas compter faire financer par ses partenaires les conséquences de son propre laxisme en matière de gestion économique. Enfin, la coordination se justifie aussi en matière d'impôts, pour contenir les tendances au "moins-disant fiscal" systématique. Tous ces aspects de la coordination ont été inscrits au programme du sommet de Luxembourg, fin 1997.
Doit également être évoquée, alors, la politique de change de l'euro. Le traité confie au Conseil la mission de définir les orientations générales de cette politique, en liaison avec la Commission européenne et la BCE et dans le respect de l'objectif de stabilité des prix internes. Faut-il un euro "fort" ou un euro "faible"? Ainsi posée, la question est par trop réductrice. D'abord, la valeur des monnaies est déterminée par les marchés au moins autant que par les autorités. Ensuite, une monnaie faible risque de s'accompagner de taux d'intérêt élevés alors qu'une monnaie forte peut permettre des taux d'intérêt bas. Enfin, la valeur du taux de change n'aura pas le même impact en union monétaire. D'une part, le commerce intracommunautaire (62 % du commerce extérieur français, par exemple) s'effectuera essentiellement en euros et non plus en devises étrangères. D'autre part, l'euro, monnaie de la première puissance commerciale mondiale, devrait graduellement devenir une monnaie internationale, utilisée notamment pour la facturation du commerce de l'UE avec le reste du monde. En conséquence, le taux de change aura relativement moins d'impact sur l'économie: c'est d'ailleurs l'un des avantages de l'union monétaire.
Quant à l'"Europe sociale", cette notion est un peu ambiguë: la diversité des taux de chômage en Europe montre que, pour l'essentiel, les solutions sont d'ordre structurel et doivent être recherchées aux niveaux national et local. Mais il reste que le ralliement du Royaume-Uni travailliste à la charte sociale de Maastricht, l'adoption de la résolution relative à la croissance et à l'emploi, l'intégration d'un "chapitre social" dans le traité d'Amsterdam et la convocation, pour l'automne 1997, d'un sommet sur l'emploi ont ouvert des perspectives de renouveau du dialogue social européen. Si ce dialogue conduit à une diminution du chômage, cela ne pourra que renforcer l'acceptabilité et faciliter le fonctionnement de l'union monétaire.
Liens utiles
- grand oral ses : Quelles sont les conséquences économiques de la libre circulation des travailleurs dans le monde du football européen moderne ?
- les défaillances du marché (économie programme de première)
- Sujet: Quelles sont les conséquences économiques de la libre circulation des travailleurs dans le monde du football européen moderne?
- Sujet 1 grand oral : cours particuliers, écoles privées hors contrat… l’école est elle devenue un marché ?
- SUJET SES : En quoi la pratique de l'anglais favorise l'entrée dans le marché du travail ?