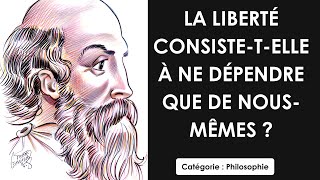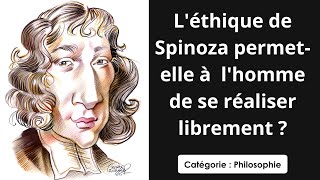TRAJAN, Marcus Ulpius Trajanus
Empereur romain (98/117). Consul en 91, gouverneur de la Germanie supérieure en 96, il fut proclamé empereur par le Sénat en 98, à la mort de Nerva, qui en avait fait son fils adoptif. Sa politique extérieure fut inspirée par des considérations stratégiques (protection contre les Barbares) et économiques : pour assurer à Rome de riches mines d'or, il fit, après deux guerres (101/02 et 105/07), la conquête de la Dacie et, pour contrôler les grandes routes commerciales, il porta la guerre en Orient. Après l'annexion de l'Arabie Pétrée (106), il se battit contre les Parthes (113), s'emparant de l'Arménie, de l'Assyrie et de la Mésopotamie et donnant ainsi à l'Empire son extension extrême. Considéré comme le meilleur des empereurs (le Sénat lui donna le titre d'Optimus), il inaugura l'interventionnisme d'État pour remédier aux problèmes économiques et sociaux, accorda des prêts à intérêt très faible aux petits propriétaires fonciers pour alimenter une caisse chargée d'aider les familles nombreuses, mit en oeuvre un important programme de travaux publics (forum de Trajan, colonne Trajane notamment), et se soucia de l'intégration des provinciaux à l'Empire. Dans le fameux rescrit de Trajan, en réponse à une question de Pline, alors gouverneur de la Bithynie, il maintenait l'interdiction du christianisme et la nécessité de punir les chrétiens s'ils étaient déférés au juge et reconnus tels ; mais il se refusait à organiser contre eux une persécution systématique et défendait de les rechercher. Trajan eut pour successeur Hadrien.
Trajan, Marcus Ulpius Traianus (v. 53-117) ; empereur romain [98-117].
T. naît dans une famille de colons italiens, installés à Italica, en Bétique, qui appartient depuis peu à l’ordre sénatorial : son père avait fait une carrière brillante, couronnée par le proconsulat d’Asie. T. n’est donc pas un « Espagnol », un indigène. Sa carrière se déroule sous les Flaviens : tribun de légion en Syrie (v. 73-74), questeur, préteur (84), légat de la VIIe légion Gemina (86-89), consul ordinaire en 91, gouverneur de Germanie supérieure (en 96). Marqué par la vie des camps, d’une loyauté permanente à l’empereur régnant, T. est extrêmement populaire dans l’armée. Nerva, sans descendant, choisi en 96 par le Sénat pour succéder à Domitien, l’adopte en 97 et l’associe au gouvernement, alors que T. se trouve sur le Rhin où il reste, même à la mort de Nerva (janv. 98). Élu consul une seconde fois (en 98), il veille d’abord à consolider les frontières du Rhin et du Haut-Danube, où des troubles menacent d’éclater parmi les troupes restées fidèles à Domitien. Il rentre à Rome en 99. Sur le plan intérieur, il poursuit et amplifie la politique de ses prédécesseurs mais en ayant une réelle considération envers le Sénat qui lui décernera le titre d’optimus (114), le meilleur. Ainsi, il développe une création de Nerva, celle des alimenta, une sorte d’assistance publique fondée sur des prêts perpétuels consentis à des propriétaires italiens et dont les intérêts étaient versés à des enfants pauvres. En partie grâce à l’énorme butin en métaux précieux provenant des guerres daciques, il améliore l’approvisionnement de Rome en céréales, diminue les impôts, entreprend de grands travaux publics - routes, ponts, canaux, ports (Ostie), aqueducs, thermes et forum de T. à Rome -, perfectionne l’administration centrale, accentue la place donnée aux provinciaux, surveille avec attention et réalisme l’administration des provinces (cf. sa correspondance avec Pline le Jeune, gouverneur de Pont-Bithynie). Mais les grandes affaires du règne sont d’ordre militaire. Deux grandes expéditions (101-102 et 105-107) menées contre le roi des Daces Décébale - expéditions que racontent les bas-reliefs de la colonne Trajane - permettent de soumettre cette région (approximativement l’actuelle Roumanie). Réduite à l’état de province romaine, mise en valeur par la construction de routes, de ponts et par l’implantation de colons, protégée par un limes élevé entre la rivière Prout et la mer Noire, elle devient rapidement un foyer de romanisation intense et durable. En Numidie, la frontière de la colonisation se déplace vers le sud-ouest (camps de la légion à Lambèse, puis à Tim-gad). A l’est, le royaume vassal des Naba-téens est annexé (il devient province d’Arabie, 106), mais l’effort principal est lancé contre les Parthes à la fois pour des raisons psychologiques et de propagande (égaler Alexandre ; reprendre le rêve de César), pour des considérations stratégiques et pour des motifs économiques. Les victoires remportées lors de cette campagne (114-116) -Séleucie, Ctésiphon, Babylone sont prises, les rivages du golfe Persique et de la mer Caspienne sont atteints, l’Arménie, l’Assyrie et la Mésopotamie deviennent provinces cromaines - sont rapidement remises en cause par les soulèvements des vaincus et ceux des Juifs dans tout l’est de l’Empire. Peut-être T. a-t-il surestimé les forces de l’Empire ? T. meurt en Cilicie sur le chemin du retour, sans avoir réglé sa succession. La version officielle - celle de son épouse Plotine -signale l’adoption, sur son lit de mort, de son petit-neveu Hadrien, à qui T. avait confié la Syrie. T., premier empereur issu d’une province, ayant accédé au trône par adoption, incarne un type de souverain fort éloigné de la royauté de droit divin dont se réclamaient certains de ses prédécesseurs, type que prônent alors les stoïciens et les cyniques (cf. Dion de Pruse, dit Chrysostome ; le Panégyrique de Trajan de Pline le Jeune). Le Prince est le premier parmi les meilleurs citoyens de l’Empire. Choisi par la providence divine, agent de Jupiter sur terre, il agit en harmonie avec le dieu suprême et il lui incombe la lourde tâche d’oeuvrer pour le bien de tous. T. redonne au concept augustéen du principat toute sa dignité ; l’art est également marqué par le retour voulu au modèle « classique » des débuts de l’ère nouvelle. Le règne de T. laissa un souvenir éblouissant. Aux empereurs de l’Antiquité tardive, on souhaitera d’être « plus heureux qu’Auguste et meilleurs que Trajan ». Bibliographie : E. Cizek, L'Époque de Trajan, Bucarest/Paris, 1983.
Trajan (Marcus Ulpius Trajanus). Empereur romain de 98 à 117 de notre ère. Né en 53 apr. J.-C. d'une famille originaire d'Ombrie mais établie en Espagne ; son père, l'un des généraux de Vespasien, était devenu consul. Trajan fit une brillante carrière militaire qui lui valut d'être adopté par Nerva en 97, alors qu'il était légat de Germanie supérieure. Lui ayant succédé en 98, il consolida d'abord les positions romaines sur le Rhin et le Danube, avant de se consacrer, avec une extrême compétence, à l'administration de l'Empire. Il s'efforça de rester en bons termes avec le Sénat, fit adopter des mesures sociales telle que l'octroi de subsides alimentaires (alimenta) pour les enfants pauvres d'Italie, et se préoccupa du bon gouvernement des provinces. Trajan fut également un habile homme de guerre : il conquit la Dacie, dont il fit une province romaine ; plus tard, il entreprit une expédition contre les Parthes, s'empara de leur capitale Ctésiphon et parvint jusqu'au golfe Persique. À Rome, il fit construire un forum (Forum Traiani), où s'élevaient la basilique Ulpia, deux bibliothèques et la célèbre colonne commémorant ses victoires sur les Daces; il fit également édifier de nouveaux thermes. Pline le Jeune rédigea un panégyrique de Trajan et échangea avec lui une longue correspondance alors qu'il était gouverneur de Bithynie. Ces lettres révèlent avec quelle conscience et quelle autorité l'empereur étudiait les problèmes qui lui étaient soumis, notamment ceux relatifs aux chrétiens (Pline, Lettres, X, 97), envers lesquels il fit preuve d'humanité et de bon sens. Il mourut en Cilicie, au retour de son expédition contre les Parthes; ses cendres furent déposées à la base de la colonne Trajane. Son règne, qui porta l' Empire romain à sa plus grande extension, laissa le souvenir d'une période de paix et de prospérité et Trajan fut longtemps considéré comme le modèle du parfait empereur.
TRAJAN (Italica, 53-Sélinonte, 117 ap. J.-C.). Empereur romain de la dynastie des Antonins, il régna de 98 à 117. Fils d'une famille italienne installée en Espagne, il fut le premier empereur romain à n'être pas originaire de Rome. Excellent général et remarquable administrateur, il passa auprès des Romains de son temps et des temps qui suivirent pour le « meilleur des empereurs » (Optimus princeps). Adopté par Nerva auquel il succéda en 98 ap. J.-C., Trajan lança l'Empire dans une politique de conquêtes : il conquit la Dacie (actuelle Roumanie), région riche en mines d'or, puis l'Arménie, l'Assyrie et la Mésopotamie contre les Parthes, portant ainsi l'Empire à son extension extrême. A Rome, il gouverna toujours en collaborant avec le Sénat dans lequel il fit entrer de nombreux provinciaux, et entreprit d'importants travaux. Il fit construire le forum de Trajan, la colonne Trajane, agrandir le port d'Ostie, assécher les Marais Pontins (situés au sud de la ville). À l'égard des chrétiens, il se refusa à toute violence et interdit qu'on les recherchât. Son règne fut enfin marqué par une exceptionnelle floraison de grands écrivains (Tacite, Juvénal, Pline le Jeune, Plutarque). Trajan mourut subitement à Sélinonte, en Cilicie, au retour d'une campagne en Orient, laissant le trône à Hadrien.
Liens utiles
- Marcus Ulpius Trajan52-117Le règne de Trajan marque, sans conteste, l'apogée de l'empire romain.
- Trajan.
- Auguste felicior, Traiano melior / Plus heureux qu'Auguste et meilleur que Trajan
- Pline le Jeune, Caïus Plinius Caecilius Secundus62-113L'homme de lettres que fut Pline le Jeune ne doit pas effacer l'homme politique : consul en100, il fut désigné en 111-112 par l'empereur Trajan au gouvernement de Bithynie et du Pont,en qualité de propréteur.
- Nerva, Marcus Cocceius26-98Avec Nerva et le début de la dynastie des Antonins commence pour l'empire romain une èrede prospérité et de stabilité politique.