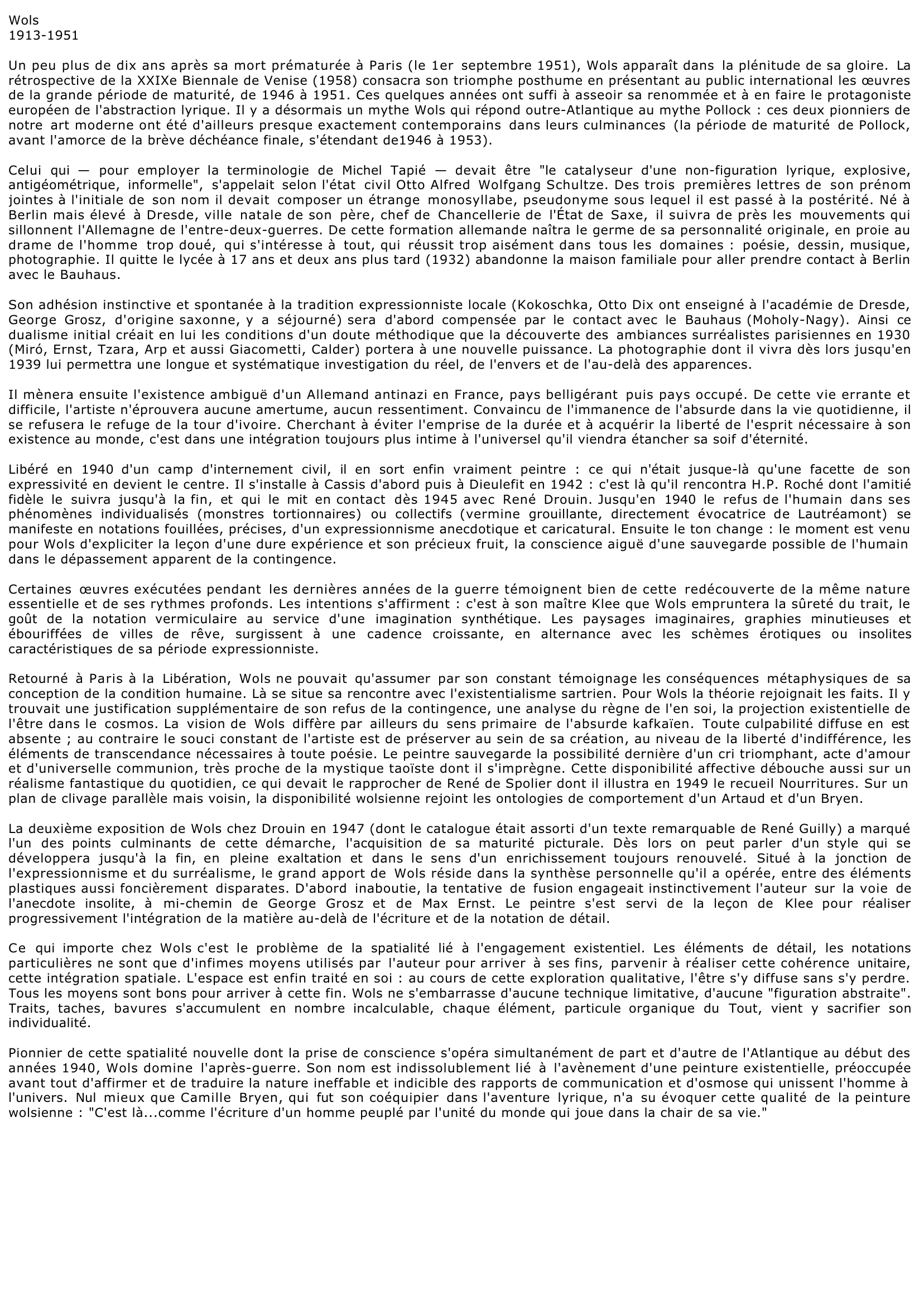Wols
Publié le 16/05/2020

Extrait du document
«
Wols1913-1951
Un peu plus de dix ans après sa mort prématurée à Paris (le 1er septembre 1951), Wols apparaît dans la plénitude de sa gloire.
Larétrospective de la XXIXe Biennale de Venise (1958) consacra son triomphe posthume en présentant au public international les œuvresde la grande période de maturité, de 1946 à 1951.
Ces quelques années ont suffi à asseoir sa renommée et à en faire le protagonisteeuropéen de l'abstraction lyrique.
Il y a désormais un mythe Wols qui répond outre-Atlantique au mythe Pollock : ces deux pionniers denotre art moderne ont été d'ailleurs presque exactement contemporains dans leurs culminances (la période de maturité de Pollock,avant l'amorce de la brève déchéance finale, s'étendant de1946 à 1953).
Celui qui — pour employer la terminologie de Michel Tapié — devait être "le catalyseur d'une non-figuration lyrique, explosive,antigéométrique, informelle", s'appelait selon l'état civil Otto Alfred Wolfgang Schultze.
Des trois premières lettres de son prénomjointes à l'initiale de son nom il devait composer un étrange monosyllabe, pseudonyme sous lequel il est passé à la postérité.
Né àBerlin mais élevé à Dresde, ville natale de son père, chef de Chancellerie de l'État de Saxe, il suivra de près les mouvements quisillonnent l'Allemagne de l'entre-deux-guerres.
De cette formation allemande naîtra le germe de sa personnalité originale, en proie audrame de l'homme trop doué, qui s'intéresse à tout, qui réussit trop aisément dans tous les domaines : poésie, dessin, musique,photographie.
Il quitte le lycée à 17 ans et deux ans plus tard (1932) abandonne la maison familiale pour aller prendre contact à Berlinavec le Bauhaus.
Son adhésion instinctive et spontanée à la tradition expressionniste locale (Kokoschka, Otto Dix ont enseigné à l'académie de Dresde,George Grosz, d'origine saxonne, y a séjourné) sera d'abord compensée par le contact avec le Bauhaus (Moholy-Nagy).
Ainsi cedualisme initial créait en lui les conditions d'un doute méthodique que la découverte des ambiances surréalistes parisiennes en 1930(Miró, Ernst, Tzara, Arp et aussi Giacometti, Calder) portera à une nouvelle puissance.
La photographie dont il vivra dès lors jusqu'en1939 lui permettra une longue et systématique investigation du réel, de l'envers et de l'au-delà des apparences.
Il mènera ensuite l'existence ambiguë d'un Allemand antinazi en France, pays belligérant puis pays occupé.
De cette vie errante etdifficile, l'artiste n'éprouvera aucune amertume, aucun ressentiment.
Convaincu de l'immanence de l'absurde dans la vie quotidienne, ilse refusera le refuge de la tour d'ivoire.
Cherchant à éviter l'emprise de la durée et à acquérir la liberté de l'esprit nécessaire à sonexistence au monde, c'est dans une intégration toujours plus intime à l'universel qu'il viendra étancher sa soif d'éternité.
Libéré en 1940 d'un camp d'internement civil, il en sort enfin vraiment peintre : ce qui n'était jusque-là qu'une facette de sonexpressivité en devient le centre.
Il s'installe à Cassis d'abord puis à Dieulefit en 1942 : c'est là qu'il rencontra H.P.
Roché dont l'amitiéfidèle le suivra jusqu'à la fin, et qui le mit en contact dès 1945 avec René Drouin.
Jusqu'en 1940 le refus de l'humain dans sesphénomènes individualisés (monstres tortionnaires) ou collectifs (vermine grouillante, directement évocatrice de Lautréamont) semanifeste en notations fouillées, précises, d'un expressionnisme anecdotique et caricatural.
Ensuite le ton change : le moment est venupour Wols d'expliciter la leçon d'une dure expérience et son précieux fruit, la conscience aiguë d'une sauvegarde possible de l'humaindans le dépassement apparent de la contingence.
Certaines œuvres exécutées pendant les dernières années de la guerre témoignent bien de cette redécouverte de la même natureessentielle et de ses rythmes profonds.
Les intentions s'affirment : c'est à son maître Klee que Wols empruntera la sûreté du trait, legoût de la notation vermiculaire au service d'une imagination synthétique.
Les paysages imaginaires, graphies minutieuses etébouriffées de villes de rêve, surgissent à une cadence croissante, en alternance avec les schèmes érotiques ou insolitescaractéristiques de sa période expressionniste.
Retourné à Paris à la Libération, Wols ne pouvait qu'assumer par son constant témoignage les conséquences métaphysiques de saconception de la condition humaine.
Là se situe sa rencontre avec l'existentialisme sartrien.
Pour Wols la théorie rejoignait les faits.
Il ytrouvait une justification supplémentaire de son refus de la contingence, une analyse du règne de l'en soi, la projection existentielle del'être dans le cosmos.
La vision de Wols diffère par ailleurs du sens primaire de l'absurde kafkaïen.
Toute culpabilité diffuse en estabsente ; au contraire le souci constant de l'artiste est de préserver au sein de sa création, au niveau de la liberté d'indifférence, leséléments de transcendance nécessaires à toute poésie.
Le peintre sauvegarde la possibilité dernière d'un cri triomphant, acte d'amouret d'universelle communion, très proche de la mystique taoïste dont il s'imprègne.
Cette disponibilité affective débouche aussi sur unréalisme fantastique du quotidien, ce qui devait le rapprocher de René de Spolier dont il illustra en 1949 le recueil Nourritures.
Sur unplan de clivage parallèle mais voisin, la disponibilité wolsienne rejoint les ontologies de comportement d'un Artaud et d'un Bryen.
La deuxième exposition de Wols chez Drouin en 1947 (dont le catalogue était assorti d'un texte remarquable de René Guilly) a marquél'un des points culminants de cette démarche, l'acquisition de sa maturité picturale.
Dès lors on peut parler d'un style qui sedéveloppera jusqu'à la fin, en pleine exaltation et dans le sens d'un enrichissement toujours renouvelé.
Situé à la jonction del'expressionnisme et du surréalisme, le grand apport de Wols réside dans la synthèse personnelle qu'il a opérée, entre des élémentsplastiques aussi foncièrement disparates.
D'abord inaboutie, la tentative de fusion engageait instinctivement l'auteur sur la voie del'anecdote insolite, à mi-chemin de George Grosz et de Max Ernst.
Le peintre s'est servi de la leçon de Klee pour réaliserprogressivement l'intégration de la matière au-delà de l'écriture et de la notation de détail.
Ce qui importe chez Wols c'est le problème de la spatialité lié à l'engagement existentiel.
Les éléments de détail, les notationsparticulières ne sont que d'infimes moyens utilisés par l'auteur pour arriver à ses fins, parvenir à réaliser cette cohérence unitaire,cette intégration spatiale.
L'espace est enfin traité en soi : au cours de cette exploration qualitative, l'être s'y diffuse sans s'y perdre.Tous les moyens sont bons pour arriver à cette fin.
Wols ne s'embarrasse d'aucune technique limitative, d'aucune "figuration abstraite".Traits, taches, bavures s'accumulent en nombre incalculable, chaque élément, particule organique du Tout, vient y sacrifier sonindividualité.
Pionnier de cette spatialité nouvelle dont la prise de conscience s'opéra simultanément de part et d'autre de l'Atlantique au début desannées 1940, Wols domine l'après-guerre.
Son nom est indissolublement lié à l'avènement d'une peinture existentielle, préoccupéeavant tout d'affirmer et de traduire la nature ineffable et indicible des rapports de communication et d'osmose qui unissent l'homme àl'univers.
Nul mieux que Camille Bryen, qui fut son coéquipier dans l'aventure lyrique, n'a su évoquer cette qualité de la peinturewolsienne : "C'est là...comme l'écriture d'un homme peuplé par l'unité du monde qui joue dans la chair de sa vie.".
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓