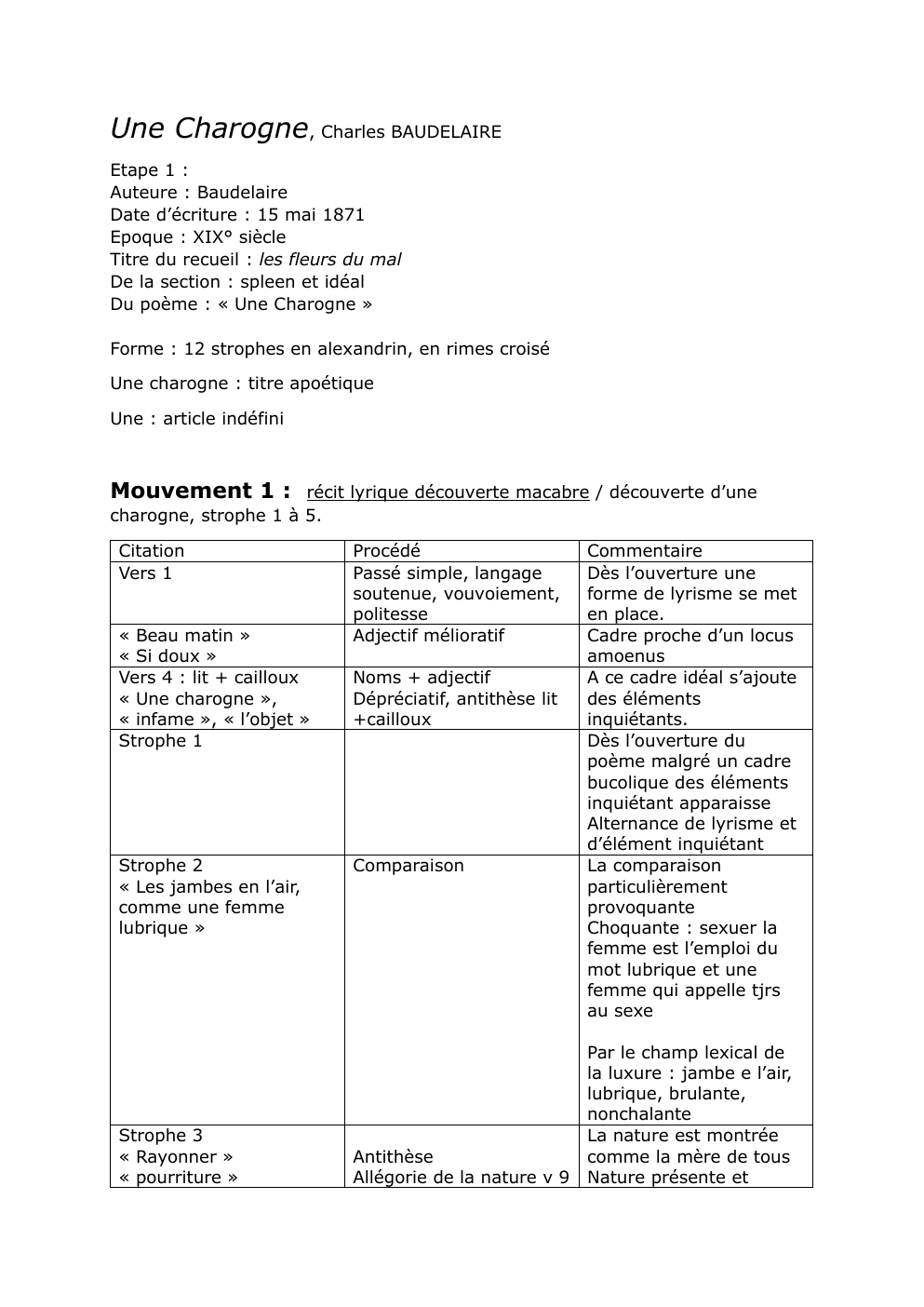Une Charogne, Charles BAUDELAIRE
Publié le 11/01/2024
Extrait du document
«
Une Charogne, Charles BAUDELAIRE
Etape 1 :
Auteure : Baudelaire
Date d’écriture : 15 mai 1871
Epoque : XIX° siècle
Titre du recueil : les fleurs du mal
De la section : spleen et idéal
Du poème : « Une Charogne »
Forme : 12 strophes en alexandrin, en rimes croisé
Une charogne : titre apoétique
Une : article indéfini
Mouvement 1 :
récit lyrique découverte macabre / découverte d’une
charogne, strophe 1 à 5.
Citation
Vers 1
« Beau matin »
« Si doux »
Vers 4 : lit + cailloux
« Une charogne »,
« infame », « l’objet »
Strophe 1
Strophe 2
« Les jambes en l’air,
comme une femme
lubrique »
Strophe 3
« Rayonner »
« pourriture »
Procédé
Passé simple, langage
soutenue, vouvoiement,
politesse
Adjectif mélioratif
Noms + adjectif
Dépréciatif, antithèse lit
+cailloux
Comparaison
Antithèse
Allégorie de la nature v 9
Commentaire
Dès l’ouverture une
forme de lyrisme se met
en place.
Cadre proche d’un locus
amoenus
A ce cadre idéal s’ajoute
des éléments
inquiétants.
Dès l’ouverture du
poème malgré un cadre
bucolique des éléments
inquiétant apparaisse
Alternance de lyrisme et
d’élément inquiétant
La comparaison
particulièrement
provoquante
Choquante : sexuer la
femme est l’emploi du
mot lubrique et une
femme qui appelle tjrs
au sexe
Par le champ lexical de
la luxure : jambe e l’air,
lubrique, brulante,
nonchalante
La nature est montrée
comme la mère de tous
Nature présente et
Le soleil, la nature
Carcasse superbe v13
V9
à 11, personnification su
soleil, du ciel, de la
grande nature
Oxymore
Antithèse
« Comme une fleur
s’épanouir »
Vers 15 et 16
« La puanteur était si
forte … évanouir »
Strophe 5
Adjectif fort
observatrice de la scène
à travers le soleil, la
grande nature et le ciel.
Alternance du beau et du
lait se poursuivent
Baudelaire embellie cette
carcasse de manière
méliorative
« superbe » tout comme
le soleil et le ciel
La provocation du poète
Après la vue c’est
l’odorat qui est ici
sollicité.
La puanteur,
adjectif fort qui ramène
à la réalité du cadavre
La dimension
cadavérique va
l’emporter sur le lyrisme
Confirmation d’un retour
à la réalité du cadavre,
avec des images très
concrètes et des gros
plans.
Dans cette strophe la
description de la
charogne est de plus en
plus minutieuse et
réaliste.
Des acteurs de
sa transformations son
cité « mouche »,
« larve »
Strophe 5
La charogne semble
accouchée de cette
multitude d’insectes qui
s’affairent sur son corps.
L’auteur à recours à
plusieurs enjambements
pour accentuer la
conquête de toute part
de cette population qui
s’active de manière
organisé et déterminé.
(Métaphore miliaire
« noirs bataillons »)
Ce débordement du
corps est également
illustré par le rejet « De
larve » au vers 19
Il insiste sur le tableau
macabre.
C’est le sens de l’oeuïe
qui est sollicité
Bourdonné, sortaient,
vivant ; lexisque du
vivant le cadavre
s’anime de l’intérieur
Vers 17 bourdonné
Mouvement 2 : une charogne sublimée (abstraction de l’horreur) strophe 6
à8
Fascinée par cette découverte de l’animé dans l’inanimé, du spectacle du vivant
surgissant d’un enfer putride, le narrateur tente de communiqué sous l’angle de
la métaphore sa fascination pour cette charogne.
L’analogie à l’art, aux arts et
alors utiliser pour donner un autre point de vue et poursuivre de manière plus
abstraite l’animation du tableau de la charogne.
Citation
Procéder
Commentaire
Vers 21 strophes 6
Tout cela : pronom
indéfinit
Pour désigner de
manière dépréciative et
anonyme ce monde
animé
Comme une vague
Comparaison
Qui poursuit l’animation
du cadavre tout en
éloignant le lecteur de la
représentation réaliste
du début
« Vague »
Répétition, rimes avec
les deux homonymes
« vague »
Cet homonyme renforce
l’idée du mouvement, et
insistance sur la
description et la difficulté
du l’auteur à décrire la
charogne
Vers 21 à 24
Verbe de mouvement
Qui viennent renforcer
l’animation du cadavre
Vers 22
Participe présent
gérondif
L’image et
particulièrement forte et
En pétillant
provocante dans ce
cadre, le therme pétillant
est plutôt associés à la
vie, un caractère joyeux,
aux champagnes
Ici les bulles d’aire
confirme qu’il y a du
mouvement de la vie
Vers 23
Une analogie
Corps
Nom,
Seul mot qui rattache au
concret de la charogne
Vers 24
Emploie ne hyperbole
Pour restituer le miracle
de la vie, l’animation du
cadavre, une forme du
résurrection (on vient à
la vie)
Viver en se multipliant
Vers 25 aux vers 32
L’horreur et le morbide
(mise en spectacle de la
mort) disparaissent
derrière l’alchimie du
vers
Strophes 7 et 8
Le lyrisme ne cesse
d’accompagne la
description de la
charogne ; en
convoquant différent art
Baudelaire poursuit le
travail de transformation
si la musique et la
peinture sont présent les
mots du poète le sont
tout autant et c’est par
l’alchimie du verbe qu’il
réussie à mettre en
mouvement son
tableau.il l’anime par
une vision purement
abstraite
Strophe 7
Vers 25 et 27 étrange....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ORAL DU BAC : FICHE DE SYNTHÈSE Texte n° 1 Séquence n°1 Titre : Une charogne Année : 1857 Auteur : Charles Baudelaire
- « Une charogne » de Charles Baudelaire
- Notes sur le poème « Le Goût du Néant » de Charles Baudelaire.
- Lecture analytique du poème "Le goût du néant" de Charles Baudelaire
- analyse lineaire charogne de baudelaire