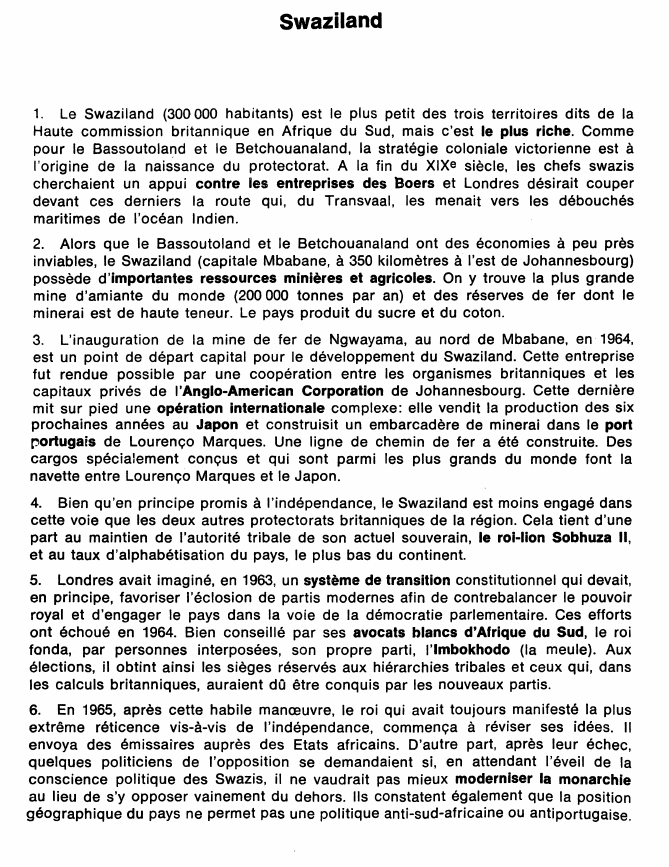Swaziland
Publié le 15/05/2020

Extrait du document
«
1 / 2 13 octobre 1965 Série N• 65 Fiche N• 777
Swaziland
1.
Le Swaziland (300 000 habitants) est le plus petit des trois territoires dits de la
Haute commission britannique en Afrique du Sud, mais c'est le plus riche.
Comme pour le Bassoutoland et le Betchouanaland, la stratégie coloniale victorienne est à l'origine de la naissance du protectorat.
A la fin du XIXe siècle, les chefs swazis
cherchaient un appui contre les entreprises des Boers et Londres désirait couper
devant ces derniers la route qui, du Transvaal, les menait vers les débouchés
maritimes de l'océan
Indien.
2.
Alors que le Bassoutoland et le Betchouanaland ont des économies à peu près
inviables, le Swaziland (capitale Mbabane, à 350 kilomètres à l'est de Johannesbourg)
possède d'Importantes ressources minières et agricoles.
On y trouve la plus grande
mine d'amiante du monde (200 000 tonnes par an) et des réserves de fer dont le
minerai est de haute teneur.
Le pays produit du sucre et du coton.
3.
L'inauguration de la mine de fer de Ngwayama, au nord de Mbabane, en 1964, est un point de départ capital pour le développement du Swaziland.
Cette entreprise
fut rendue possible par une coopération entre les organismes britanniques et les
capitaux privés de
I'Anglo-American Corporation de Johannesbourg.
Cette dernière
mit sur pied une opération Internationale complexe: elle vendit la production des six
prochaines années au Japon et construisit un embarcadère de minerai dans le port portugais de Lourenço Marques.
Une ligne de chemin de fer a été construite.
Des cargos spécialement conçus et qui sont parmi les plus grands du monde font la
navette entre Lourenço Marques et le Japon.
4.
Bien qu'en principe promis à l'indépendance, le Swaziland est moins engagé dans
cette voie que les deux autres protectorats britanniques de la région.
Cela tient d'une
part au maintien de l'autorité tribale de son actuel souverain, le roi-lion Sobhuza Il, et au taux d'alphabétisation du pays, le plus bas du continent.
5.
Londres avait imaginé, en 1963, un système de transition constitutionnel qui devait,
en principe, favoriser l'éclosion de partis modernes afin de contrebalancer le pouvoir
royal et d'engager le pays dans la voie de la démocratie parlementaire.
Ces efforts ont échoué en 1964.
Bien conseillé par ses avocats blancs d'Afrique du Sud, le roi
fonda, par personnes interposées, son propre parti, l'lmbokhodo (la meule).
Aux
élections,
il obtint ainsi les sièges réservés aux hiérarchies tribales et ceux qui, dans
les calculs britanniques, auraient dO être conquis par les nouveaux partis.
6.
En 1965, après cette habile manœuvre, le roi qui avait toujours manifesté la plus
extrême réticence vis-à-vis de l'indépendance, commença à réviser ses idées.
Il envoya des émissaires auprès des Etats africains.
D'autre part, après leur échec,
quelques politiciens de l'opposition se demandaient si, en attendant l'éveil de la
conscience politique des Swazis, il ne vaudrait pas mieux moderniser la monarchie au lieu de s'y opposer vainement du dehors.
Ils constatent également que la position
géographique du pays ne permet pas une politique anti-sud-africaine ou antiportugaise.
2 / 2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Swaziland (2000-2001) : Intransigeance de la famille royale
- Swaziland (1999-2000) Revendications en faveur des libertés publiques
- Swaziland (1990-1991)
- Swaziland (1989-1990)
- Swaziland (2005-2006): Vers l« extinction du peuple swazi » ?