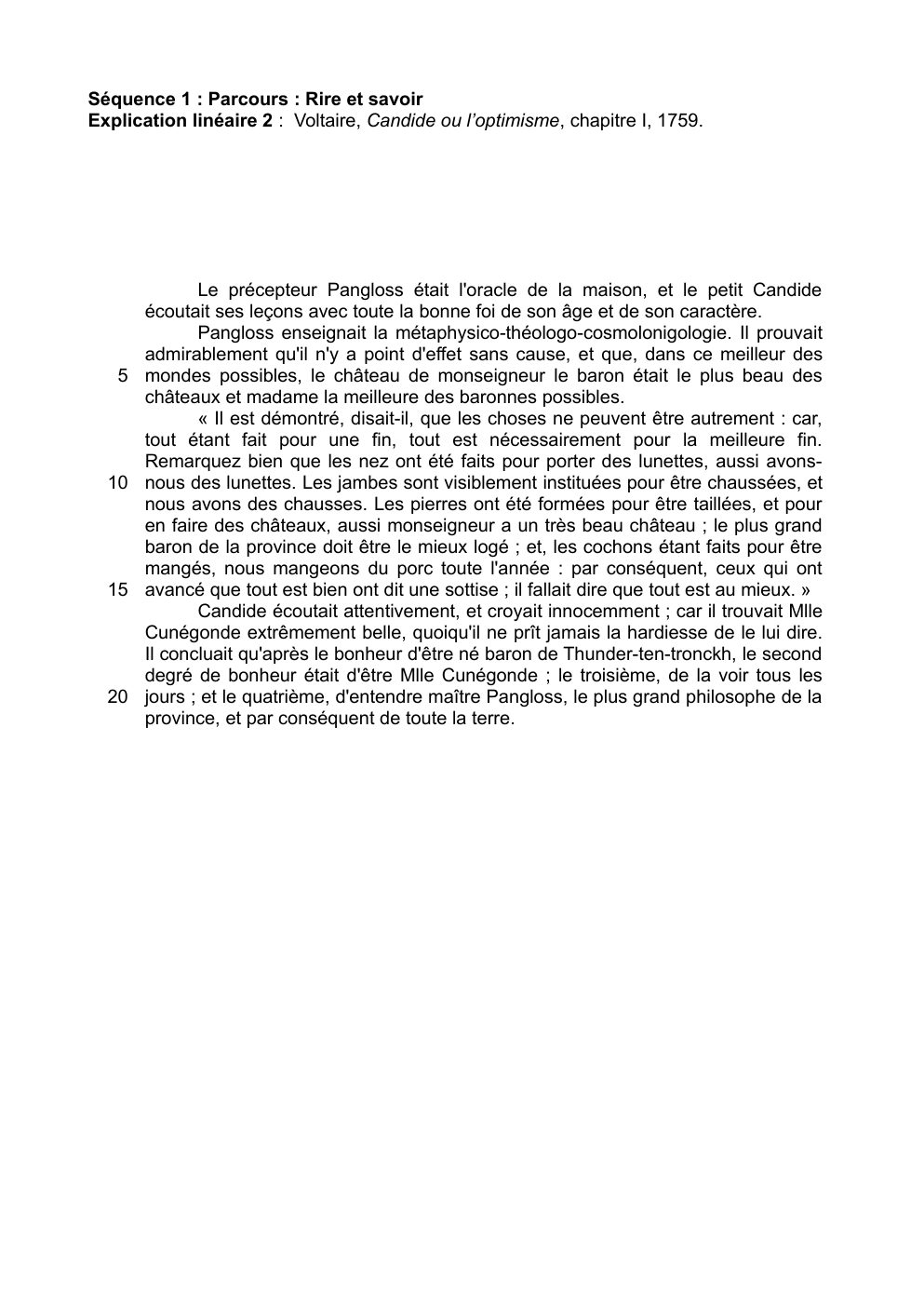Séquence 1 : Parcours : Rire et savoir Explication linéaire 2 : Voltaire, Candide ou l’optimisme, chapitre I, 1759.
Publié le 20/05/2024
Extrait du document
«
Séquence 1 : Parcours : Rire et savoir
Explication linéaire 2 : Voltaire, Candide ou l’optimisme, chapitre I, 1759.
5
10
15
20
Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide
écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère.
Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie.
Il prouvait
admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que, dans ce meilleur des
mondes possibles, le château de monseigneur le baron était le plus beau des
châteaux et madame la meilleure des baronnes possibles.
« Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement : car,
tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin.
Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avonsnous des lunettes.
Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et
nous avons des chausses.
Les pierres ont été formées pour être taillées, et pour
en faire des châteaux, aussi monseigneur a un très beau château ; le plus grand
baron de la province doit être le mieux logé ; et, les cochons étant faits pour être
mangés, nous mangeons du porc toute l'année : par conséquent, ceux qui ont
avancé que tout est bien ont dit une sottise ; il fallait dire que tout est au mieux.
»
Candide écoutait attentivement, et croyait innocemment ; car il trouvait Mlle
Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire.
Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thunder-ten-tronckh, le second
degré de bonheur était d'être Mlle Cunégonde ; le troisième, de la voir tous les
jours ; et le quatrième, d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la
province, et par conséquent de toute la terre.
Chapitre 3 :LL2 : Voltaire, Candide ou l’Optimisme, 1759
(cf p.
343-345 de l’édition Hatier pour le lien avec le parcours)
Première approche :
1- Paratexte :
- Voltaire a 65 ans (1694-1778) quand il écrit Candide, L'article "Genève" de L'Encyclopédie, que Voltaire
inspire à d'Alembert suscite la tempête chez les pasteurs : les antiphilosophes veulent l'expulser de la
propriété des délices, qu'il avait acquis en 1755.
En 1758, il achète la propriété de Ferney, située à cheval sur
la frontière franco-suisse, pour se mettre à l'abri.
C'est cette année-là qu'il rédige Candide, conte
philosophique Il sera publié en 1759, sous couvert de l'anonymat, puis du pseudonyme en 1761.
- 25 février 1759, sur ordre du Parlement, la police s’empare des feuilles qui sortent des presses.
Le Petit
Conseil de Genève en ordonne aussi la saisie, le 26 car l’ouvrage serait « rempli de principes dangereux par
rapport à la religion et tendant à la dépravation des mœurs ».
-> succès auprès des lecteurs, six mille
exemplaires vendus en quelques semaines, dès mars, 5 éditions à Paris.
conte philosophique [Le genre du conte philosophique allié à celui du roman d'aventure permet de présenter
de manière vivante une partie des réflexions qui se trouvaient développées sous une forme plus théorique
dans l'Encyclopédie de façon à favoriser leur vulgarisation.
L'ouverture du conte est révélatrice de cette
méthode] écrit pour contester l’idée du philosophe allemand Leibniz (1646-1716à selon qui est tout est pour
le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Cette philosophie, l’optimisme, a pour grand représentant
Pangloss, la figure du savant, dont le discours fait ici l’objet de l’ironie du narrateur.
Problématique : Comment le discours du philosophe Pangloss apparait-il comme ridicule et son
enseignement néfaste ?
2- Lecture et compréhension du texte (ridiculisation du philosophe)
l.
1- 6 : présentation ridicule du personnage
l.
7- 14 : présentation par le DD de son raisonnement faussé
l.
15-19 : résultat de son enseignement sur le raisonnement de Candide
3- Explication linéaire
l.
1-6 : présentation ridicule du personnage
l.
1 « Pangloss »
Onomastique < Grec
pan = tout + glossa =
langue donne « tout en
discours »
l.
1 « l’oracle »
Hyperbole / attribut du
sujet
= qui ne fait que parler - et suggère un
vain bavardage.
En effet le
personnage parle toujours et cherche à
tout justifier par le discours.
Prétentieux.
Une autorité pratiquement divine, qui va
distribuer des prophéties.
Le précepteur est présenté de manière
exagérée comme celui dont la pensée
imprègne celle des autres personnages,
sans aucune contradiction.
l.
1 « le petit Candide »
Adjectif hypocoristique
onomastique
- Affection du narrateur pour le
personnage de naïf (dont il prend le
parti)
- passivité du personnage crédule
l.
2 « écoutait »
verbe
l.
2 « avec toute la bonne foi Cc de manière
de son âge et de son
Insistance sur la bonté et la naïveté de
Candide, qui l’excusent, traduisant sa
caractère »
confiance [annonce de la suite du récit :
on devine que Candide va
progressivement avoir un regard critique
sur le discours de Pangloss.]
l.
3 « métaphysico-théologo- Succession de préfixes
cosmolonigologie »
scientifiques
(métaphysique =
connaissance de l’être ;
théologie = religion ;
cosmo = monde ; nigo =
nigaud)
Terme pompeux qui s'achève
burlesquement par l'expression nigologie - (la science, logos en grec,
des nigauds « nigo ») ; ridiculisation du
savoir du personnage, blâme de son
enseignement => parodie du jargon
pédant des philosophes
l.
4 « admirablement »
adverbe
Ironie du narrateur qui feint d’être
d’accord avec Pangloss pour mieux
montrer la stupidité de ses propos.
l.
4 « qu’il n’y a point
d’effet sans causes »
Prop.
Sub.
complétive
Ironie : c’est une évidence inutile à
démontrer
l.
5-6 « le plus beau des....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture linéaire Candide - Candide – chapitre 3
- lecture linéaire candide ou l'optimisme: l’idée du philosophe allemand Leibniz, selon laquelle tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible
- explication linéaire gargantua chapitre 4
- Rien n'était si beau... Candide. Chapitre III, de Voltaire (commentaire)
- L'image de l'Amour et de la Femme dans Candide ou L'Optimisme de Voltaire.