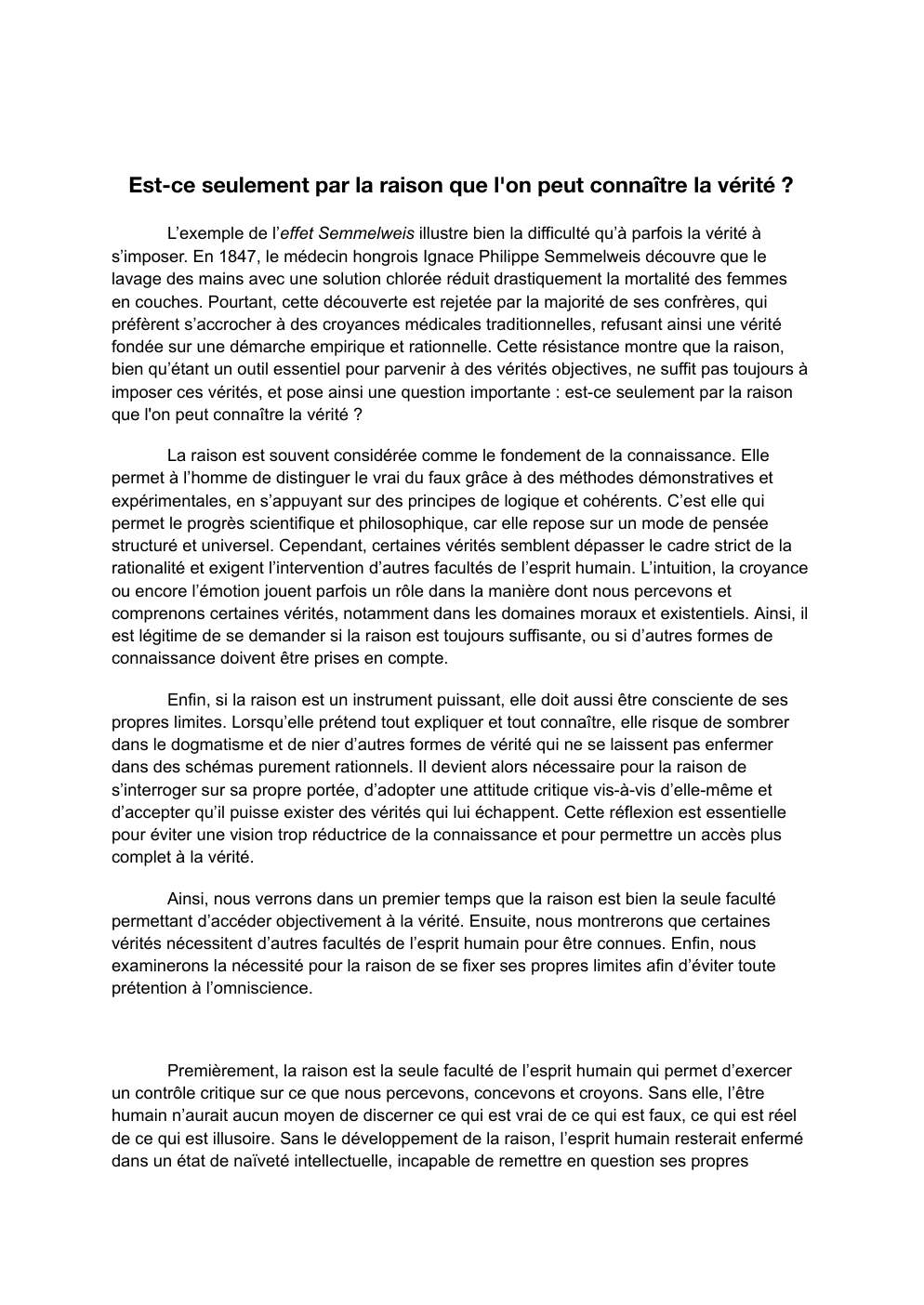Philo: est-ce seulement par la raison que l'on peut connaître la vérité ?
Publié le 02/05/2025
Extrait du document
«
Est-ce seulement par la raison que l'on peut connaître la vérité ?
L’exemple de l’effet Semmelweis illustre bien la difficulté qu’à parfois la vérité à
s’imposer.
En 1847, le médecin hongrois Ignace Philippe Semmelweis découvre que le
lavage des mains avec une solution chlorée réduit drastiquement la mortalité des femmes
en couches.
Pourtant, cette découverte est rejetée par la majorité de ses confrères, qui
préfèrent s’accrocher à des croyances médicales traditionnelles, refusant ainsi une vérité
fondée sur une démarche empirique et rationnelle.
Cette résistance montre que la raison,
bien qu’étant un outil essentiel pour parvenir à des vérités objectives, ne suffit pas toujours à
imposer ces vérités, et pose ainsi une question importante : est-ce seulement par la raison
que l'on peut connaître la vérité ?
La raison est souvent considérée comme le fondement de la connaissance.
Elle
permet à l’homme de distinguer le vrai du faux grâce à des méthodes démonstratives et
expérimentales, en s’appuyant sur des principes de logique et cohérents.
C’est elle qui
permet le progrès scientifique et philosophique, car elle repose sur un mode de pensée
structuré et universel.
Cependant, certaines vérités semblent dépasser le cadre strict de la
rationalité et exigent l’intervention d’autres facultés de l’esprit humain.
L’intuition, la croyance
ou encore l’émotion jouent parfois un rôle dans la manière dont nous percevons et
comprenons certaines vérités, notamment dans les domaines moraux et existentiels.
Ainsi, il
est légitime de se demander si la raison est toujours suffisante, ou si d’autres formes de
connaissance doivent être prises en compte.
Enfin, si la raison est un instrument puissant, elle doit aussi être consciente de ses
propres limites.
Lorsqu’elle prétend tout expliquer et tout connaître, elle risque de sombrer
dans le dogmatisme et de nier d’autres formes de vérité qui ne se laissent pas enfermer
dans des schémas purement rationnels.
Il devient alors nécessaire pour la raison de
s’interroger sur sa propre portée, d’adopter une attitude critique vis-à-vis d’elle-même et
d’accepter qu’il puisse exister des vérités qui lui échappent.
Cette réflexion est essentielle
pour éviter une vision trop réductrice de la connaissance et pour permettre un accès plus
complet à la vérité.
Ainsi, nous verrons dans un premier temps que la raison est bien la seule faculté
permettant d’accéder objectivement à la vérité.
Ensuite, nous montrerons que certaines
vérités nécessitent d’autres facultés de l’esprit humain pour être connues.
Enfin, nous
examinerons la nécessité pour la raison de se fixer ses propres limites afin d’éviter toute
prétention à l’omniscience.
Premièrement, la raison est la seule faculté de l’esprit humain qui permet d’exercer
un contrôle critique sur ce que nous percevons, concevons et croyons.
Sans elle, l’être
humain n’aurait aucun moyen de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est réel
de ce qui est illusoire.
Sans le développement de la raison, l’esprit humain resterait enfermé
dans un état de naïveté intellectuelle, incapable de remettre en question ses propres
croyances et celles imposées par la société.
Platon illustre cette nécessité dans La
République, lorsqu’il critique la manière dont les enfants sont éduqués avant d’avoir atteint «
l’âge de raison ».
Avant cet âge, l’enfant ne dispose pas encore des capacités rationnelles
lui permettant de distinguer une fiction d’une vérité.
Son esprit est extrêmement
impressionnable, et tout ce qui lui est enseigné s’ancre profondément en lui, sans qu’il
puisse exercer un doute critique.
Platon dénonce particulièrement l’influence des poètes et
des rhapsodes, qui transmettent aux jeunes esprits des récits où les dieux se comportent
comme des hommes, animés par des passions violentes et irrationnelles.
Ces récits sont
dangereux, car ils conduisent les enfants à adopter des représentations erronées du divin et
de la moralité, sans jamais les remettre en question.
Platon insiste sur le fait que si ces
croyances ne sont pas corrigées par la raison à l’âge adulte, elles deviennent « indélébiles
et inébranlables ».
L’individu reste alors prisonnier d’une vision déformée du monde,
incapable de distinguer le mythe de la vérité.
C’est pourquoi Platon recommande que
l’éducation soit orientée de manière à guider progressivement l’enfant vers la raison, afin
qu’il puisse, une fois son esprit pleinement développé, juger par lui-même ce qui est vrai ou
faux.
Dans le langage courant, l’« âge de raison » désigne précisément ce moment du
développement psychologique où l’enfant commence à exercer une pensée rationnelle, où il
cesse d’accepter passivement tout ce qui lui est dit et commence à questionner, à analyser
et à comprendre par lui-même.
Cet usage du terme montre bien que la raison est perçue
comme une faculté essentielle à la connaissance : sans elle, l’être humain resterait dans
une forme d’infantilisme intellectuel, incapable d’accéder à la vérité autrement que par une
acceptation aveugle de ce qui lui est transmis.
En plus de cela, si la raison est essentielle à l’établissement de la vérité, c’est parce
qu’elle est la seule faculté capable de critiquer et de rectifier les erreurs produites par les
autres modes de connaissance.
L’imagination, la mémoire, la perception et le langage sont
des outils cognitifs indispensables, mais ils ne sont pas fiables en eux-mêmes : ils doivent
être contrôlés et corrigés par la raison pour éviter les illusions et les erreurs.
Gaston
Bachelard, dans La psychanalyse du feu, illustre cette nécessité en montrant que notre
première appréhension du monde est toujours marquée par des illusions et des préjugés.
Il
prend l’exemple du rapport de l’homme au feu : depuis l’Antiquité, l’homme a attribué au feu
des propriétés mystérieuses et irrationnelles, basées sur l’émotion et l’imagination plutôt que
sur l’analyse critique.
Loin d’être un simple phénomène physique, le feu a été perçu comme
une force vivante, dotée d’une volonté propre, donnant naissance à de nombreuses
croyances erronées.
Bachelard explique que l’objectivité scientifique ne peut être atteinte
qu’en rompant avec ces premières impressions et en exerçant une discipline critique stricte.
Il insiste sur le fait que la pensée scientifique doit se méfier des préjugés que nous portons
sur des images et des analogies trompeuses.
Pour connaître la vérité sur un phénomène, il
ne suffit pas de s’appuyer sur nos perceptions ou notre expérience immédiate : il faut
soumettre ces impressions à un examen rationnel rigoureux, capable de démentir nos
intuitions premières.
Ainsi, Bachelard rejoint Platon en affirmant que la raison est la seule
faculté qui permet à l’homme d’échapper aux illusions produites par son propre esprit.
Sans
elle, nous resterions prisonniers de nos perceptions immédiates et de nos croyances
spontanées, incapables de distinguer ce qui est une connaissance véritable de ce qui n’est
qu’une illusion.
La raison apparaît donc comme l’unique faculté permettant à l’homme d’accéder à la
vérité.
Platon montre qu’elle est indispensable pour éviter l’adhésion aveugle aux mythes et
aux croyances enfantines, tandis que Bachelard insiste sur sa nécessité pour corriger les
illusions produites par l’imagination et la perception.
Sans la raison, l’homme resterait
enfermé dans un état d’ignorance et de crédulité, incapable de remettre en question ce qui
lui est enseigné.
Cependant, si la raison est un outil puissant pour atteindre la vérité, elle
n’est peut-être pas suffisante pour connaître toutes les formes de vérité.
Certaines
croyances, comme la génération spontanée, ont persisté longtemps malgré la rationalité, ce
qui interroge sur les limites de la raison et sur la place d’autres facultés dans la
connaissance.
Effectivement, si la raison est une faculté essentielle dans l’accès à la vérité, elle ne
peut cependant pas tout expliquer par elle-même.
Certaines vérités fondamentales
échappent au raisonnement démonstratif et ne peuvent être connues que par une autre
faculté de l’esprit : l’intuition.
Blaise Pascal, dans Les Pensées, remet en question l’idée
selon laquelle toute connaissance véritable devrait être fondée sur la seule raison.
Il affirme
que certains principes premiers, comme ceux des mathématiques, ne sont pas
démontrables rationnellement, mais sont néanmoins indubitables.
Selon Pascal, « nous
connaissons la vérité, non seulement par la raison, mais encore par le cœur », ce qui
signifie que l’intuition joue un rôle indispensable dans notre accès à certaines
connaissances.
Il prend l’exemple de certaines propositions non démontrées (axiomes) en
mathématiques, comme l’existence des trois dimensions de l’espace ou l’infinité des
nombres.
Ces principes sont évidents en eux-mêmes, et c’est par une forme d’intuition
immédiate que nous les saisissons.
La raison ne peut pas démontrer ces vérités : elle doit
s’appuyer sur elles comme sur des fondements indiscutables.
Prenons l’exemple des
dimensions de l’espace : nous savons intuitivement qu’un objet a une longueur, une largeur
et une hauteur, mais il est impossible de démontrer rationnellement pourquoi l’espace
possède précisément trois dimensions et non quatre ou cinq.
De même, l’idée d’infini en
mathématiques ne peut être entièrement saisie par la raison.
Nous comprenons
spontanément qu’il existe une infinité de nombres, mais cette notion échappe à toute
explication purement rationnelle.
L’infini ne peut être défini que de manière approximative,
car il dépasse les limites de la pensée logique et quantitative.
Pascal insiste sur le fait que la
raison ne peut pas tout expliquer et qu’elle doit reconnaître ses propres limites.
Il critique
ceux qui, comme les sceptiques, tentent....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- cours philosophie raison et vérité
- François Mauriac écrit : « Les personnages fictifs et irréels nous aident à nous mieux connaître et à prendre conscience de nous-mêmes... Et c'est sans doute notre raison d'être, c'est ce qui légitime notre absurde et étrange métier que cette création d'un monde irréel grâce auquel les hommes vivants voient plus clair dans leur propre coeur et peuvent se témoigner les uns aux autres plus de compréhension et de pitié. »
- « Les héros des grands romanciers, même quand l'auteur ne prétend rien prouver ni rien démontrer, détiennent une vérité qui peut n'être pas la même pour chacun de nous, mais qu'il appartient à chacun de nous de découvrir et de s'appliquer. Et c'est sans doute notre raison d'être, c'est ce qui légitime notre absurde et étrange métier que cette création d'un monde idéal grâce auquel les hommes vivants voient plus clair dans leur propre coeur et peuvent se témoigner les uns aux autres pl
- « Je verrai le roi, je lui ferai connaître la vérité ; il est impossible qu'on ne se rende pas à cette vérité quand on la sent ». Voltaire, L'Ingénu, chapitre 8. Vous imaginerez le discours tenu au roi par l'ingénu une fois parvenu devant lui à Versailles, pour lui faire part de tous les désordres du royaume tels qu'il a pu lui-même les observer. Ce discours visera à convaincre ou à persuader le roi d'y mettre un terme.
- Hume: « Qu'est-ce que la raison peut connaître du réel sans le secours de l'expérience ? »