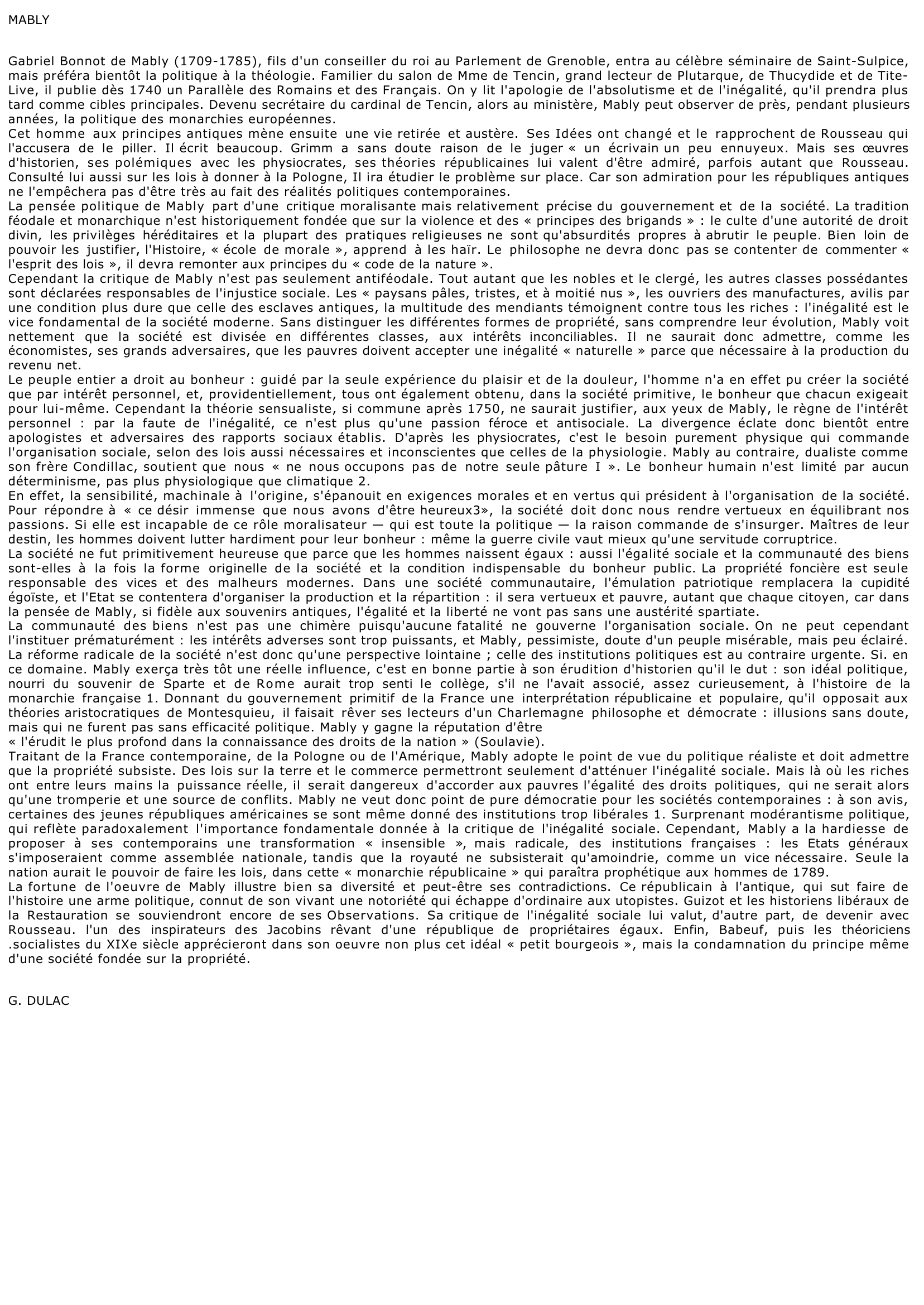MABLY
Publié le 15/05/2020

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : MABLY Ce document contient 1197 mots soit 3 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Philosophie.
MABLY Gabriel Bonnot de. Philosophe français. Né à Grenoble le 14 mars 1709, mort à Paris le 23 avril 1785. Frère de Condillac, il fit ses premières études au Collège des jésuites de Lyon, puis entra au Séminaire de Saint-Sulpice à Paris mais il ne fut pas ordonné prêtre et abandonna la vie ecclésiastique après le sous-diaconat. S’étant fait remarquer par son intelligence dans le salon de Mme de Tencin, qui était une de ses parentes éloignées, Mably fit partie du cabinet du cardinal de Tencin lorsque celui-ci entra au ministère; c’est lui qui rédigea en 1743 le projet de traité porté par Voltaire à Frédéric II et qui, trois ans plus tard, fut chargé de préparer les négociations du traité de Breda. Mais le cardinal ayant eu, en sa qualité d’archevêque de Lyon, à imposer la rupture d’un mariage mixte conclu entre un catholique et une protestante, Mably protesta au nom de la tolérance et se sépara brusquement de son protecteur. Pendant les quelque quarante années qui lui restaient à vivre, il allait se tenir fermement éloigné des affaires et de la vie mondaine, et se consacrer entièrement à l’étude. Ainsi, par le tempérament d’abord, il apparaît très différent des autres « philosophes » ; il ne partage nullement leur optimisme, il ne croit pas marcher à l’avant-garde des « lumières ». Mably vit seul parce qu’il déteste son siècle et parce qu’il est indigné par la déchéance des mœurs. C’est la misanthropie qui lui suggérera des pensées révolutionnaires, mais sans qu’il ait rien lui-même d’un agitateur, car il paraît aussi désespéré de l’avenir que du présent — cf. Parallèle des Romains et des Français, par rapport au gouvernement (1740) et Observations sur les Romains (1751). L’allure toute abstraite que garde constamment sa pensée politique fait de lui une excellente illustration de la thèse fameuse de Taine sur la continuité entre l’« esprit classique » et l’idéologie de 89. Mably, qui reporte sur toute l’histoire monarchique l’aversion qui lui inspire le règne de Louis XV — Observations sur l’histoire de France (1765) — fut un des inspirateurs directs des législateurs révolutionnaires : adversaire du pouvoir royal, il souhaite en particulier que soit enlevée à celui-ci la disposition des finances et de l’armée, confiée à une assemblée unique, non pas toutefois élue au suffrage universel, car le penseur si radical qu’est Mably se trouve, par un piquant paradoxe, le promoteur de ce système censitaire qui reste le symbole des demi-mesures libérales de la bourgeoisie du début du XIXe siècle — Des droits et des devoirs du citoyen (1758) et Traité de la législation (1776). Parmi les autres ouvrages de Mably, citons : Le Droit public de l’Europe fondé sur les traités, depuis la paix de Westphalie jusqu’à nos jours (1764), De l’idée de l’histoire (1778), manuel politique composé pour un jeune prince de la famille de Bourbon devenu duc de Parme en 1765, et De la manière d’écrire l’histoire (1783), où Mably prend vivement à partie les historiens de son temps, en particulier Gibbon, Hume et Voltaire.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓