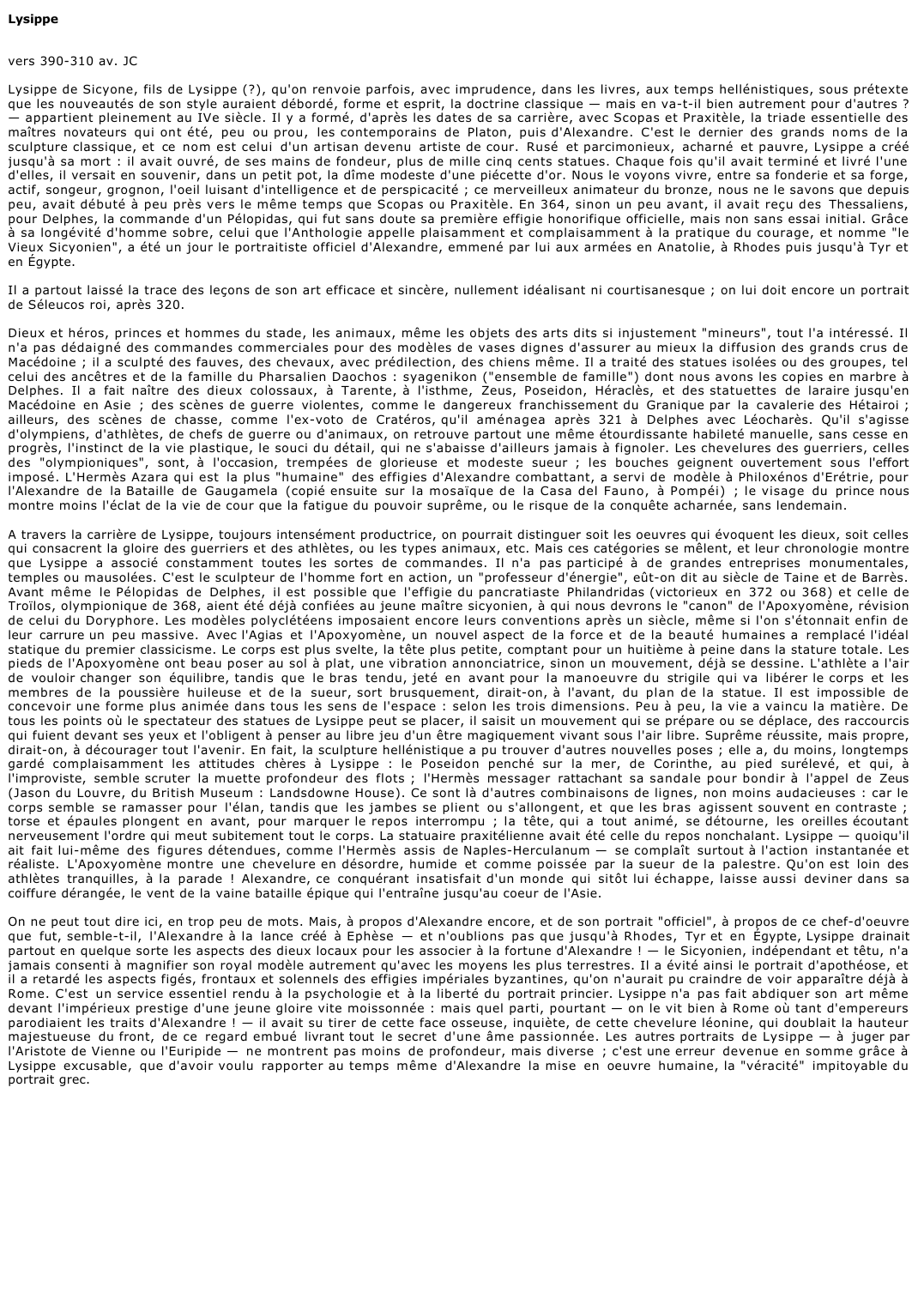Lysippe
Publié le 16/05/2020

Extrait du document
«
Lysippe
vers 390-310 av.
JC
Lysippe de Sicyone, fils de Lysippe (?), qu'on renvoie parfois, avec imprudence, dans les livres, aux temps hellénistiques, sous prétexteque les nouveautés de son style auraient débordé, forme et esprit, la doctrine classique — mais en va-t-il bien autrement pour d'autres ?— appartient pleinement au IVe siècle.
Il y a formé, d'après les dates de sa carrière, avec Scopas et Praxitèle, la triade essentielle desmaîtres novateurs qui ont été, peu ou prou, les contemporains de Platon, puis d'Alexandre.
C'est le dernier des grands noms de lasculpture classique, et ce nom est celui d'un artisan devenu artiste de cour.
Rusé et parcimonieux, acharné et pauvre, Lysippe a crééjusqu'à sa mort : il avait ouvré, de ses mains de fondeur, plus de mille cinq cents statues.
Chaque fois qu'il avait terminé et livré l'uned'elles, il versait en souvenir, dans un petit pot, la dîme modeste d'une piécette d'or.
Nous le voyons vivre, entre sa fonderie et sa forge,actif, songeur, grognon, l'oeil luisant d'intelligence et de perspicacité ; ce merveilleux animateur du bronze, nous ne le savons que depuispeu, avait débuté à peu près vers le même temps que Scopas ou Praxitèle.
En 364, sinon un peu avant, il avait reçu des Thessaliens,pour Delphes, la commande d'un Pélopidas, qui fut sans doute sa première effigie honorifique officielle, mais non sans essai initial.
Grâceà sa longévité d'homme sobre, celui que l'Anthologie appelle plaisamment et complaisamment à la pratique du courage, et nomme "leVieux Sicyonien", a été un jour le portraitiste officiel d'Alexandre, emmené par lui aux armées en Anatolie, à Rhodes puis jusqu'à Tyr eten Égypte.
Il a partout laissé la trace des leçons de son art efficace et sincère, nullement idéalisant ni courtisanesque ; on lui doit encore un portraitde Séleucos roi, après 320.
Dieux et héros, princes et hommes du stade, les animaux, même les objets des arts dits si injustement "mineurs", tout l'a intéressé.
Iln'a pas dédaigné des commandes commerciales pour des modèles de vases dignes d'assurer au mieux la diffusion des grands crus deMacédoine ; il a sculpté des fauves, des chevaux, avec prédilection, des chiens même.
Il a traité des statues isolées ou des groupes, telcelui des ancêtres et de la famille du Pharsalien Daochos : syagenikon ("ensemble de famille") dont nous avons les copies en marbre àDelphes.
Il a fait naître des dieux colossaux, à Tarente, à l'isthme, Zeus, Poseidon, Héraclès, et des statuettes de laraire jusqu'enMacédoine en Asie ; des scènes de guerre violentes, comme le dangereux franchissement du Granique par la cavalerie des Hétairoi ;ailleurs, des scènes de chasse, comme l'ex-voto de Cratéros, qu'il aménagea après 321 à Delphes avec Léocharès.
Qu'il s'agissed'olympiens, d'athlètes, de chefs de guerre ou d'animaux, on retrouve partout une même étourdissante habileté manuelle, sans cesse enprogrès, l'instinct de la vie plastique, le souci du détail, qui ne s'abaisse d'ailleurs jamais à fignoler.
Les chevelures des guerriers, cellesdes "olympioniques", sont, à l'occasion, trempées de glorieuse et modeste sueur ; les bouches geignent ouvertement sous l'effortimposé.
L'Hermès Azara qui est la plus "humaine" des effigies d'Alexandre combattant, a servi de modèle à Philoxénos d'Erétrie, pourl'Alexandre de la Bataille de Gaugamela (copié ensuite sur la mosaïque de la Casa del Fauno, à Pompéi) ; le visage du prince nousmontre moins l'éclat de la vie de cour que la fatigue du pouvoir suprême, ou le risque de la conquête acharnée, sans lendemain.
A travers la carrière de Lysippe, toujours intensément productrice, on pourrait distinguer soit les oeuvres qui évoquent les dieux, soit cellesqui consacrent la gloire des guerriers et des athlètes, ou les types animaux, etc.
Mais ces catégories se mêlent, et leur chronologie montreque Lysippe a associé constamment toutes les sortes de commandes.
Il n'a pas participé à de grandes entreprises monumentales,temples ou mausolées.
C'est le sculpteur de l'homme fort en action, un "professeur d'énergie", eût-on dit au siècle de Taine et de Barrès.Avant même le Pélopidas de Delphes, il est possible que l'effigie du pancratiaste Philandridas (victorieux en 372 ou 368) et celle deTroïlos, olympionique de 368, aient été déjà confiées au jeune maître sicyonien, à qui nous devrons le "canon" de l'Apoxyomène, révisionde celui du Doryphore.
Les modèles polyclétéens imposaient encore leurs conventions après un siècle, même si l'on s'étonnait enfin deleur carrure un peu massive.
Avec l'Agias et l'Apoxyomène, un nouvel aspect de la force et de la beauté humaines a remplacé l'idéalstatique du premier classicisme.
Le corps est plus svelte, la tête plus petite, comptant pour un huitième à peine dans la stature totale.
Lespieds de l'Apoxyomène ont beau poser au sol à plat, une vibration annonciatrice, sinon un mouvement, déjà se dessine.
L'athlète a l'airde vouloir changer son équilibre, tandis que le bras tendu, jeté en avant pour la manoeuvre du strigile qui va libérer le corps et lesmembres de la poussière huileuse et de la sueur, sort brusquement, dirait-on, à l'avant, du plan de la statue.
Il est impossible deconcevoir une forme plus animée dans tous les sens de l'espace : selon les trois dimensions.
Peu à peu, la vie a vaincu la matière.
Detous les points où le spectateur des statues de Lysippe peut se placer, il saisit un mouvement qui se prépare ou se déplace, des raccourcisqui fuient devant ses yeux et l'obligent à penser au libre jeu d'un être magiquement vivant sous l'air libre.
Suprême réussite, mais propre,dirait-on, à décourager tout l'avenir.
En fait, la sculpture hellénistique a pu trouver d'autres nouvelles poses ; elle a, du moins, longtempsgardé complaisamment les attitudes chères à Lysippe : le Poseidon penché sur la mer, de Corinthe, au pied surélevé, et qui, àl'improviste, semble scruter la muette profondeur des flots ; l'Hermès messager rattachant sa sandale pour bondir à l'appel de Zeus(Jason du Louvre, du British Museum : Landsdowne House).
Ce sont là d'autres combinaisons de lignes, non moins audacieuses : car lecorps semble se ramasser pour l'élan, tandis que les jambes se plient ou s'allongent, et que les bras agissent souvent en contraste ;torse et épaules plongent en avant, pour marquer le repos interrompu ; la tête, qui a tout animé, se détourne, les oreilles écoutantnerveusement l'ordre qui meut subitement tout le corps.
La statuaire praxitélienne avait été celle du repos nonchalant.
Lysippe — quoiqu'ilait fait lui-même des figures détendues, comme l'Hermès assis de Naples-Herculanum — se complaît surtout à l'action instantanée etréaliste.
L'Apoxyomène montre une chevelure en désordre, humide et comme poissée par la sueur de la palestre.
Qu'on est loin desathlètes tranquilles, à la parade ! Alexandre, ce conquérant insatisfait d'un monde qui sitôt lui échappe, laisse aussi deviner dans sacoiffure dérangée, le vent de la vaine bataille épique qui l'entraîne jusqu'au coeur de l'Asie.
On ne peut tout dire ici, en trop peu de mots.
Mais, à propos d'Alexandre encore, et de son portrait "officiel", à propos de ce chef-d'oeuvreque fut, semble-t-il, l'Alexandre à la lance créé à Ephèse — et n'oublions pas que jusqu'à Rhodes, Tyr et en Égypte, Lysippe drainaitpartout en quelque sorte les aspects des dieux locaux pour les associer à la fortune d'Alexandre ! — le Sicyonien, indépendant et têtu, n'ajamais consenti à magnifier son royal modèle autrement qu'avec les moyens les plus terrestres.
Il a évité ainsi le portrait d'apothéose, etil a retardé les aspects figés, frontaux et solennels des effigies impériales byzantines, qu'on n'aurait pu craindre de voir apparaître déjà àRome.
C'est un service essentiel rendu à la psychologie et à la liberté du portrait princier.
Lysippe n'a pas fait abdiquer son art mêmedevant l'impérieux prestige d'une jeune gloire vite moissonnée : mais quel parti, pourtant — on le vit bien à Rome où tant d'empereursparodiaient les traits d'Alexandre ! — il avait su tirer de cette face osseuse, inquiète, de cette chevelure léonine, qui doublait la hauteurmajestueuse du front, de ce regard embué livrant tout le secret d'une âme passionnée.
Les autres portraits de Lysippe — à juger parl'Aristote de Vienne ou l'Euripide — ne montrent pas moins de profondeur, mais diverse ; c'est une erreur devenue en somme grâce àLysippe excusable, que d'avoir voulu rapporter au temps même d'Alexandre la mise en oeuvre humaine, la "véracité" impitoyable duportrait grec..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓