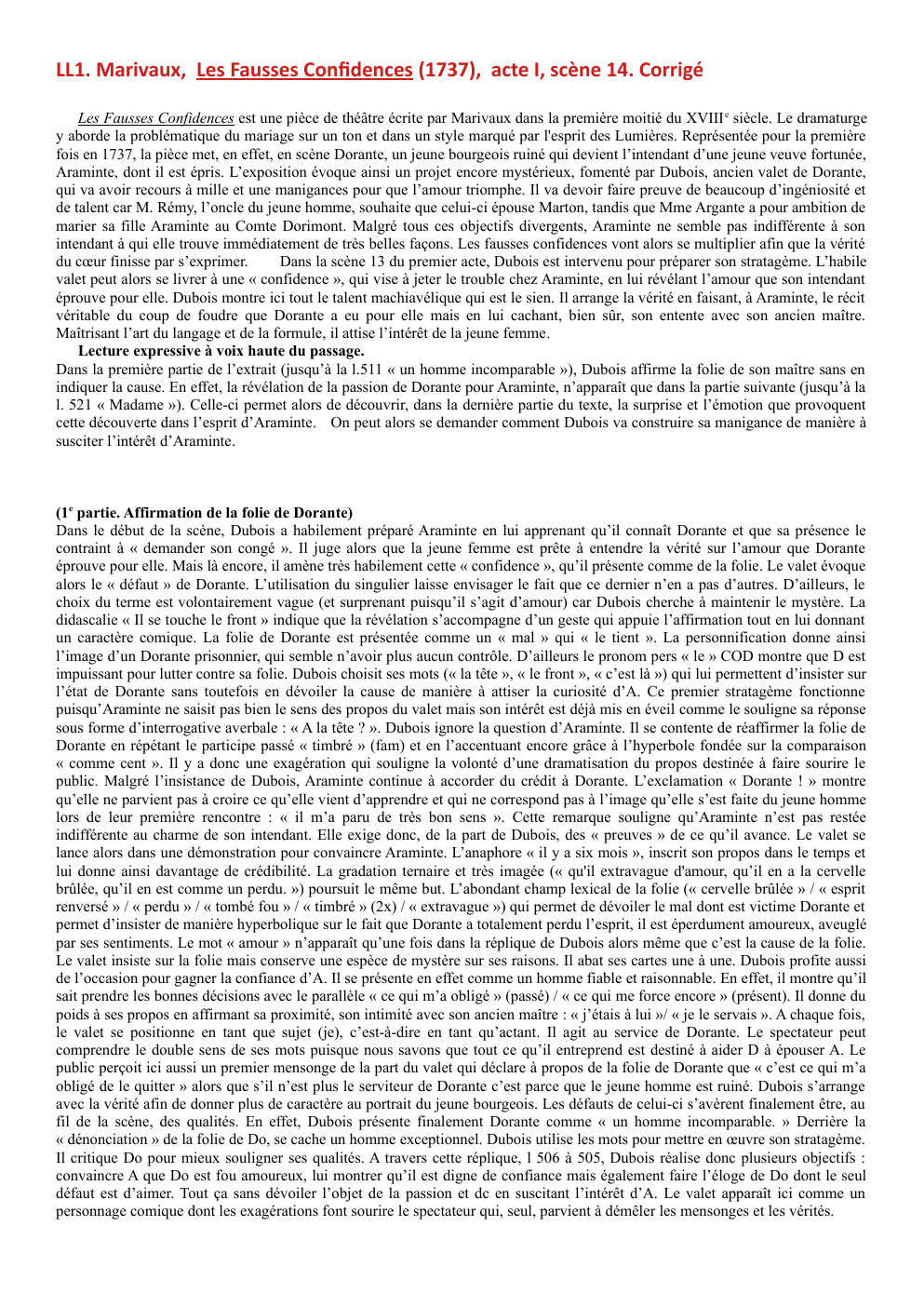LL1. Marivaux, Les Fausses Confidences (1737), acte I, scène 14. Corrigé
Publié le 22/04/2025
Extrait du document
«
LL1.
Marivaux, Les Fausses Confidences (1737), acte I, scène 14.
Corrigé
Les Fausses Confidences est une pièce de théâtre écrite par Marivaux dans la première moitié du XVIII e siècle.
Le dramaturge
y aborde la problématique du mariage sur un ton et dans un style marqué par l'esprit des Lumières.
Représentée pour la première
fois en 1737, la pièce met, en effet, en scène Dorante, un jeune bourgeois ruiné qui devient l’intendant d’une jeune veuve fortunée,
Araminte, dont il est épris.
L’exposition évoque ainsi un projet encore mystérieux, fomenté par Dubois, ancien valet de Dorante,
qui va avoir recours à mille et une manigances pour que l’amour triomphe.
Il va devoir faire preuve de beaucoup d’ingéniosité et
de talent car M.
Rémy, l’oncle du jeune homme, souhaite que celui-ci épouse Marton, tandis que Mme Argante a pour ambition de
marier sa fille Araminte au Comte Dorimont.
Malgré tous ces objectifs divergents, Araminte ne semble pas indifférente à son
intendant à qui elle trouve immédiatement de très belles façons.
Les fausses confidences vont alors se multiplier afin que la vérité
du cœur finisse par s’exprimer.
Dans la scène 13 du premier acte, Dubois est intervenu pour préparer son stratagème.
L’habile
valet peut alors se livrer à une « confidence », qui vise à jeter le trouble chez Araminte, en lui révélant l’amour que son intendant
éprouve pour elle.
Dubois montre ici tout le talent machiavélique qui est le sien.
Il arrange la vérité en faisant, à Araminte, le récit
véritable du coup de foudre que Dorante a eu pour elle mais en lui cachant, bien sûr, son entente avec son ancien maître.
Maîtrisant l’art du langage et de la formule, il attise l’intérêt de la jeune femme.
Lecture expressive à voix haute du passage.
Dans la première partie de l’extrait (jusqu’à la l.511 « un homme incomparable »), Dubois affirme la folie de son maître sans en
indiquer la cause.
En effet, la révélation de la passion de Dorante pour Araminte, n’apparaît que dans la partie suivante (jusqu’à la
l.
521 « Madame »).
Celle-ci permet alors de découvrir, dans la dernière partie du texte, la surprise et l’émotion que provoquent
cette découverte dans l’esprit d’Araminte.
On peut alors se demander comment Dubois va construire sa manigance de manière à
susciter l’intérêt d’Araminte.
(1e partie.
Affirmation de la folie de Dorante)
Dans le début de la scène, Dubois a habilement préparé Araminte en lui apprenant qu’il connaît Dorante et que sa présence le
contraint à « demander son congé ».
Il juge alors que la jeune femme est prête à entendre la vérité sur l’amour que Dorante
éprouve pour elle.
Mais là encore, il amène très habilement cette « confidence », qu’il présente comme de la folie.
Le valet évoque
alors le « défaut » de Dorante.
L’utilisation du singulier laisse envisager le fait que ce dernier n’en a pas d’autres.
D’ailleurs, le
choix du terme est volontairement vague (et surprenant puisqu’il s’agit d’amour) car Dubois cherche à maintenir le mystère.
La
didascalie « Il se touche le front » indique que la révélation s’accompagne d’un geste qui appuie l’affirmation tout en lui donnant
un caractère comique.
La folie de Dorante est présentée comme un « mal » qui « le tient ».
La personnification donne ainsi
l’image d’un Dorante prisonnier, qui semble n’avoir plus aucun contrôle.
D’ailleurs le pronom pers « le » COD montre que D est
impuissant pour lutter contre sa folie.
Dubois choisit ses mots (« la tête », « le front », « c’est là ») qui lui permettent d’insister sur
l’état de Dorante sans toutefois en dévoiler la cause de manière à attiser la curiosité d’A.
Ce premier stratagème fonctionne
puisqu’Araminte ne saisit pas bien le sens des propos du valet mais son intérêt est déjà mis en éveil comme le souligne sa réponse
sous forme d’interrogative averbale : « A la tête ? ».
Dubois ignore la question d’Araminte.
Il se contente de réaffirmer la folie de
Dorante en répétant le participe passé « timbré » (fam) et en l’accentuant encore grâce à l’hyperbole fondée sur la comparaison
« comme cent ».
Il y a donc une exagération qui souligne la volonté d’une dramatisation du propos destinée à faire sourire le
public.
Malgré l’insistance de Dubois, Araminte continue à accorder du crédit à Dorante.
L’exclamation « Dorante ! » montre
qu’elle ne parvient pas à croire ce qu’elle vient d’apprendre et qui ne correspond pas à l’image qu’elle s’est faite du jeune homme
lors de leur première rencontre : « il m’a paru de très bon sens ».
Cette remarque souligne qu’Araminte n’est pas restée
indifférente au charme de son intendant.
Elle exige donc, de la part de Dubois, des « preuves » de ce qu’il avance.
Le valet se
lance alors dans une démonstration pour convaincre Araminte.
L’anaphore « il y a six mois », inscrit son propos dans le temps et
lui donne ainsi davantage de crédibilité.
La gradation ternaire et très imagée (« qu'il extravague d'amour, qu’il en a la cervelle
brûlée, qu’il en est comme un perdu.
») poursuit le même but.
L’abondant champ lexical de la folie (« cervelle brûlée » / « esprit
renversé » / « perdu » / « tombé fou » / « timbré » (2x) / « extravague ») qui permet de dévoiler le mal dont est victime Dorante et
permet d’insister de manière hyperbolique sur le fait que Dorante a totalement perdu l’esprit, il est éperdument amoureux, aveuglé
par ses sentiments.
Le mot « amour » n’apparaît qu’une fois dans la réplique de Dubois alors même que c’est la cause de la folie.
Le valet insiste sur la folie mais conserve une espèce de mystère sur ses raisons.
Il abat ses cartes une à une.
Dubois profite aussi
de l’occasion pour gagner la confiance d’A.
Il se présente en effet comme un homme fiable et raisonnable.
En effet, il montre qu’il
sait prendre les bonnes décisions avec le parallèle « ce qui m’a obligé » (passé) / « ce qui me force encore » (présent).
Il donne du
poids à ses propos en affirmant sa proximité, son intimité avec son ancien maître : « j’étais à lui »/ « je le servais ».
A chaque fois,
le valet se positionne en tant que sujet (je), c’est-à-dire en tant qu’actant.
Il agit au service de Dorante.
Le spectateur peut
comprendre le double sens de ses mots puisque nous savons que tout ce qu’il entreprend est destiné à aider D à épouser A.
Le
public perçoit ici aussi un premier mensonge de la part du valet qui déclare à propos de la folie de Dorante que « c’est ce qui m’a
obligé de le quitter » alors que s’il n’est plus le serviteur de Dorante c’est parce que le jeune homme est ruiné.
Dubois s’arrange
avec la vérité afin de donner plus de caractère au portrait du jeune bourgeois.
Les défauts de celui-ci s’avèrent finalement être, au
fil de la scène, des qualités.
En effet, Dubois présente finalement Dorante comme « un homme incomparable.
» Derrière la
« dénonciation » de la folie de Do, se cache un homme exceptionnel.
Dubois utilise les mots pour mettre en œuvre son stratagème.
Il critique Do pour mieux souligner ses qualités.
A travers cette réplique, l 506 à 505, Dubois réalise donc plusieurs objectifs....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture linéaire n° 1 Les Fausses confidences, Marivaux (1737). Acte I scène 14 (extrait)
- Étude linéaire n°2 – Les Fausses Confidences, Marivaux, 1737 – Acte II, scène 13 : le stratagème d’Araminte
- Acte I scène 14, Les Fausses Confidences (1737)
- fiche analyse linéaire les fausses confidences Marivaux - scène 2 de l'acte I
- Etude linéaire Marivaux, Les fausses confidences - – Acte I, scène 2