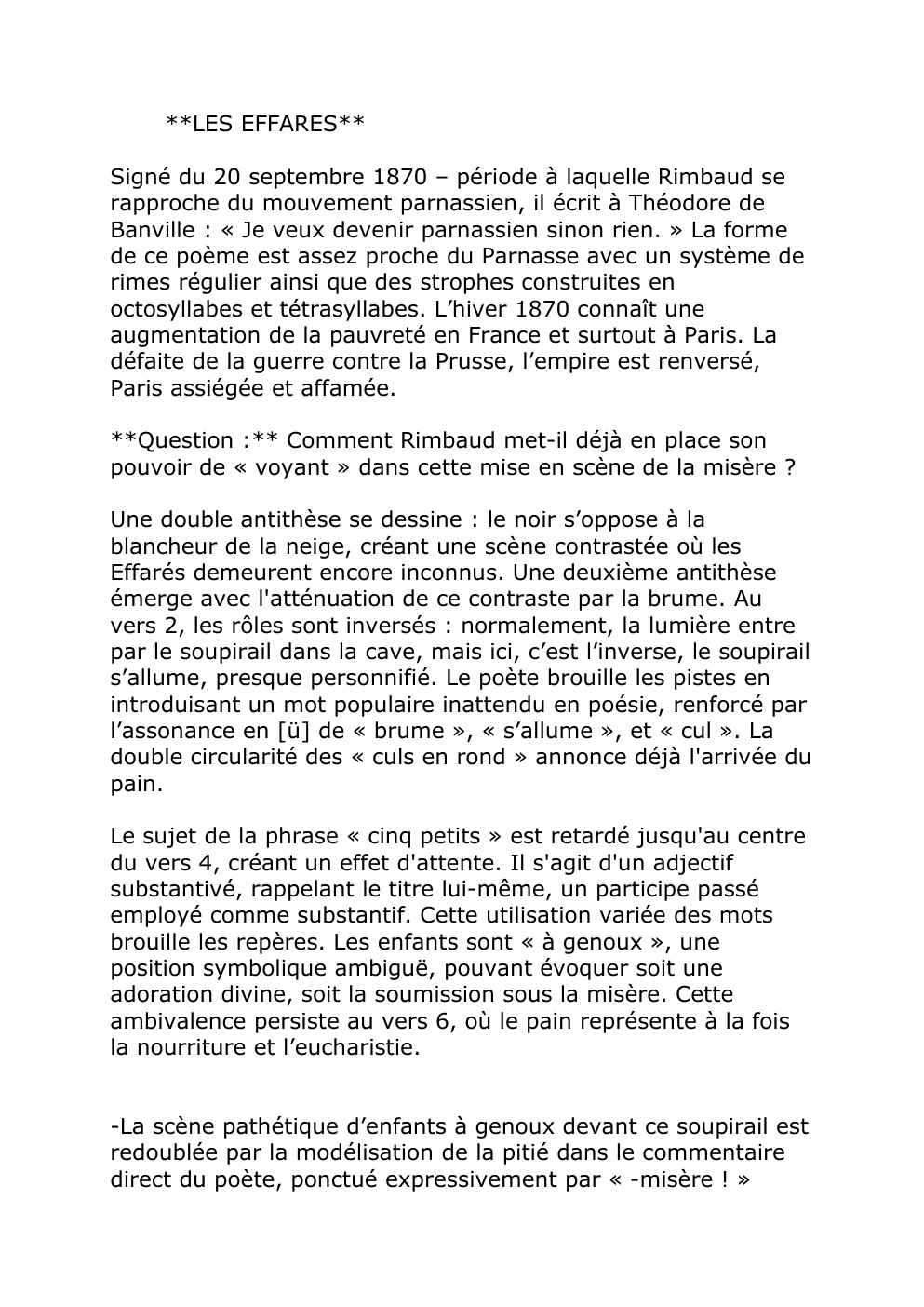les éffarés etude linéaire
Publié le 13/02/2024
Extrait du document
«
**LES EFFARES**
Signé du 20 septembre 1870 – période à laquelle Rimbaud se
rapproche du mouvement parnassien, il écrit à Théodore de
Banville : « Je veux devenir parnassien sinon rien.
» La forme
de ce poème est assez proche du Parnasse avec un système de
rimes régulier ainsi que des strophes construites en
octosyllabes et tétrasyllabes.
L’hiver 1870 connaît une
augmentation de la pauvreté en France et surtout à Paris.
La
défaite de la guerre contre la Prusse, l’empire est renversé,
Paris assiégée et affamée.
**Question :** Comment Rimbaud met-il déjà en place son
pouvoir de « voyant » dans cette mise en scène de la misère ?
Une double antithèse se dessine : le noir s’oppose à la
blancheur de la neige, créant une scène contrastée où les
Effarés demeurent encore inconnus.
Une deuxième antithèse
émerge avec l'atténuation de ce contraste par la brume.
Au
vers 2, les rôles sont inversés : normalement, la lumière entre
par le soupirail dans la cave, mais ici, c’est l’inverse, le soupirail
s’allume, presque personnifié.
Le poète brouille les pistes en
introduisant un mot populaire inattendu en poésie, renforcé par
l’assonance en [ü] de « brume », « s’allume », et « cul ».
La
double circularité des « culs en rond » annonce déjà l'arrivée du
pain.
Le sujet de la phrase « cinq petits » est retardé jusqu'au centre
du vers 4, créant un effet d'attente.
Il s'agit d'un adjectif
substantivé, rappelant le titre lui-même, un participe passé
employé comme substantif.
Cette utilisation variée des mots
brouille les repères.
Les enfants sont « à genoux », une
position symbolique ambiguë, pouvant évoquer soit une
adoration divine, soit la soumission sous la misère.
Cette
ambivalence persiste au vers 6, où le pain représente à la fois
la nourriture et l’eucharistie.
-La scène pathétique d’enfants à genoux devant ce soupirail est
redoublée par la modélisation de la pitié dans le commentaire
direct du poète, ponctué expressivement par « -misère ! »
Les trois strophes s’ouvrent sur les différents organes des sens
dans une construction anaphorique (« ils » + verbe relatif à un
sens).
Les enfants voient au vers 7, ils écoutent au vers 10, ils
sont blottis et donc se touchent au vers 13, enfin un « souffle »
sort du soupirail touchant ainsi l’odorat au vers 14.
Seul le goût
est absent, nous donnant déjà un indice sur la fin du poème.
Le « fort bras blanc » du vers 7 fait écho au « lourd pain blond
» du vers précédent, créant un rythme ternaire et suggérant
une impression d’abondance.
La description du bras du
boulanger, à la fois fort et gros, s’oppose à la fragilité des «
cinq petits » de la strophe précédente.
Un champ lexical de couleur est développé tout au long du
poème : « le noir » et « le blanc » se retrouvent dans le gris de
la pâte prête à cuire qui se transformera grâce à l’alchimie du
boulanger en un pain « jaune », tel la boue se transformant en
or.
Le rythme du tercet, construit sur le même modèle grammatical
(deux propositions subordonnées relatives coordonnées), ainsi
que les deux enjambements, matérialisent le mouvement du
boulanger.
L’expression oxymorique « le trou clair », bien que le trou
évoque habituellement quelque chose de sombre, rappelle le
soupirail qui s’allume, même si, cette fois, il est plus attendu
que le four soit une source de lumière.
- La synesthésie dans le rapprochement de l’ouïe avec « ils
écoutent » et du goût avec « le bon pain » désoriente le
lecteur.
Rimbaud mélange ainsi les sens, ajoutant à la
confusion.
- Au vers 11, Rimbaud utilise l'hypallage pour mettre en avant
le sourire du boulanger, à la fois bien portant et étrangement
gai, accentuant ainsi la disparité entre lui et les enfants.
- Le boulanger « chante un vieil air » tel un aède, le poète
antique ; il transforme le pain gris en pain jaune, semblable au
poète alchimiste transformant la boue en or.
Rimbaud poursuit
ainsi la métaphore du boulanger/poète, mais avec une distance
critique, car le sourire est décrit comme « gras ».
Cela évoque
une certaine critique envers le poète moderne que Rimbaud
aspire à devenir.
La métaphore filée entre le soupirail et une mère dans ce tercet
amplifie la tonalité pathétique, superposant les images dans
l’esprit du lecteur.
Les enfants, « blottis » au vers 13, semblent
trouver refuge et protection.
Le soupirail est personnifié,
possédant un « souffle » au vers 14, et sa chaleur est
comparée à celle d’un sein au vers 15.
Les enfants s’enivrent
de ce qui leur manque : nourriture et chaleur d’un foyer, dans
les deux sens de l’expression.
Ce dernier mouvement est une longue phrase s'étendant sur les
7 tercets.
Trois propositions subordonnées circonstancielles de
temps retardent l’apparition de la proposition principale « ils se
ressentent si bien vivre ».
L’anaphore de la conjonction de
subordination « quand » contribue également à retarder la
chute, créant un horizon d’attente : les enfants vont-ils pouvoir
manger du pain ? Cette construction montre « les cinq petits »
comme hypnotisés par le spectacle de la fabrication du pain.
- À nouveau, le poète nous désoriente en associant la
conjonction de subordination temporelle « quand » à un groupe
prépositionnel complément circonstanciel de lieu « sous les
poutres enfumées ».
- Tout un système de relation sensorielle se met en place tout
au long du poème, associant les couleurs, les sensations de
chaud ou de froid, les bruits...
Aux vers 20 et 21, les « croutes
», rappelant la sensation de la main sur du pain, sont
personnifiées et reliées à l’ouïe (elles chantent) ainsi qu’à
l’odorat (elles sont parfumées).
Rimbaud utilise le substantif «
grillons », renvoyant au chant du vers précédent et au jour qui
se lève, mais surtout à la croûte du pain, suggérant un
néologisme désignant des petits bouts de pains grillés.
- Le trou est personnifié, tout comme l’était le soupirail dans la
5ème strophe.
Dans cette strophe, commence à poindre une
critique de la religion.
Le trou chaud rappelle les enfers alors
que le souffle de vie vient de Dieu.
Les images sont mêlées,
créant un sentiment de confusion sur les notions de bien et de
mal.
Le champ lexical de la religiosité heureuse (souffle de vie,
âme, ravie) est sérieusement remis en question par les «....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- etude linéaire préambule et arcticle 1-4 DDFC
- Etude linéaire princesse de Clèves: « Sitôt que la nuit fut venue »
- Etude linéaire Annie Ernaux « La femme gelée »
- Etude linéaire Marivaux, Les fausses confidences - – Acte I, scène 2
- Etude linéaire Albatros de Baudelaire