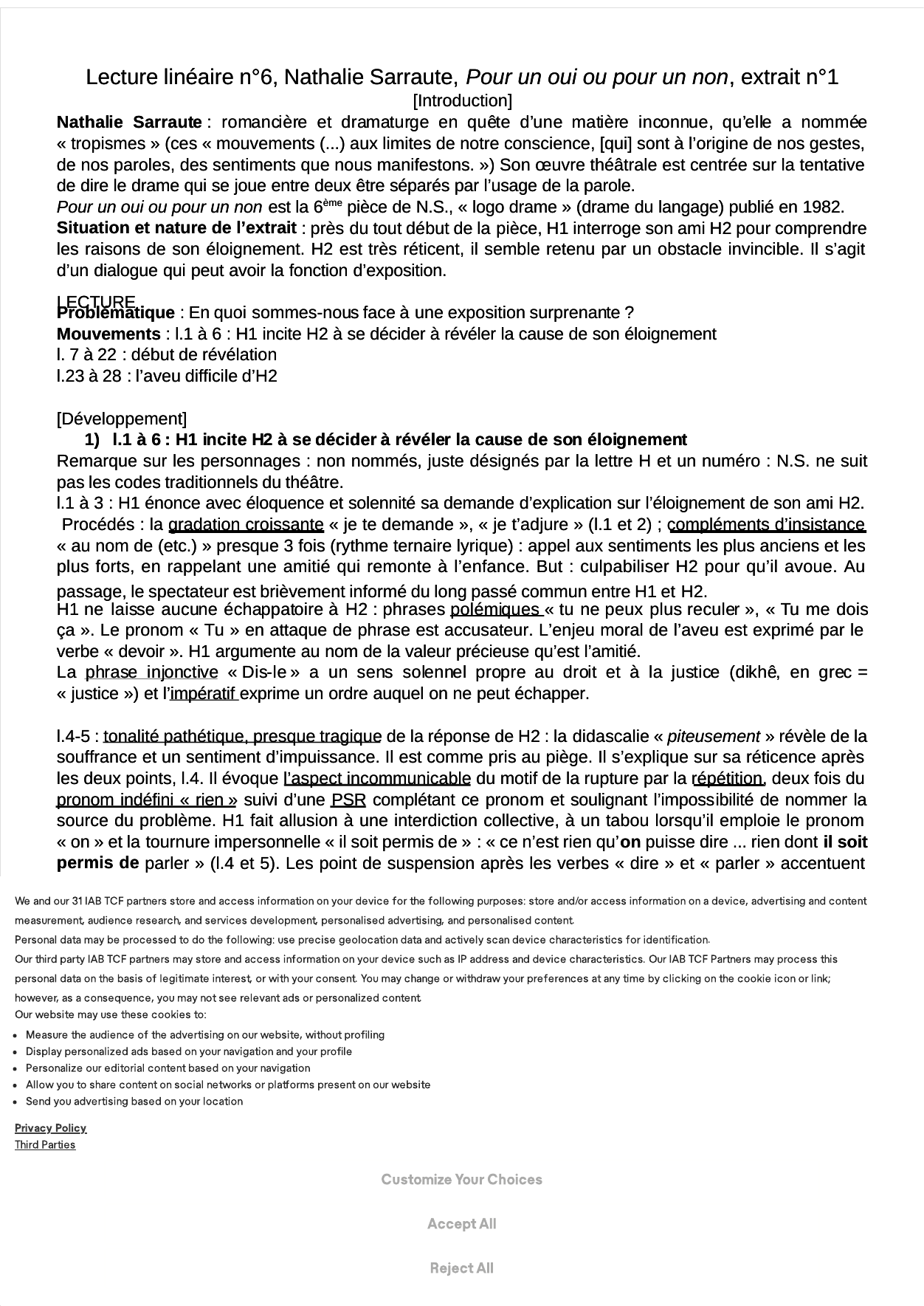Lecture linéaire n°6, Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non, extrait n°1
Publié le 10/10/2025
Extrait du document
«
Lecture linéaire n°6, Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non, extrait n°1
[Introduction]
Nathalie
Nathal
ie Sarraut
Sarraute
e : romanc
romancièr
ière
e et drama
dramatur
turge
ge en quê
quête
te d’
d’une
une matièr
matière
e inconn
inconnue,
ue, qu’ell
qu’elle
e a no
nommé
mmée
e
« tropismes » (ces « mouvements (...) aux limites de notre conscience, [qui] sont à l’origine de nos gestes,
de nos paroles, des sentiments que nous manifestons.
») Son œuvre théâtrale est centrée sur la tentative
de dire le drame qui se joue entre deux être séparés par l’usage de la parole.
Pour un oui ou pour un non est la 6ème pièce de N.S., « logo drame » (drame du langage) publié en 1982.
Situation et nature de l’extrait : près du tout début de la pièce, H1 interroge son ami H2 pour comprendre
les raisons de son éloignement.
H2 est très réticent, il semble retenu par un obstacle invincible.
Il s’agit
d’un dialogue qui peut avoir la fonction d’exposition.
LECTURE
Problématique : En quoi sommes-nous
sommes-nous face à une exposition surprenan
surprenante
te ?
Mouvements : l.1 à 6 : H1 incite H2 à se décider à révéler la cause de son éloignement
l.
7 à 22 : début de révélation
l.23 à 28 : l’aveu difficile d’H2
[Développement]
1) l.1 à 6 : H1 iincite
ncite H
H2
2 à se décider à révéle
révélerr la cau
cause
se de so
son
n éloi
éloignemen
gnementt
Remarque sur les personnages : non nommés, juste désignés par la lettre H et un numéro : N.S.
ne suit
pas les codes traditionnels du théâtre.
l.1 à 3 : H1 énonce avec éloquence et solennité sa demande d’explication sur l’éloignement de son ami H2.
Procédés : la gradation croissante « je te demande », « je t’adjure » (l.1 et 2) ; compléments d’insistance
« au nom de (etc.) » presque 3 fois (rythme ternaire lyrique) : appel aux sentiments les plus anciens et les
plus forts, en rappelant une amitié qui remonte à l’enfance.
But : culpabiliser H2 pour qu’il avoue.
Au
passage, le spectateur est brièvement informé du long passé commun entre H1 et H2.
H1 ne laisse
laisse aucune
aucune échappat
échappatoire
oire à H2 : phrases polémiques
polémiques « tu ne peux plus reculer
reculer », « T
Tu
u me dois
ça ».
Le pronom « Tu » en attaque de phrase est accusateur.
L’enjeu moral de l’aveu est exprimé par le
verbe « devoir ».
H1 argumente au nom de la valeur précieuse qu’est l’amitié.
La ph
phras
rase
e injon
injoncti
ctive
ve « Dis-le
Dis-le » a un sens
sens sol
solenn
ennel
el pro
propre
pre au dro
droit
it et à la jus
justic
tice
e (dikhê
(dikhê,, en gre
grec
c=
« justice ») et l’impératif exprime un ordre auquel on ne peut échapper.
l.4-5 : tonalité pathétique, presque tragique de la réponse de H2 : la didascalie « piteusement » révèle de la
souffrance et un sentiment d’impuissance.
Il est comme pris au piège.
Il s’explique sur sa réticence après
les deux points, l.4.
Il évoque l’aspect incommunicable du motif de la rupture par la répétition, deux fois du
pronom indéfini « rien » suivi d’une PSR complétant ce prono
pronom
m et soulignant l’imposs
l’impossibilité
ibilité de nommer la
source du problème.
H1 fait allusion à une interdiction collective, à un tabou lorsqu’il emploie le pronom
« on » et la tournure imperson
impersonnelle
nelle « il soit permis de » : « ce n’est rien qu’ on puisse dire ...
rien dont il soit
permis de parler » (l.4 et 5).
Les point de suspension après les verbes « dire » et « parler » accentuent
l’expression de gêne de H1.
nd our 31 IAB TCF partne rs store and acce ss inf ormation on your de vice f or the f ollowing purpose s: store and/or acce ss inf ormation on a de vice, adve rtising and c onte nt
We a
measure me nt, audie nce re search, and se rvice s de ve lopme nt, pe rsonalised adve rtising, and pe rsonalised c onte nt.
l.6 : H1 cherche à encourager H2 avec l’interjection « Allons » et l’impératif « vas-y »
Pe
rsonal data may be proce ssed to do the f ollowing: use precise ge olocation data and ac tive ly scan de vice charac te ristic s f or ide nti
t on.
ca i
ur third party IAB TCF partne rs may store and acce ss inf ormation on your de vice such as IP addre ss and de vice charac te ristic s.
Our IAB TCF Partne rs may proce ss this
O
2) l.
7 à 2
22
2 : dé
débu
butt de rrévé
évélat
latio
ion
n
H1 ne cesse de relancer, d’encourager H2
ow v rLe
s travail
ons qu d’accouchement
n
you m y not s r l sera
v nt slent
or p et
rsonpénible.
lz
ont nt
son motif de rupture.
ur w squi
t m peine
y us t à
s verbaliser
ook s to
bien
points
surL t7 : ul’interjection
n o t
v «
rt seh
n on
our w » set
t les
w t out
pro l n de suspension trahissent l’hésitation face à la tâche exigée.
La
spl yréponse
p rson l z « c’est
s s juste
on yourdes
n v mots
t on n »
your
proimprécise
l
est
mais l’emploi du substantif « mots » révèle que l’enjeu de la
rson l z our
tor l ont nt s on your n v t on
pièce tournera autour de la puissance insoupçonnée des mots, de leurs conséquences imprévisibles.
llow you to s r ont nt on so l n tworks or pl t orms pr s nt on our w s t
L’adverbe
» losemble
atténuer l’importance de cet aveu, mais le spectateur ne s’y trompe pas.
n you
v rt s n «s juste
on your
t on
l.8 : Quiproquo comique de H1 : il a cru entendre l’expression « avoir des mots » (se fâcher) : « ne me dis
r
rtpas
s qu’on a eu des mots...
» et il refuse de croire qu’ils se sont fâchés, dans cette phrase.
Il montre aussi
pe rsonal data on the basis of legitimate inte re st, or with your c onse nt.
You may change or withdraw your prefe re nce s at any time by c lic king on the c ookie ic on or link;
h
e
O
e , a
eb
Mea
Di
e
a
Pe
a c
i e
a i
e
e
he a
e
die
a i
e
A
Se
e
a
ce
edi
ad
e
i
i
a
e c
f
ed ad
ia
ha e c
d
ce,
he
he ad
ba
c
e
g ba
ie
ed
e
i
i
e e
a
iga i
g
ed
e
ee
a
ad
e
a i
ed c
e
.
:
ba
ed
cia
e
eb
a
a
i e,
i h
i
d
g
e
iga i
a f
e
e
eb
i e
ca i
Priv ac y Polic y
Thi d Pa
ie
son incrédulité dans les deux phrases interrogatives
« Des omots
? Entre nous ? » et dans les propositions
ustom z
s pas trace de dispute dans sa mémoire : il
« ce n’est pas possible ...
je m’en serais souvenu
».
Ilour
ne trouve
pense sans doute à une dispute traditionnelle, facile à identifier comme telle.
l.10 à 13 : Suivent
Suivent des rema
remarque
rques
s métal
métalingu
inguisti
istiques
quesptdell H1 pour explicite
expliciterr ce qu’il
qu’il ente
entend
nd par le terme
« mots », avec beaucoup de tâtonnements révélés par les points de suspension, à 4 reprises.
A défaut de
C
i
e Y
Acce
Ch
A
Reject All
ice
les définir clairement, il écarte par des négations l’acception que H1 donne au terme « mots » : « Non, pas
des mots comme ça » (adverbes de négation), « pas ceux dont on dit (etc.) ».
Il énonce un
paradoxe : les mots qui ont créé la brouille ne sont pas
ceux qui d’
d’o
ordinaire la déc
déclenchent.
Il fait ré
réfé
férrence à une
caté
tég
gorie de mo
mot
ts ét
étrrangè
gèrre à la notion de dispute, com
omme
me
le
précise
l’adjectif
indéfini
« autres »
dans
« d’autres
mots » (l.
).
Le malaise vient de plus loin que les mots
eux-mêmes,
sans
doute
du
non-dit,
de
la
« sousconversation », notion chère à N.
S arraute.
H
se montre
conscient de pé
péné
nét
trer dans une zone trè
rès
s ma
mall connue, que
N
.
Sa
Sar
te voaupspelvle
«nt...
tropismes
»).
: « On ne sait pas
comme
ommen....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Pour un oui ou pour un non [Nathalie Sarraute] - Fiche de lecture.
- O.E.2: Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle / E.O.I. Juste la fin du monde (1990) de Jean-Luc LAGARCE ORAL LECTURE LINÉAIRE n°7, extrait de la Première partie, scène 8 – LA MÈRE
- lecture linéaire/analytique d’un extrait du Discours de la servitude volontaire d’Étienne de la Boétie
- « Ce qui m'intéresse quand je lis les vraies autobiographies, c'est de me dire « Ah bien c'est comme ça qu'il voulait qu'on le voie ». Cette réflexion de Nathalie Sarraute correspond elle à votre lecture des autobiographies.
- Vous analyserez ce texte de Nathalie Sarraute extrait du « Planétarium » en montrant l'originalité de sa conception romanesque, et vous direz quelle place il convient de lui assigner au sein du Nouveau Roman.