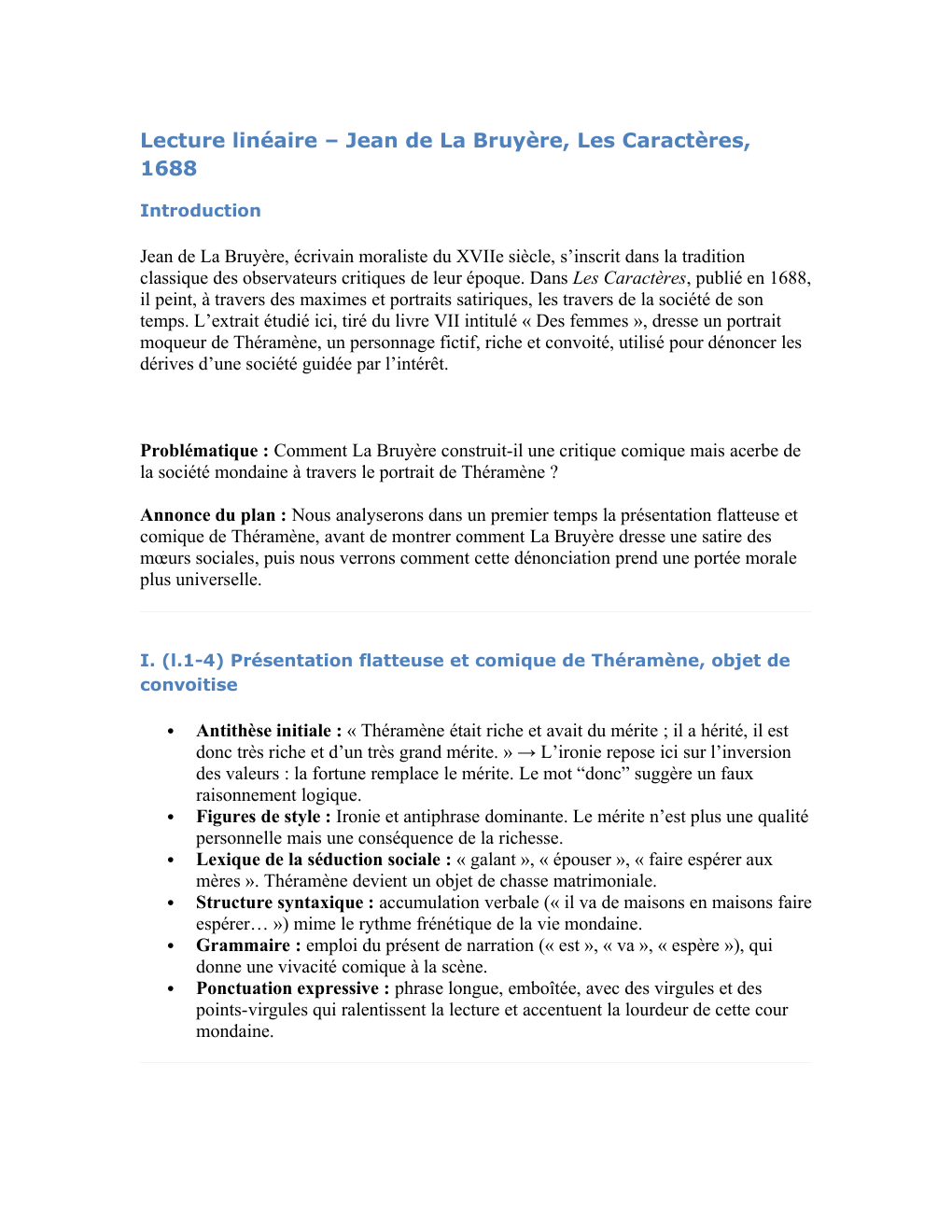Lecture linéaire – Jean de La Bruyère, Les Caractères, Théramène
Publié le 10/05/2025
Extrait du document
«
Lecture linéaire – Jean de La Bruyère, Les Caractères,
1688
Introduction
Jean de La Bruyère, écrivain moraliste du XVIIe siècle, s’inscrit dans la tradition
classique des observateurs critiques de leur époque.
Dans Les Caractères, publié en 1688,
il peint, à travers des maximes et portraits satiriques, les travers de la société de son
temps.
L’extrait étudié ici, tiré du livre VII intitulé « Des femmes », dresse un portrait
moqueur de Théramène, un personnage fictif, riche et convoité, utilisé pour dénoncer les
dérives d’une société guidée par l’intérêt.
Problématique : Comment La Bruyère construit-il une critique comique mais acerbe de
la société mondaine à travers le portrait de Théramène ?
Annonce du plan : Nous analyserons dans un premier temps la présentation flatteuse et
comique de Théramène, avant de montrer comment La Bruyère dresse une satire des
mœurs sociales, puis nous verrons comment cette dénonciation prend une portée morale
plus universelle.
I.
(l.1-4) Présentation flatteuse et comique de Théramène, objet de
convoitise
Antithèse initiale : « Théramène était riche et avait du mérite ; il a hérité, il est
donc très riche et d’un très grand mérite.
» → L’ironie repose ici sur l’inversion
des valeurs : la fortune remplace le mérite.
Le mot “donc” suggère un faux
raisonnement logique.
Figures de style : Ironie et antiphrase dominante.
Le mérite n’est plus une qualité
personnelle mais une conséquence de la richesse.
Lexique de la séduction sociale : « galant », « épouser », « faire espérer aux
mères ».
Théramène devient un objet de chasse matrimoniale.
Structure syntaxique : accumulation verbale (« il va de maisons en maisons faire
espérer… ») mime le rythme frénétique de la vie mondaine.
Grammaire : emploi du présent de narration (« est », « va », « espère »), qui
donne une vivacité comique à la scène.
Ponctuation expressive : phrase longue, emboîtée, avec des virgules et des
points-virgules qui ralentissent la lecture et accentuent la lourdeur de cette cour
mondaine.
II.
(l.5-13) Une satire de la société et des femmes en quête de mari
Champ lexical de la stratégie amoureuse : « elles se retirent », « liberté d’être
aimables », « faire ses déclarations ».
La cour devient un terrain de jeu calculé.
Tournures impersonnelles et généralisation : le portrait de Théramène devient
celui d’un type social.
Le texte ne parle plus d’un homme, mais....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- lecture linéaire ACIS - Jean de la Bruyère
- Analyse Linéaire : Jean de la Bruyère, Les caractères, « De la cour », 62, 1688.
- Lecture linéaire « Le Bal des voleurs » Jean Anouilh
- O.E.2: Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle / E.O.I. Juste la fin du monde (1990) de Jean-Luc LAGARCE ORAL LECTURE LINÉAIRE n°7, extrait de la Première partie, scène 8 – LA MÈRE
- Lecture linéaire: "De la Société de la Conversation" Les Caractères