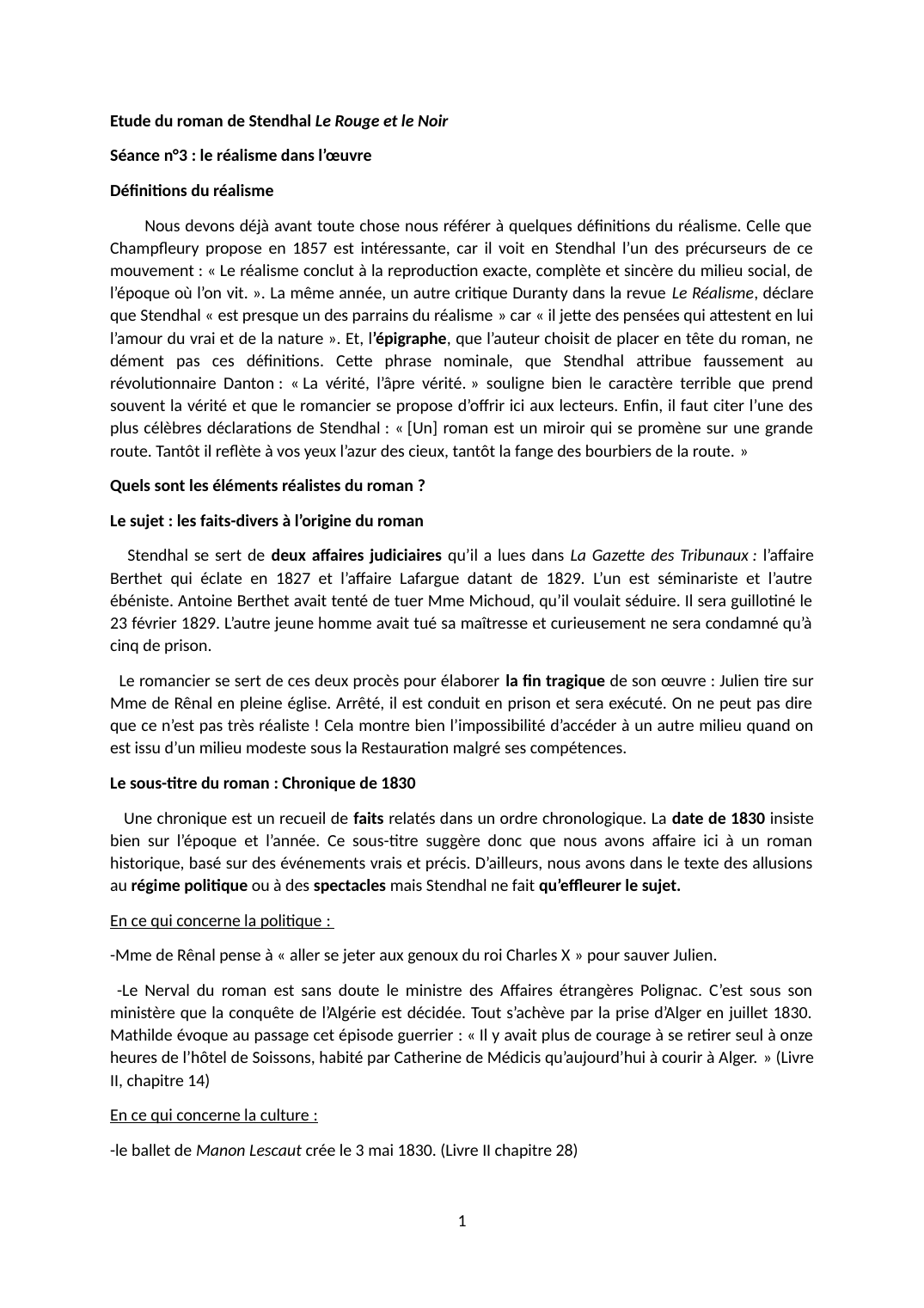Le réalisme du Rouge et le Noir de Stendhal
Publié le 07/03/2022

Extrait du document
«
Etude du roman de Stendhal Le Rouge et le Noir
Séance n°3 : le réalisme dans l’œuvre
Définitions du réalisme
Nous devons déjà avant toute chose nous référer à quelques définitions du réalisme.
Celle que
Champfleury propose en 1857 est intéressante, car il voit en Stendhal l’un des précurseurs de ce
mouvement : « Le réalisme conclut à la reproduction exacte, complète et sincère du milieu social, de
l’époque où l’on vit.
».
La même année, un autre critique Duranty dans la revue Le Réalisme , déclare
que Stendhal « est presque un des parrains du réalisme » car « il jette des pensées qui attestent en lui
l’amour du vrai et de la nature ».
Et, l ’épigraphe , que l’auteur choisit de placer en tête du roman, ne
dément pas ces définitions.
Cette phrase nominale, que Stendhal attribue faussement au
révolutionnaire Danton : « La vérité, l’âpre vérité.
» souligne bien le caractère terrible que prend
souvent la vérité et que le romancier se propose d’offrir ici aux lecteurs.
Enfin, il faut citer l’une des
plus célèbres déclarations de Stendhal : « [Un] roman est un miroir qui se promène sur une grande
route.
Tantôt il reflète à vos yeux l’azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route.
»
Quels sont les éléments réalistes du roman ?
Le sujet : les faits-divers à l’origine du roman
Stendhal se sert de deux affaires judiciaires qu’il a lues dans La Gazette des Tribunaux : l’affaire
Berthet qui éclate en 1827 et l’affaire Lafargue datant de 1829.
L’un est séminariste et l’autre
ébéniste.
Antoine Berthet avait tenté de tuer Mme Michoud, qu’il voulait séduire.
Il sera guillotiné le
23 février 1829.
L’autre jeune homme avait tué sa maîtresse et curieusement ne sera condamné qu’à
cinq de prison.
Le romancier se sert de ces deux procès pour élaborer la fin tragique de son œuvre : Julien tire sur
Mme de Rênal en pleine église.
Arrêté, il est conduit en prison et sera exécuté.
On ne peut pas dire
que ce n’est pas très réaliste ! Cela montre bien l’impossibilité d’accéder à un autre milieu quand on
est issu d’un milieu modeste sous la Restauration malgré ses compétences.
Le sous-titre du roman : Chronique de 1830
Une chronique est un recueil de faits relatés dans un ordre chronologique.
La date de 1830 insiste
bien sur l’époque et l’année.
Ce sous-titre suggère donc que nous avons affaire ici à un roman
historique, basé sur des événements vrais et précis.
D’ailleurs, nous avons dans le texte des allusions
au régime politique ou à des spectacles mais Stendhal ne fait qu’effleurer le sujet.
En ce qui concerne la politique :
-Mme de Rênal pense à « aller se jeter aux genoux du roi Charles X » pour sauver Julien.
-Le Nerval du roman est sans doute le ministre des Affaires étrangères Polignac.
C’est sous son
ministère que la conquête de l’Algérie est décidée.
Tout s’achève par la prise d’Alger en juillet 1830.
Mathilde évoque au passage cet épisode guerrier : « Il y avait plus de courage à se retirer seul à onze
heures de l’hôtel de Soissons, habité par Catherine de Médicis qu’aujourd’hui à courir à Alger.
» (Livre
II, chapitre 14)
En ce qui concerne la culture :
-le ballet de Manon Lescaut crée le 3 mai 1830.
(Livre II chapitre 28)
1.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Stendhal parle en ces mots de Julien Sorel dans Le rouge et le noir « L’œil de Julien suivait machinalement l’oiseau de proie. Ses mouvements tranquilles et puissants le frappaient, il enviait cette force, il enviait cet isolement. C’était la destinée de Napoléon, serait-ce un jour la sienne ? »
- Fiche révision EL n°9, Stendhal, Le Rouge et le Noir, I, chapitre 6
- Le rouge et le noir de Stendhal: Julien et Mme de Rénal
- Stendhal, Le Rouge et le Noir Texte 3 pour l’oral : p.506-507, l.149-168 : Livre II, fin du chapitre XXXV
- Le rouge et le noir Stendhal: Le personnage de Julien Sorel, esthétiques et valeurs