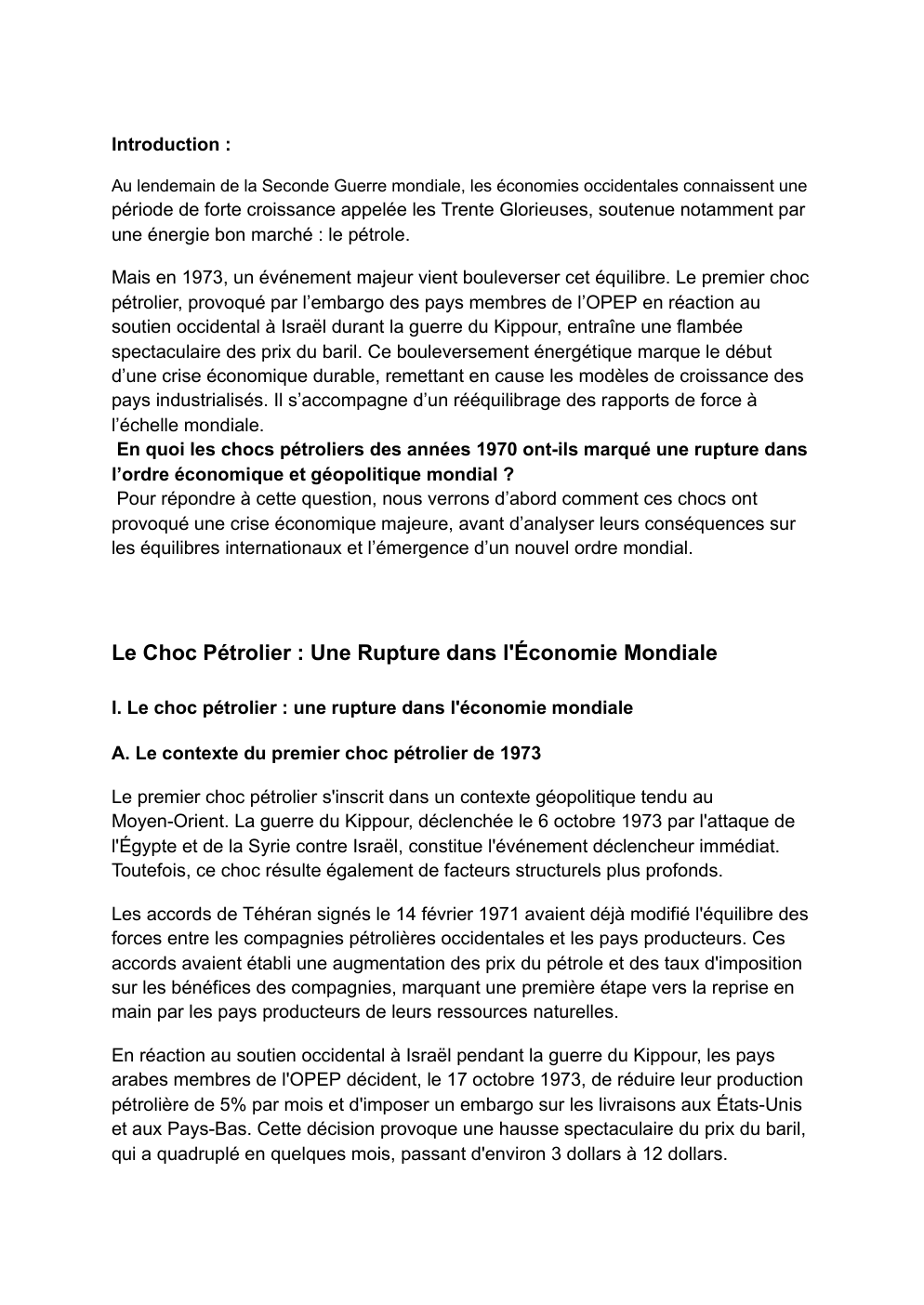Le choc pétrolier une rupture dans l'économie mondiale
Publié le 08/05/2025
Extrait du document
«
Introduction :
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les économies occidentales connaissent une
période de forte croissance appelée les Trente Glorieuses, soutenue notamment par
une énergie bon marché : le pétrole.
Mais en 1973, un événement majeur vient bouleverser cet équilibre.
Le premier choc
pétrolier, provoqué par l’embargo des pays membres de l’OPEP en réaction au
soutien occidental à Israël durant la guerre du Kippour, entraîne une flambée
spectaculaire des prix du baril.
Ce bouleversement énergétique marque le début
d’une crise économique durable, remettant en cause les modèles de croissance des
pays industrialisés.
Il s’accompagne d’un rééquilibrage des rapports de force à
l’échelle mondiale.
En quoi les chocs pétroliers des années 1970 ont-ils marqué une rupture dans
l’ordre économique et géopolitique mondial ?
Pour répondre à cette question, nous verrons d’abord comment ces chocs ont
provoqué une crise économique majeure, avant d’analyser leurs conséquences sur
les équilibres internationaux et l’émergence d’un nouvel ordre mondial.
Le Choc Pétrolier : Une Rupture dans l'Économie Mondiale
I.
Le choc pétrolier : une rupture dans l'économie mondiale
A.
Le contexte du premier choc pétrolier de 1973
Le premier choc pétrolier s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu au
Moyen-Orient.
La guerre du Kippour, déclenchée le 6 octobre 1973 par l'attaque de
l'Égypte et de la Syrie contre Israël, constitue l'événement déclencheur immédiat.
Toutefois, ce choc résulte également de facteurs structurels plus profonds.
Les accords de Téhéran signés le 14 février 1971 avaient déjà modifié l'équilibre des
forces entre les compagnies pétrolières occidentales et les pays producteurs.
Ces
accords avaient établi une augmentation des prix du pétrole et des taux d'imposition
sur les bénéfices des compagnies, marquant une première étape vers la reprise en
main par les pays producteurs de leurs ressources naturelles.
En réaction au soutien occidental à Israël pendant la guerre du Kippour, les pays
arabes membres de l'OPEP décident, le 17 octobre 1973, de réduire leur production
pétrolière de 5% par mois et d'imposer un embargo sur les livraisons aux États-Unis
et aux Pays-Bas.
Cette décision provoque une hausse spectaculaire du prix du baril,
qui a quadruplé en quelques mois, passant d'environ 3 dollars à 12 dollars.
B.
Des conséquences économiques majeures
Les répercussions du premier choc pétrolier sur l'économie mondiale sont
considérables et multiples.
Sur le plan macroéconomique, la hausse brutale des prix du pétrole engendre une
forte inflation dans les pays industrialisés.Cette situation inédite de "stagflation"
combine ralentissement économique et inflation élevée, remettant en question les
politiques économiques keynésiennes traditionnelles.
Les entreprises et les ménages subissent directement l'augmentation des coûts
énergétiques.
Les secteurs industriels fortement consommateurs d'énergie, comme
la sidérurgie ou la chimie, voient leur compétitivité se dégrader.
Les ménages,
confrontés à la hausse des prix des carburants et du chauffage, réduisent leur
consommation d'autres biens, accentuant le ralentissement économique.
C.
Un second choc en 1979 aggravant la situation
Alors que l'économie mondiale commençait à s'adapter aux conséquences du
premier choc pétrolier, un second choc survient en 1979, dans un contexte encore
plus tendu.
La révolution islamique en Iran, qui renverse le régime du Shah en janvier 1979,
perturbe considérablement la production pétrolière iranienne.
Cette situation est
aggravée par le déclenchement de la guerre Iran-Irak en septembre 1980, qui réduit
davantage l'offre mondiale de pétrole.
En conséquence, le prix du baril connaît une nouvelle envolée, passant d'environ 13
dollars en 1978 à plus de 35 dollars en 1981.
Cette seconde hausse intervient dans
une économie mondiale déjà fragilisée par le premier choc, amplifiant
considérablement ses effets négatifs..
Face à cette situation, les politiques économiques connaissent un tournant majeur.
Les gouvernements occidentaux, notamment sous l'impulsion des États-Unis et du
Royaume-Uni, abandonnent progressivement les politiques keynésiennes au profit
de politiques monétaristes visant prioritairement à réduire l'inflation, quitte à accepter
temporairement une hausse du chômage.
II.
La Restructuration des Économies Face aux Chocs
A.
Les politiques de rigueur et leurs conséquences sociales
Dans les principales économies industrialisées, les banques centrales ont significativement
relevé leurs taux d'intérêt directeurs.
La Réserve Fédérale américaine, sous la présidence
de Paul Volcker, a porté ses taux à près de 20% au début des années 1980.
Cette politique
monétaire restrictive cherchait à réduire la masse monétaire en circulation et à maîtriser
l'inflation, même au prix d'une récession temporaire.
Les conséquences sociales de ces politiques ont été considérables.
Le chômage a connu
une hausse sans précédent dans la plupart des pays industrialisés, dépassant 10% de la
population active dans plusieurs pays européens au début des années 1980.
Les jeunes et
les travailleurs peu qualifiés ont été particulièrement touchés par cette montée du chômage
structurel.
La précarisation de l'emploi s'est également intensifiée avec le développement des contrats
temporaires, du temps partiel subi et de l'intérim.
Ces évolutions ont contribué à un
accroissement des inégalités sociales et à l'émergence de nouvelles formes de pauvreté, y
compris parmi les travailleurs.
B.
La réorientation des....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DM d'Histoire Sujet : le choc pétrolier
- L'impact de la crise de 1929 sur l'économie mondiale
- Indonésie 1985-1986 Révolution verte et choc pétrolier
- Grèce (2000-2001): Les effets du ralentissement de l'économie mondiale
- TECHNOLOGIE DE L'ÉNERGIEL'énergie est la ressource la plus importante dans l'économie mondiale.