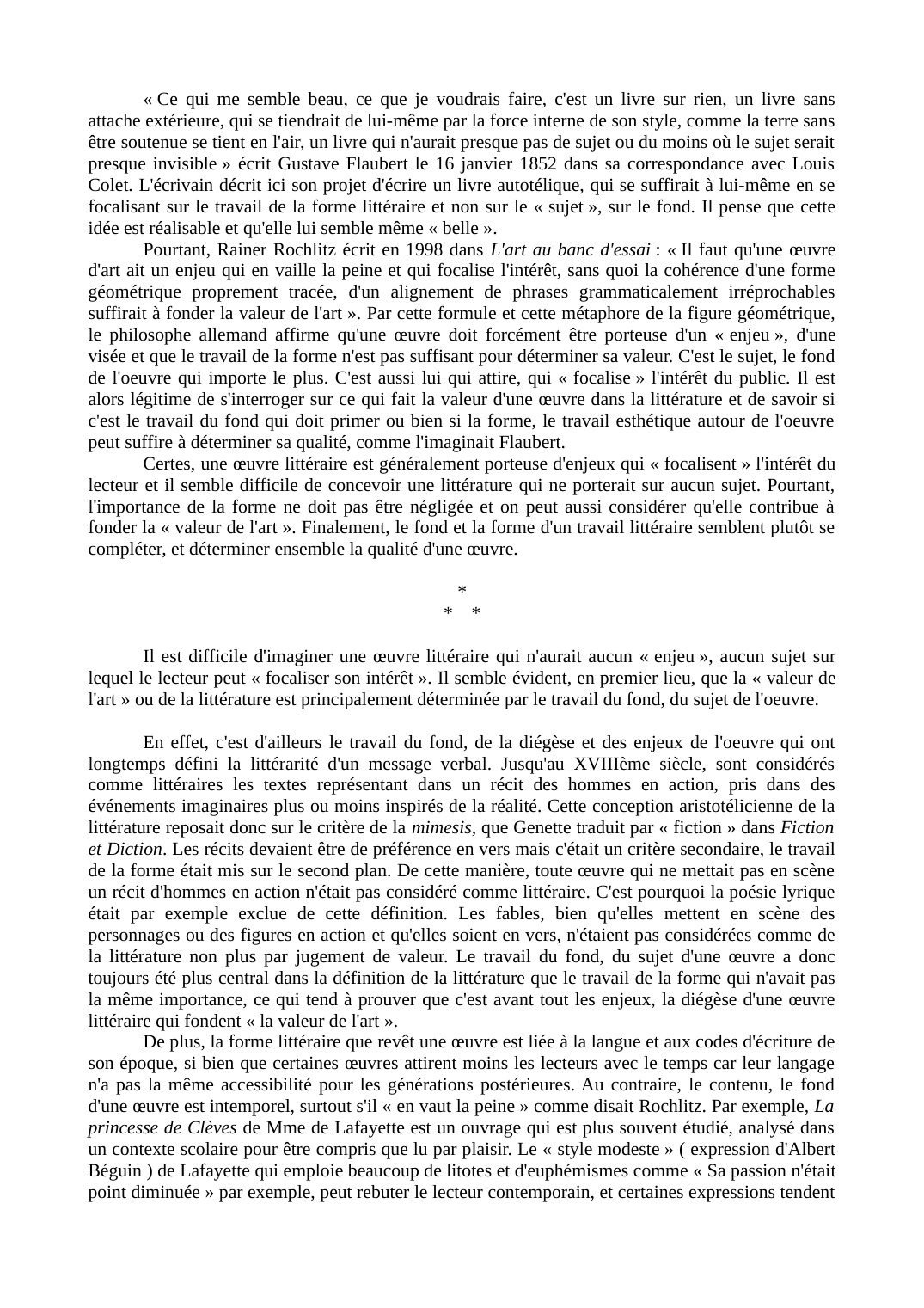La valeur de la littérature
Publié le 13/11/2021

Extrait du document
«
« Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans
attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans
être soutenue se tient en l'air, un livre qui n'aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait
presque invisible » écrit Gustave Flaubert le 16 janvier 1852 dans sa correspondance avec Louis
Colet.
L'écrivain décrit ici son projet d'écrire un livre autotélique, qui se suffirait à lui-même en se
focalisant sur le travail de la forme littéraire et non sur le « sujet », sur le fond.
Il pense que cette
idée est réalisable et qu'elle lui semble même « belle ».
Pourtant, Rainer Rochlitz écrit en 1998 dans L'art au banc d'essai : « Il faut qu'une œuvre
d'art ait un enjeu qui en vaille la peine et qui focalise l'intérêt, sans quoi la cohérence d'une forme
géométrique proprement tracée, d'un alignement de phrases grammaticalement irréprochables
suffirait à fonder la valeur de l'art ».
Par cette formule et cette métaphore de la figure géométrique,
le philosophe allemand affirme qu'une œuvre doit forcément être porteuse d'un « enjeu », d'une
visée et que le travail de la forme n'est pas suffisant pour déterminer sa valeur.
C'est le sujet, le fond
de l'oeuvre qui importe le plus.
C'est aussi lui qui attire, qui « focalise » l'intérêt du public.
Il est
alors légitime de s'interroger sur ce qui fait la valeur d'une œuvre dans la littérature et de savoir si
c'est le travail du fond qui doit primer ou bien si la forme, le travail esthétique autour de l'oeuvre
peut suffire à déterminer sa qualité, comme l'imaginait Flaubert.
Certes, une œuvre littéraire est généralement porteuse d'enjeux qui « focalisent » l'intérêt du
lecteur et il semble difficile de concevoir une littérature qui ne porterait sur aucun sujet.
Pourtant,
l'importance de la forme ne doit pas être négligée et on peut aussi considérer qu'elle contribue à
fonder la « valeur de l'art ».
Finalement, le fond et la forme d'un travail littéraire semblent plutôt se
compléter, et déterminer ensemble la qualité d'une œuvre.
*
* *
Il est difficile d'imaginer une œuvre littéraire qui n'aurait aucun « enjeu », aucun sujet sur
lequel le lecteur peut « focaliser son intérêt ».
Il semble évident, en premier lieu, que la « valeur de
l'art » ou de la littérature est principalement déterminée par le travail du fond, du sujet de l'oeuvre.
En effet, c'est d'ailleurs le travail du fond, de la diégèse et des enjeux de l'oeuvre qui ont
longtemps défini la littérarité d'un message verbal.
Jusqu'au XVIIIème siècle, sont considérés
comme littéraires les textes représentant dans un récit des hommes en action, pris dans des
événements imaginaires plus ou moins inspirés de la réalité.
Cette conception aristotélicienne de la
littérature reposait donc sur le critère de la mimesis , que Genette traduit par « fiction » dans Fiction
et Diction .
Les récits devaient être de préférence en vers mais c'était un critère secondaire, le travail
de la forme était mis sur le second plan.
De cette manière, toute œuvre qui ne mettait pas en scène
un récit d'hommes en action n'était pas considéré comme littéraire.
C'est pourquoi la poésie lyrique
était par exemple exclue de cette définition.
Les fables, bien qu'elles mettent en scène des
personnages ou des figures en action et qu'elles soient en vers, n'étaient pas considérées comme de
la littérature non plus par jugement de valeur.
Le travail du fond, du sujet d'une œuvre a donc
toujours été plus central dans la définition de la littérature que le travail de la forme qui n'avait pas
la même importance, ce qui tend à prouver que c'est avant tout les enjeux, la diégèse d'une œuvre
littéraire qui fondent « la valeur de l'art ».
De plus, la forme littéraire que revêt une œuvre est liée à la langue et aux codes d'écriture de
son époque, si bien que certaines œuvres attirent moins les lecteurs avec le temps car leur langage
n'a pas la même accessibilité pour les générations postérieures.
Au contraire, le contenu, le fond
d'une œuvre est intemporel, surtout s'il « en vaut la peine » comme disait Rochlitz.
Par exemple, La
princesse de Clèves de Mme de Lafayette est un ouvrage qui est plus souvent étudié, analysé dans
un contexte scolaire pour être compris que lu par plaisir.
Le « style modeste » ( expression d'Albert
Béguin ) de Lafayette qui emploie beaucoup de litotes et d'euphémismes comme « Sa passion n'était
point diminuée » par exemple, peut rebuter le lecteur contemporain, et certaines expressions tendent.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- en quoi la littérature est-elle apte à dénoncer ?
- Littérature D'idée, Olympe de Gouges Fiche de revision
- Littérature française du XVIIe
- L’univers moyenâgeux en littérature
- Littérature africaine, CHEIKH ANTA DIOP