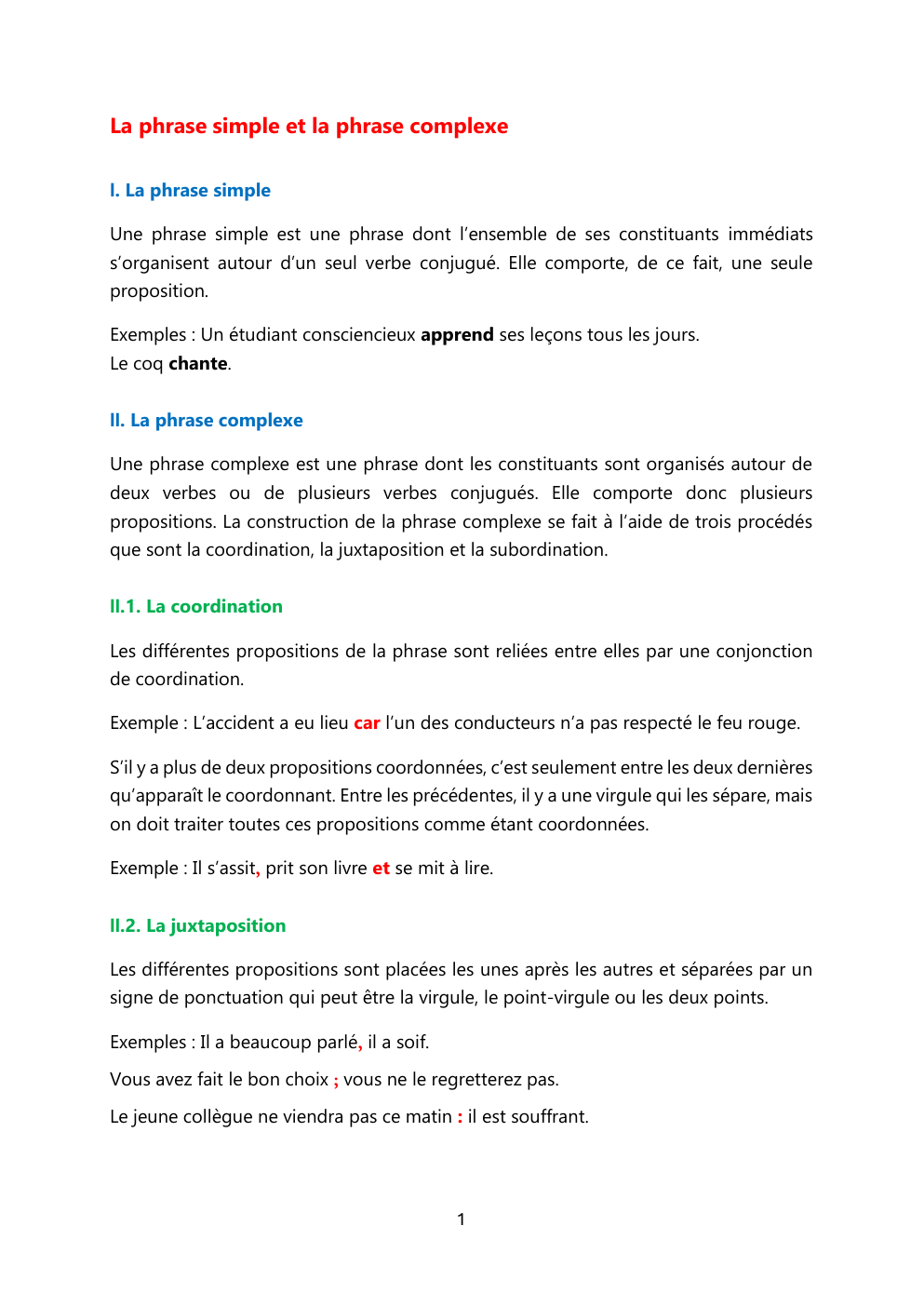La phrase simple et la phrase complexe
Publié le 27/05/2025
Extrait du document
«
La phrase simple et la phrase complexe
I.
La phrase simple
Une phrase simple est une phrase dont l’ensemble de ses constituants immédiats
s’organisent autour d’un seul verbe conjugué.
Elle comporte, de ce fait, une seule
proposition.
Exemples : Un étudiant consciencieux apprend ses leçons tous les jours.
Le coq chante.
II.
La phrase complexe
Une phrase complexe est une phrase dont les constituants sont organisés autour de
deux verbes ou de plusieurs verbes conjugués.
Elle comporte donc plusieurs
propositions.
La construction de la phrase complexe se fait à l’aide de trois procédés
que sont la coordination, la juxtaposition et la subordination.
II.1.
La coordination
Les différentes propositions de la phrase sont reliées entre elles par une conjonction
de coordination.
Exemple : L’accident a eu lieu car l’un des conducteurs n’a pas respecté le feu rouge.
S’il y a plus de deux propositions coordonnées, c’est seulement entre les deux dernières
qu’apparaît le coordonnant.
Entre les précédentes, il y a une virgule qui les sépare, mais
on doit traiter toutes ces propositions comme étant coordonnées.
Exemple : Il s’assit, prit son livre et se mit à lire.
II.2.
La juxtaposition
Les différentes propositions sont placées les unes après les autres et séparées par un
signe de ponctuation qui peut être la virgule, le point-virgule ou les deux points.
Exemples : Il a beaucoup parlé, il a soif.
Vous avez fait le bon choix ; vous ne le regretterez pas.
Le jeune collègue ne viendra pas ce matin : il est souffrant.
1
II.3.
La subordination
Dans la subordination, un pronom relatif ou une conjonction de subordination
introduit un rapport de dépendance entre deux propositions.
Exemples : Nous suspendrons le cours quand il sera l’heure.
Le pantalon qu’elle porte est moulant.
III.
Les types de propositions
Une phrase complexe est constituée d’au moins deux propositions.
On appelle
proposition, une phrase élémentaire constituée d’un sujet et d’un verbe.
Dans une
phrase, le décompte des propositions est fonction du nombre de verbes conjugués.
En
clair, il y a, dans une phrase, autant de propositions que de verbes conjugués.
Exemple : Je suis bien content de la résolution que vous prenez ; elle sera approuvée
de tout le monde.
La phrase est constituée de trois propositions sur la base des trois verbes, « suis »,
« prenez » et « sera approuvée ».
On distingue trois types de propositions : la proposition indépendante, la proposition
principale et la proposition subordonnée.
III.1.
La proposition indépendante
La proposition indépendante est autonome et se suffit à elle-même, car elle ne dépend
d’aucune autre proposition et aucune autre proposition ne dépend d’elle.
On la trouve
dans la phrase simple, dans la phrase complexe coordonnée et dans la phrase
complexe juxtaposée.
Exemples : Les enfants jouent sous le grand manguier.
P.
I.
Cette fille est belle mais elle est de mœurs douteuses.
P.
I.
P.
I.
Il a beaucoup parlé, il a soif.
P.
I.
P.
I.
La proposition incise ou intercalée est une proposition indépendante tantôt insérée
dans le corps de la phrase tantôt rejetée à la fin pour indiquer que l’on rapporte les
propos de quelqu’un au style direct ou pour exprimer une sorte de parenthèse.
Exemples : Cette année, pensait-elle, j’ai des chances de réussir.
2
Un soir, t’en souviens-tu ? nous voguions en silence.
(Lamartine)
Je te savais insolent, lui dit-il.
NB : La proposition indépendante n’a pas de fonction.
III.2.
La proposition principale et la proposition subordonnée
On trouve la proposition principale et la proposition subordonnée dans la phrase
complexe subordonnée.
La proposition subordonnée dépend syntaxiquement de la
proposition principale qui, elle, est autonome.
Exemples : Nous suspendrons le cours quand il sera l’heure.
P.
P.
P.
S.
Le pantalon qu’elle porte est moulant.
- le pantalon est moulant : proposition principale
- qu’elle porte : proposition subordonnée
III.3.
Les différentes propositions subordonnées
Il existe plusieurs types de propositions subordonnées.
III.3.1.
La proposition subordonnée relative
La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif (qui, que,
dont, où, lequel, duquel, auquel).
Elle a pour fonction complément de l’antécédent.
Exemples : Le bureau dans lequel il travaille est climatisé.
P.
S.
R.
Le quartier où il habite est loin de l’université.
P.
S.
R.
La subordonnée relative est dite explicative ou appositive lorsqu’elle apporte juste une
précision sur l’antécédent, sans pour autant être indispensable ; on s’en aperçoit
d’ailleurs à travers la ou les virgules qui la sépare(nt) de la proposition principale.
Exemple : Nous avons rencontré un témoin, lequel, craignant pour sa sécurité, a préféré
ne rien dire.
- nous avons rencontré un témoin : proposition principale
- lequel, craignant pour sa sécurité, a préféré ne rien dire : proposition subordonnée
relative explicative, introduite par le pronom relatif « lequel », complément de
l’antécédent « témoin ».
3
La relative est dite déterminative ou restrictive quand elle restreint l’extension de
l’antécédent ; dans ce cas, elle est indispensable et aucune virgule ne la sépare de la
principale.
Exemple : Nos candidats qui s’étaient bien préparés ont été reçus.
- nos candidats ont été reçus : proposition principale
- qui s’étaient bien préparés : proposition subordonnée relative déterminative,
introduite par le pronom relatif « qui », complément de l’antécédent « candidats »
Certaines phrases peuvent être construites avec des propositions subordonnées
relatives sans antécédent.
Exemples : Je ne vois pas qui pourrait me rendre ce service.
Qui vivra verra.
Dans pareil cas, l’antécédent est en fait sous-entendu.
Il s’agit de « la personne » ou de
« celui » dans l’exemple 1 (Je ne vois pas la personne qui pourrait me rendre ce service.)
et de « celui » dans l’exemple 2 (Celui qui vivra verra.).
Ce type de subordonnée
s’analyse comme suit :
- qui pourrait me rendre ce service : proposition subordonnée relative déterminative,
complément de l’antécédent sous-entendu « la personne »
- qui vivra : proposition subordonnée relative déterminative, complément de
l’antécédent sous-entendu « celui ».
III.3.2.
La proposition subordonnée conjonctive
La proposition subordonnée conjonctive est introduite par une conjonction de
subordination.
Elle a deux fonctions : complément d’objet et complément
circonstanciel.
La proposition subordonnée conjonctive qui a pour fonction complément d’objet est
introduite par la conjonction de subordination « que » ou la locution conjonctive
« à ce que, de ce que ».
Sa fonction est complément d’objet (direct ou indirect) du
verbe de la proposition principale.
Exemples : Nous savons tous que la vie est devenue chère.
- que la vie est devenue chère : proposition subordonnée conjonctive, introduite par la
conjonction de subordination « que », complément d’objet direct de "savons"
Le prévenu s’étonne qu’on lui ait interdit la visite des membres de sa famille.
P.
S.
conj.
Il s’attendait à ce qu’on le félicite pour sa nomination.
4
- à ce qu’on le félicite pour sa nomination : proposition subordonnée conjonctive,
introduite par la locution conjonctive « à ce que », complément d’objet indirect de
"s’attendait"
La proposition subordonnée conjonctive dont la fonction est complément
circonstanciel est introduite par des conjonctions de subordination autre que « que ».
Il s’agit, notamment, de : quand, lorsque, pendant que, parce que, puisque, sous
prétexte que, si bien que, de sorte que, afin que, pour que, de peur que, si, au cas où,
pourvu que, pour peu que, alors que, tandis que, etc.
Elle a pour fonction complément
circonstanciel du verbe de la proposition principale.
Exemples : J’ai eu une bonne note parce que j’ai bien appris mes leçons.
P.
S.
conj.
J’aime bien quand tu souris.
P.
S.
conj.
Les différentes fonctions de la proposition subordonnée conjonctive
circonstancielle
Le complément circonstanciel de temps
La subordonnée circonstancielle de temps situe l’action dans le temps.
Elle est
introduite par les conjonctions et locutions conjonctives suivantes : quand, lorsque,
pendant que, depuis que, dès que, au moment où, avant que, après que, jusqu’à ce
que, aussitôt que, sitôt que, maintenant que, tandis que, à l’instant où, tant que, aussi
longtemps que, chaque fois que, toutes les fois que, à mesure que, au fur et à mesure
que, du moment où, du moment que, en même temps....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dans L'Ère du soupçon (1956), Nathalie Sarraute invite les lecteurs à « trouver dans la littérature cette satisfaction essentielle qu'elle seule peut leur donner: une connaissance plus approfondie, plus complexe, plus lucide, plus juste que celle qu'lis peuvent avoir par eux-mêmes de ce qu'ils sont, de ce qu'est leur condition et leur vie. » Cette phrase vous donne-t-elle une idée exacte des enrichissements que vous trouvez dans la lecture des oeuvres littéraires?
- Annie Ernaux Passion simple
- Grand oral musique: Peut-on considérer la musique comme un simple divertissement ?
- L’insertion de citations dans une phrase
- Commenter cette phrase de Jules Lemaître : « J'admire ce surprenant Molière de toute mon âme : tandis qu'il intéresse les érudits, il fait penser les philosophes, et sait, mieux que tout autre, amuser les enfants. »