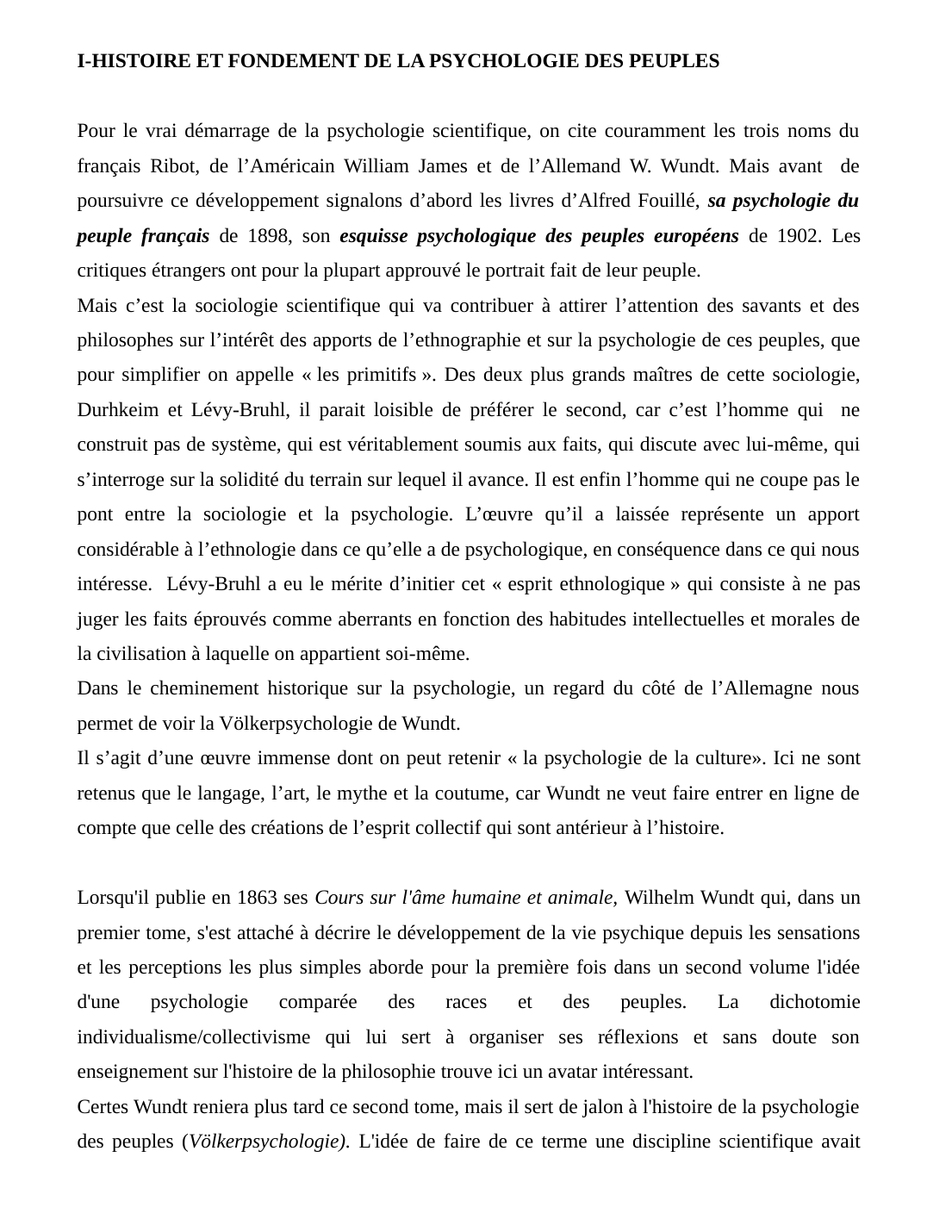La mentalité primitive
Publié le 04/02/2022

Extrait du document
«
I-HISTOIRE ET FONDEMENT DE LA PSYCHOLOGIE DES PEUPLES
Pour le vrai démarrage de la psychologie scientifique, on cite couramment les trois noms du
français Ribot, de l’Américain William James et de l’Allemand W.
Wundt.
Mais avant de
poursuivre ce développement signalons d’abord les livres d’Alfred Fouillé, sa psychologie du
peuple français de 1898, son esquisse psychologique des peuples européens de 1902.
Les
critiques étrangers ont pour la plupart approuvé le portrait fait de leur peuple.
Mais c’est la sociologie scientifique qui va contribuer à attirer l’attention des savants et des
philosophes sur l’intérêt des apports de l’ethnographie et sur la psychologie de ces peuples, que
pour simplifier on appelle « les primitifs ».
Des deux plus grands maîtres de cette sociologie,
Durhkeim et Lévy-Bruhl, il parait loisible de préférer le second, car c’est l’homme qui ne
construit pas de système, qui est véritablement soumis aux faits, qui discute avec lui-même, qui
s’interroge sur la solidité du terrain sur lequel il avance.
Il est enfin l’homme qui ne coupe pas le
pont entre la sociologie et la psychologie.
L’œuvre qu’il a laissée représente un apport
considérable à l’ethnologie dans ce qu’elle a de psychologique, en conséquence dans ce qui nous
intéresse.
Lévy-Bruhl a eu le mérite d’initier cet « esprit ethnologique » qui consiste à ne pas
juger les faits éprouvés comme aberrants en fonction des habitudes intellectuelles et morales de
la civilisation à laquelle on appartient soi-même.
Dans le cheminement historique sur la psychologie, un regard du côté de l’Allemagne nous
permet de voir la Völkerpsychologie de Wundt.
Il s’agit d’une œuvre immense dont on peut retenir « la psychologie de la culture».
Ici ne sont
retenus que le langage, l’art, le mythe et la coutume, car Wundt ne veut faire entrer en ligne de
compte que celle des créations de l’esprit collectif qui sont antérieur à l’histoire.
Lorsqu'il publie en 1863 ses Cours sur l'âme humaine et animale, Wilhelm Wundt qui, dans un
premier tome, s'est attaché à décrire le développement de la vie psychique depuis les sensations
et les perceptions les plus simples aborde pour la première fois dans un second volume l'idée
d'une psychologie comparée des races et des peuples.
La dichotomie
individualisme/collectivisme qui lui sert à organiser ses réflexions et sans doute son
enseignement sur l'histoire de la philosophie trouve ici un avatar intéressant.
Certes Wundt reniera plus tard ce second tome, mais il sert de jalon à l'histoire de la psychologie
des peuples ( Völkerpsychologie).
L'idée de faire de ce terme une discipline scientifique avait.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Pétrone Raymond Queneaude l'Académie Goncourt " La mentalité primitive " qui faisait florès au temps où je préparais enSorbonne mon certificat de morale et sociologie, déjà contestée alors, amaintenant fait long feu.
- II) Ensuite, nous pouvons constater assez aisément les impacts non désirés sur la mentalité des jeunes vis-à-vis de l'armée.
- Le théâtre baroque repose sur le paradoxe de la coexistence, dans un monde marqué par les valeurs religieuses, d'une mentalité faite à la fois de renoncement ascétique et d'affirmation stoïcienne et orgueilleuse de l'individu, de désabusement à l'égard des prestiges illusoires du monde et, en même temps, de sensualité, d'avidité et de soif de vivre.
- L'imagination est pour la mentalité magique « l'intermédiaire entre la perception et la pensée » (p. 44). L\'Encyclopédie de L\'Agora
- Comment calculer une intégrale dont on ne connait pas la primitive