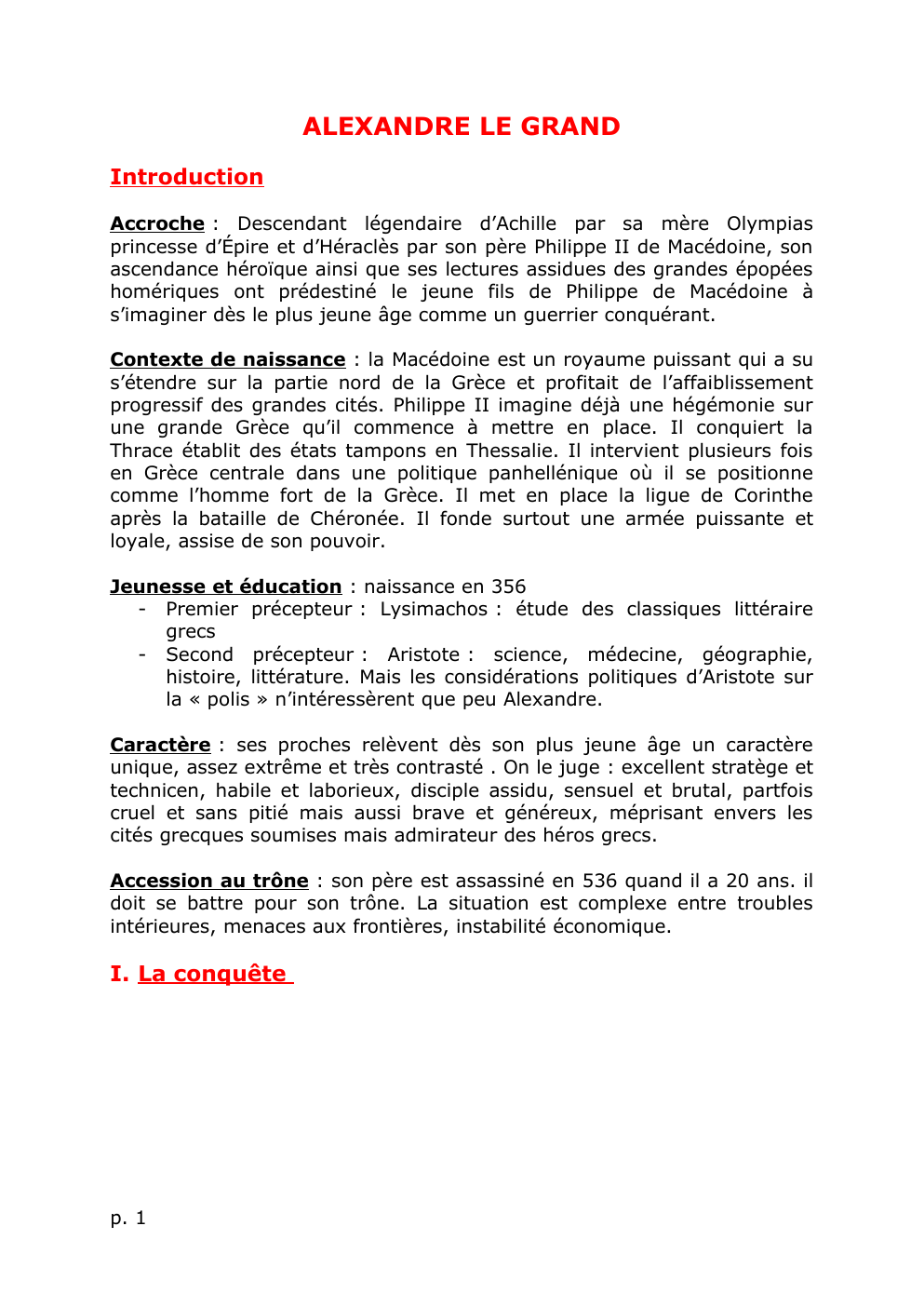khôlle sur Alexandre le Grand
Publié le 21/02/2024
Extrait du document
«
ALEXANDRE LE GRAND
Introduction
Accroche : Descendant légendaire d’Achille par sa mère Olympias
princesse d’Épire et d’Héraclès par son père Philippe II de Macédoine, son
ascendance héroïque ainsi que ses lectures assidues des grandes épopées
homériques ont prédestiné le jeune fils de Philippe de Macédoine à
s’imaginer dès le plus jeune âge comme un guerrier conquérant.
Contexte de naissance : la Macédoine est un royaume puissant qui a su
s’étendre sur la partie nord de la Grèce et profitait de l’affaiblissement
progressif des grandes cités.
Philippe II imagine déjà une hégémonie sur
une grande Grèce qu’il commence à mettre en place.
Il conquiert la
Thrace établit des états tampons en Thessalie.
Il intervient plusieurs fois
en Grèce centrale dans une politique panhellénique où il se positionne
comme l’homme fort de la Grèce.
Il met en place la ligue de Corinthe
après la bataille de Chéronée.
Il fonde surtout une armée puissante et
loyale, assise de son pouvoir.
Jeunesse et éducation : naissance en 356
- Premier précepteur : Lysimachos : étude des classiques littéraire
grecs
- Second précepteur : Aristote : science, médecine, géographie,
histoire, littérature.
Mais les considérations politiques d’Aristote sur
la « polis » n’intéressèrent que peu Alexandre.
Caractère : ses proches relèvent dès son plus jeune âge un caractère
unique, assez extrême et très contrasté .
On le juge : excellent stratège et
technicen, habile et laborieux, disciple assidu, sensuel et brutal, partfois
cruel et sans pitié mais aussi brave et généreux, méprisant envers les
cités grecques soumises mais admirateur des héros grecs.
Accession au trône : son père est assassiné en 536 quand il a 20 ans.
il
doit se battre pour son trône.
La situation est complexe entre troubles
intérieures, menaces aux frontières, instabilité économique.
I.
La conquête
p.
1
1.
La campagne de 334
1.
Raisons
Nous
-
n’avons que des hypothèses sur les raisons de la conquête
Vengeance contre les perses qui ont tant tourmenté les grecs
Volonté de propager la civilisation grecque
Il pensait gagner l’approbation des grecs en battant le grand roi
mais les grecs avaient su composé avec l’empire perse depuis les
guerres médiques
- Volonté d’occuper les régions côtières
Selon une formule bien connue de (W.W.) Tarn, « la raison principale pour
laquelle Alexandre envahit la Perse fut, sans aucun doute, qu’il ne lui vint
jamais à l’idée de ne pas le faire ».
Dans tous les cas il se présente en nouvel Achille qui libère les cités
grecques de Ionie.
2.
Déroulement
La bataille sur le Granique, le premier fleuve de Phrygie, lui donna
accès aux capitales satrapiques : Daskyleion en Phrygie, puis Sardes.
De
Sardes à Éphèse, puis à Milet, l'entreprise de libération des cités se
précisa peu à peu ; elle se prolongea dans la Carie des Hécatomnides et
s'acheva en Lycie et en Pamphylie.
p.
2
Il s’arrête à Gordion comme frontière.
3.
Bataille navale
Les Perses contre-attaquèrent sur mer, sous le commandement d'un Grec
de Rhodes, Memnon, en s'efforçant de contrôler les iles où ils installèrent
des garnisons.
Ce fut une période difficile pour Alexandre, ce qui suscita les espoirs et les
entreprises indépendantistes de Sparte (voir ci-dessous).
Mais les iles
furent peu à peu reprises durant l'hiver 332-331; seules quelques-unes
resté.
rent en marge, comme Samos, clérouquie athénienne, et Rhodes
inféodée aux Perses.
4.
Alexandre, libérateur ou conquérant ?
Au cours des opérations, Alexandre apparut de moins en moins comme
l'hégémon des Grecs, surtout après qu'il eut renvoyé la flotte alliée en
334.
D'autre part, son œuvre de « libération » ne se limita pas aux cités
mais inclut les autres peuples d'Anatolie : le clivage entre Grecs et
Barbares s'estompait.
Le statut des cités grecques fut déterminé par le droit de la guerre, en
fonction de leur attitude lors de l'avance d'Alexandre.
Milet, qui avait
résisté, ne dut son salut qu'au pardon royal.
Éphèse, réticente, resta
tributaire.
Et quand libération il y eut, il s'agissait d'une liberté concédée
et précaire, comme le montre bien le cas d'Aspendos : cette cité, qui avait
obtenu l'autonomie, renâcla dans l'accomplissement de ses obligations
militaires; elle fut alors assiégée et assujettie à un tribut et à des levées
de soldats et de chevaux.
Tout dépendait, en définitive, du bon plaisir du
roi.
L'objectif du roi était surtout fiscal.
Il leva une contribution de guerre
(syntaxis) à la place du tribut perse, et nomma un « collecteur de la taxe
», « commandant du rivage », qui intervint dans la vie des cités un peu
comme un satrape.
A partir de 331, cette circonscription fiscale sera
intégrée à un ensemble plus vaste, qui établira l'ordre macédonien dans
toute la façade maritime de l'empire, des Détroits à l'Égypte.
Les cités
d'Asie restaient dissociées de celles des Balkans; leur destin s'inscrivait
dans la suite de la conquête.
2.
La conquête de l’empire perse (achéménide)
Trois étapes car l’empire était composé de cercles concentriques autour
des capitales historiques :
- Iran : Ectebane et Perspolis
- Au-delà du Tigre : Suse
- Mésopotamie : Babylone
p.
3
Il y’avait beaucoup de frontières naturelles : fleuves, montagne.
Ce sont
sur ces lignes décisives que se livrent les batailles les plus importantes.
1.
La façade méditerranéenne
333-331 : conquête de la périphérie de l’empire (« au-delà de l’Euphrate »
en perse »).
Il franchit le Taurus depuis l’actuelle Turquie.
Il affronte le roi
Darius III de Perse dans la plaine d’Issos en 333.
La voie de l’Égypte est
ouverte.
Il conquiert la Phénicie, la Syrie et la Palestine et l’Égypte.
Le
siège de Tyr ralentit la conquête.
Organisation de la conquête :
- Refuse les négociations avec Darius a plusieurs reprises
- Création de deux districts fiscaux pour financer l’armée notamment.
o Syrie-Phénicie
o Égypte
- Mise en place du nécessaire pour des conquêtes qui allaient devenir
plus lointaines
o Communication
o Approvisionnement
2.
Les capitales d’empire
331 : passage de l’Euphrate
331 : passage du Tigre
Darius n’arrive pas à l’arrêter par la négociation ou en livrant des
batailles
331 : bataille de Gaugamèles : La victoire d'Alexandre à Gaugamèles a
été décisive et a permis à son armée de prendre le contrôle de la
Babylonie, de la Mésopotamie et de la Susiane.
331 : Babylone se rallie sans même livrer bataille sous l’instigation de son
satrape hellénisé.
331 : la reddition de Suse est négociée
330 : conquête de Persépolis, capitale du royaume.
40 700 soldats perses
défendaient la ville au niveau des portes persiques (défilé rocheux).
Il
réussit à retourner la situation et seul le satrape avec quelques militaires
réussirent à s’échapper.
Certains haut-fonctionnaires perses se rallient à
lui, tendance qui s’observait déjà en Chaldée en et Susiane.
Il détruit la ville sauf les palais royaux qui l’ont impressionné car il a vu de
nombreux grecs mutilés par les perses comme vengeance.
Il aurait pu
occuper simplement la ville car elle ne résistait pas.
Pourquoi détruire la
ville ?
- Vengeance de ces pauvres grecs mutilés ?
p.
4
-
Vengeance contre les pertes infligés aux grecs lors de la bataille des
portes persiques ? Mais ils avaient déjà resisté vigoureusement dans
d’autres lieux.
- Haine de Darius ? (mais tous les perses ne sont pas Darius)
- C’est de Persépolis que sont partis les agresseurs de la grèce durant
les guerres médiques ? souvenir des ravages commis par Darius le
grand et Xerxes ?
Explication probable : il voulait assoir son pouvoir et notamment
jusqu’en Grèce où il y’avait des agitations.
Cela impressionnait les
opposants et réunissait les grecs.
Darius fuit à Ecbatane, la capitale d’hiver.
3.
Les hautes satrapies
Conquêtes longues et difficiles.
Il met trois ans à arriver au fleuve Iaxarte
(actuel Ouzbékistan) qui était la limite de l’empire de Cyrus.
Dans les
régions de la steppe il installa 20 000 colons et construisit un cordon de
forteresses en Afghanistan, il intégra l’aristocratie locale et épousa
Roxane, une princesse Sogdiane.
Restait le Penjâb, puisque l'Indus était considéré depuis le VIe siècle
comme la frontière orientale de l'empire.
Au printemps 327, Alexandre
franchit l'Hindou-Kouch (montagne du nord du Pakistan) avec une armée
cosmopolite de 120 000 hommes et atteignit l'Indus au printemps 326.
Il
passa le fleuve, appelé par le roi de Taxila, qui régnait entre l'Indus et
l'Hydaspe et redoutait l'expansion de son voisin Porôs.
Alexandre
réorganisa les principautés indiennes du Gandhara et pacifia les
contreforts himalayens.
Il battit Porôs et découvrit les éléphants de
guerre.
Mais il ne put convaincre ses troupes de passer l'Hyphase (limite
orientale du Penjab) et d'entreprendre la conquête de la plaine du Gange.
Au-delà de l'Indus, il n'y eut ni occupation militaire, ni colonisation : le roi
chercha seulement la soumission des princes indiens.
Le retour commença en septembre 325 et se fit en trois groupes : Cratere
prit la route classique du Kandahar ; Alexandre suivit le littoral, désertique
et inhospitalier, pour soutenir la flotte de Néarque, qui reconnaissait
l'océan Indien.
La jonction eut lieu à l'entrée du golfe Persique en
décembre 325.
A)
La soumission de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Pyrrhus319-272Roi d'ÉpireLa carrière d'Alexandre le Grand détermina la création d'un nouveau monde.
- Alexis Andreïevitch, comte Araktcheiev1769-1834Général d'artillerie, grand favori de Paul Ier et d'Alexandre Ier, connu pour sa minutie, sasévérité, et même sa cruauté, qui indisposèrent tant de gens.
- Alexandre Borodine1833-1887Fils naturel du prince Gedeanow, médecin et chimiste, il reçut en musique les conseils deBalakirev et adhéra au groupe des Cinq dès sa création (1862) ; grand voyageur, il fut enAllemagne, comme tant d'autres, encouragé par Liszt.
- Alexandre Pouchkine par Wladimir Weidlé Voici le plus européen et le moins compris en Europe des grands écrivainsde la Russie, le plus grand et le plus intraduisible des poètes.
- Alexandre Pouchkine Éduqué dans la langue et la culture françaises, comme il était d'usage dansles familles aristocratiques russes au XIXe siècle, Pouchkine découvrit lescontes folkloriques grâce à sa grand-mère maternelle.