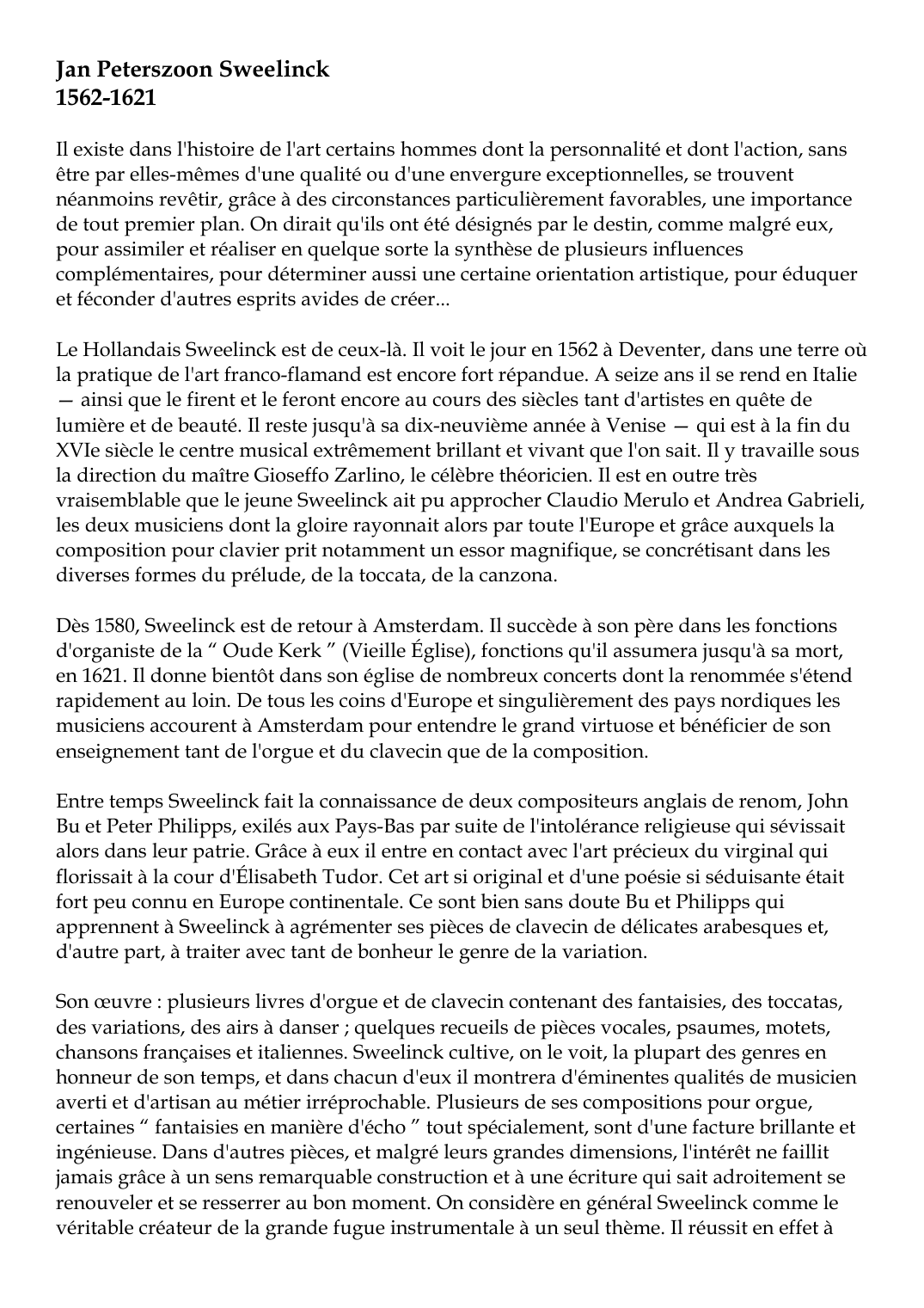Jan Peterszoon Sweelinck (1562-1621) Il existe dans l'histoire de l'art certains hommes
Publié le 23/05/2020

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Jan Peterszoon Sweelinck (1562-1621) Il existe dans l'histoire de l'art certains hommes Ce document contient 1021 mots soit 2 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Culture générale.
SWEELINCK Jan Pieterzoon. Organiste et compositeur néerlandais. Né à Deventer en mai 1562, mort à Amsterdam le 16 octobre 1621. Son père, qui fut son premier maître, était organiste de la Vieille Eglise, « Oude Kerk » d’Amsterdam; il mourut en 1573. L’enfant continua ses études musicales avec Willem Lossy à Haarlem. En 1580, il est mentionné comme organiste de la « Oude Kerk ». Il le restera toute sa vie, ne quittant jamais les Pays-Bas. Ses fonctions officielles impliquaient des concerts quotidiens en dehors des offices. Son œuvre vocale est importante : des Livres de Chansons françaises à 4 ou 5 voix publiés de 1592 à 1594, les Quatre Livres des Psaumes de David, harmonisation à 4 et 8 voix du psautier huguenot, de 1604 à 1621, les Rimes françaises et italiennes en 1612, et en 1619 les Cantiones Sacrae, textes religieux en latin, qui laisseraient supposer son adhésion au catholicisme. Mais surtout, Sweelinck est l’un des plus grands organistes de son temps. Sa musique instrumentale pour clavier, orgue ou clavecin, comprend des fantaisies, dont cinq en forme d’écho, un capriccio, des toccatas, un prélude, des variations sur des chorals (v. Toccatas et œuvres pour orgue). Le trait le plus remarquable et le plus nouveau de ses compositions est l’unité gardée au sein d’un morceau jusqu’à la limite du développement possible; la structure de chaque pièce est construite sur un seul thème. L’influence de Sweelinck fut très grande. Il fut un maître renommé; citons parmi ses élèves Scheidt et Praetorius. On peut dire qu’il forma une génération d’organistes qui tiendra les principales orgues, en particulier en Allemagne du Nord, et qu’ainsi son influence s’étendra jusqu’à Bach et Haendel. Bien que son œuvre instrumentale n’ait pas été publiée, que lui-même n’ait jamais quitté Amsterdam, ses manuscrits se sont répandus à travers l'Europe, témoignant de l’étendue de son influence. On retrouve en Angleterre, dans l’œuvre de John Bull, une Fantaisie sur un thème de Sweelinck, datée du 15 décembre 1621, quelques semaines après sa mort.
«
Jan Peterszoon Sweelinck
1562-1621
Il existe dans l'histoire de l'art certains hommes dont la personnalité et dont l'action, sans
être par elles-mêmes d'une qualité ou d'une envergure exceptionnelles, se trouvent
néanmoins revêtir, grâce à des circonstances particulièrement favorables, une importance
de tout premier plan.
On dirait qu'ils ont été désignés par le destin, comme malgré eux,
pour assimiler et réaliser en quelque sorte la synthèse de plusieurs influences
complémentaires, pour déterminer aussi une certaine orientation artistique, pour éduquer
et féconder d'autres esprits avides de créer...
Le Hollandais Sweelinck est de ceux-là.
Il voit le jour en 1562 à Deventer, dans une terre où
la pratique de l'art franco-flamand est encore fort répandue.
A seize ans il se rend en Italie
— ainsi que le firent et le feront encore au cours des siècles tant d'artistes en quête de
lumière et de beauté.
Il reste jusqu'à sa dix-neuvième année à Venise — qui est à la fin du
XVIe siècle le centre musical extrêmement brillant et vivant que l'on sait.
Il y travaille sous
la direction du maître Gioseffo Zarlino, le célèbre théoricien.
Il est en outre très
vraisemblable que le jeune Sweelinck ait pu approcher Claudio Merulo et Andrea Gabrieli,
les deux musiciens dont la gloire rayonnait alors par toute l'Europe et grâce auxquels la
composition pour clavier prit notamment un essor magnifique, se concrétisant dans les
diverses formes du prélude, de la toccata, de la canzona.
Dès 1580, Sweelinck est de retour à Amsterdam.
Il succède à son père dans les fonctions
d'organiste de la “ Oude Kerk ” (Vieille Église), fonctions qu'il assumera jusqu'à sa mort,
en 1621.
Il donne bientôt dans son église de nombreux concerts dont la renommée s'étend
rapidement au loin.
De tous les coins d'Europe et singulièrement des pays nordiques les
musiciens accourent à Amsterdam pour entendre le grand virtuose et bénéficier de son
enseignement tant de l'orgue et du clavecin que de la composition.
Entre temps Sweelinck fait la connaissance de deux compositeurs anglais de renom, John
Bu et Peter Philipps, exilés aux Pays-Bas par suite de l'intolérance religieuse qui sévissait
alors dans leur patrie.
Grâce à eux il entre en contact avec l'art précieux du virginal qui
florissait à la cour d'Élisabeth Tudor.
Cet art si original et d'une poésie si séduisante était
fort peu connu en Europe continentale.
Ce sont bien sans doute Bu et Philipps qui
apprennent à Sweelinck à agrémenter ses pièces de clavecin de délicates arabesques et,
d'autre part, à traiter avec tant de bonheur le genre de la variation.
Son œ uvre : plusieurs livres d'orgue et de clavecin contenant des fantaisies, des toccatas,
des variations, des airs à danser ; quelques recueils de pièces vocales, psaumes, motets,
chansons françaises et italiennes.
Sweelinck cultive, on le voit, la plupart des genres en
honneur de son temps, et dans chacun d'eux il montrera d'éminentes qualités de musicien
averti et d'artisan au métier irréprochable.
Plusieurs de ses compositions pour orgue,
certaines “ fantaisies en manière d'écho ” tout spécialement, sont d'une facture brillante et
ingénieuse.
Dans d'autres pièces, et malgré leurs grandes dimensions, l'intérêt ne faillit
jamais grâce à un sens remarquable construction et à une écriture qui sait adroitement se
renouveler et se resserrer au bon moment.
On considère en général Sweelinck comme le
véritable créateur de la grande fugue instrumentale à un seul thème.
Il réussit en effet à.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dans la préface de Cromwell (1827), Victor Hugo écrit : « le théâtre est un point d'optique : Tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, dans la vie, dans l'homme ; tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la baguette magique de l'art » Vous commenterez et discuterez ces propos?
- Commentaire d'Histoire de l'art sur le Galate mourant
- Théorie de l'histoire de l'art
- « L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. II est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. »
- Depuis les temps anciens jusqu'aux tentatives de l'avant-garde, la littérature s'affaire à représenter quelque chose. Quoi ? Je dirai brutalement : le réel. Le réel n'est pas représentable et c'est parce que les hommes veulent sans cesse le représenter par des mots, qu'il y a une histoire de la littérature [...] ou pour mieux dire des productions de langage, qui serait l'histoire des expédients verbaux, souvent très fous pour réduire, apprivoiser, nier, ou au contraire assumer ce qui e