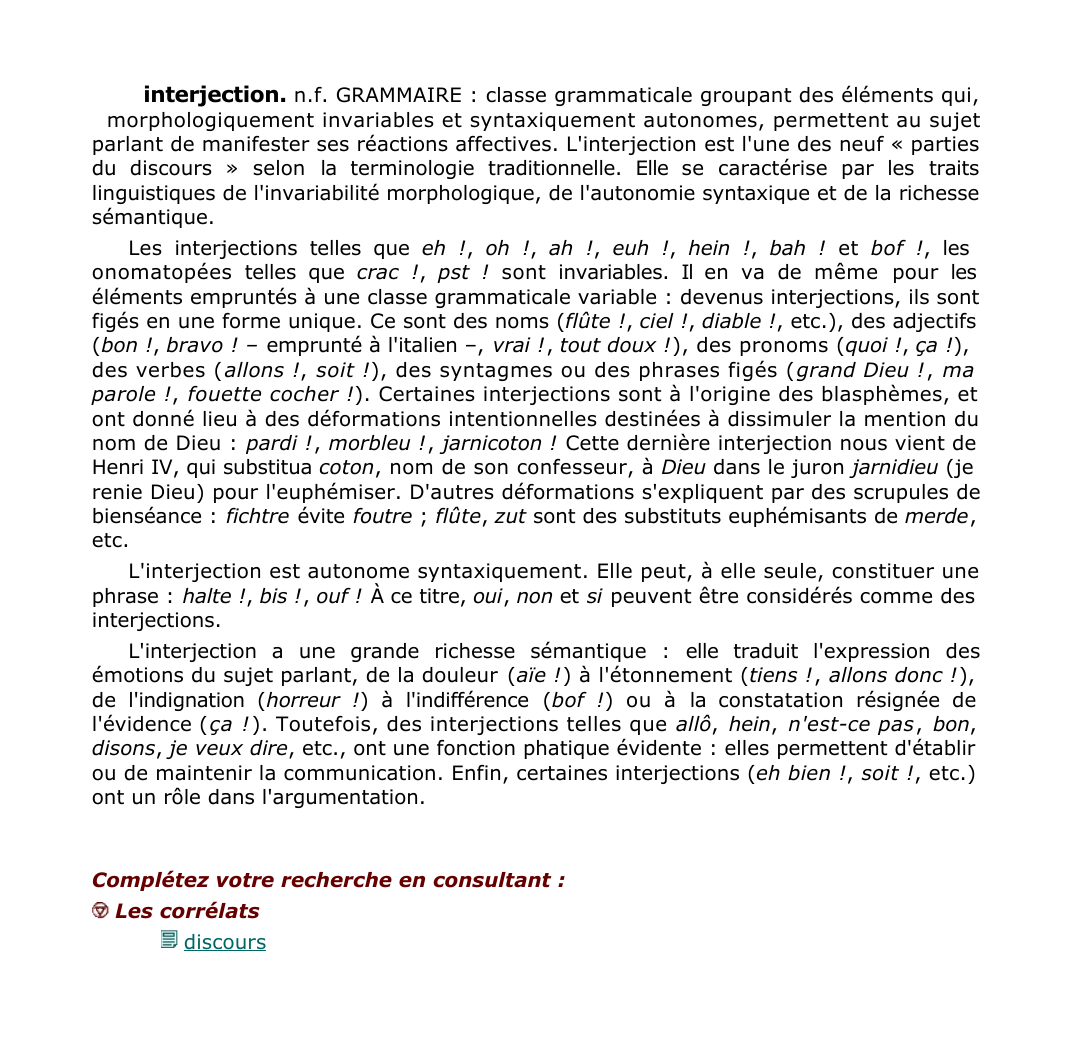interjection.
Publié le 08/12/2021

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : interjection.. Ce document contient 360 mots. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système d’échange gratuit de ressources numériques ou achetez-le pour la modique somme d’un euro symbolique. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en : Encyclopédie
interjection. n.f. GRAMMAIRE : classe grammaticale groupant des éléments qui,
morphologiquement invariables et syntaxiquement autonomes, permettent au sujet
parlant de manifester ses réactions affectives. L'interjection est l'une des neuf « parties
du discours « selon la terminologie traditionnelle. Elle se caractérise par les traits
linguistiques de l'invariabilité morphologique, de l'autonomie syntaxique et de la richesse
sémantique.
Les interjections telles que eh !, oh !, ah !, euh !, hein !, bah ! et bof !, les
onomatopées telles que crac !, pst ! sont invariables. Il en va de même pour les
éléments empruntés à une classe grammaticale variable : devenus interjections, ils sont
figés en une forme unique. Ce sont des noms (flûte !, ciel !, diable !, etc.), des adjectifs
(bon !, bravo ! - emprunté à l'italien -, vrai ! , tout doux ! ), des pronoms (quoi !, ça !),
des verbes ( allons !, s oit !), des syntagmes ou des phrases figés ( grand Dieu ! , m a
parole !, fouette cocher !). Certaines interjections sont à l'origine des blasphèmes, et
ont donné lieu à des déformations intentionnelles destinées à dissimuler la mention du
nom de Dieu : pardi ! , morbleu ! , jarnicoton ! Cette dernière interjection nous vient de
Henri IV, qui substitua coton, nom de son confesseur, à Dieu dans le juron jarnidieu (je
renie Dieu) pour l'euphémiser. D'autres déformations s'expliquent par des scrupules de
bienséance : fichtre évite foutre ; flûte, zut sont des substituts euphémisants de merde ,
etc.
L'interjection est autonome syntaxiquement. Elle peut, à elle seule, constituer une
phrase : halte !, bis ! , ouf ! À ce titre, oui , non et si peuvent être considérés comme des
interjections.
L'interjection a une grande richesse sémantique : elle traduit l'expression des
émotions du sujet parlant, de la douleur (aïe ! ) à l'étonnement (tiens ! , allons donc ! ),
de l'indignation (horreur !) à l'indifférence (bof !) ou à la constatation résignée de
l'évidence ( ça ! ). Toutefois, des interjections telles que allô, hein, n'est-ce pas , bon,
disons, je veux dire, etc., ont une fonction phatique évidente : elles permettent d'établir
ou de maintenir la communication. Enfin, certaines interjections (eh bien !, soit !, etc.)
ont un rôle dans l'argumentation.
Complétez votre recherche en consultant :
Les corrélats
discours
interjection. n.f. GRAMMAIRE : classe grammaticale groupant des éléments qui,
morphologiquement invariables et syntaxiquement autonomes, permettent au sujet
parlant de manifester ses réactions affectives. L'interjection est l'une des neuf « parties
du discours « selon la terminologie traditionnelle. Elle se caractérise par les traits
linguistiques de l'invariabilité morphologique, de l'autonomie syntaxique et de la richesse
sémantique.
Les interjections telles que eh !, oh !, ah !, euh !, hein !, bah ! et bof !, les
onomatopées telles que crac !, pst ! sont invariables. Il en va de même pour les
éléments empruntés à une classe grammaticale variable : devenus interjections, ils sont
figés en une forme unique. Ce sont des noms (flûte !, ciel !, diable !, etc.), des adjectifs
(bon !, bravo ! - emprunté à l'italien -, vrai ! , tout doux ! ), des pronoms (quoi !, ça !),
des verbes ( allons !, s oit !), des syntagmes ou des phrases figés ( grand Dieu ! , m a
parole !, fouette cocher !). Certaines interjections sont à l'origine des blasphèmes, et
ont donné lieu à des déformations intentionnelles destinées à dissimuler la mention du
nom de Dieu : pardi ! , morbleu ! , jarnicoton ! Cette dernière interjection nous vient de
Henri IV, qui substitua coton, nom de son confesseur, à Dieu dans le juron jarnidieu (je
renie Dieu) pour l'euphémiser. D'autres déformations s'expliquent par des scrupules de
bienséance : fichtre évite foutre ; flûte, zut sont des substituts euphémisants de merde ,
etc.
L'interjection est autonome syntaxiquement. Elle peut, à elle seule, constituer une
phrase : halte !, bis ! , ouf ! À ce titre, oui , non et si peuvent être considérés comme des
interjections.
L'interjection a une grande richesse sémantique : elle traduit l'expression des
émotions du sujet parlant, de la douleur (aïe ! ) à l'étonnement (tiens ! , allons donc ! ),
de l'indignation (horreur !) à l'indifférence (bof !) ou à la constatation résignée de
l'évidence ( ça ! ). Toutefois, des interjections telles que allô, hein, n'est-ce pas , bon,
disons, je veux dire, etc., ont une fonction phatique évidente : elles permettent d'établir
ou de maintenir la communication. Enfin, certaines interjections (eh bien !, soit !, etc.)
ont un rôle dans l'argumentation.
Complétez votre recherche en consultant :
Les corrélats
discours
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Définition: ADIEU, interjection et substantif masculin.
- AGA 1 , interjection.
- Définition du terme: COTCODAC, interjection.
- Prénom Nom Ville, le DateRueCP Ville Au Président du Tribunal d'instance Rue CP Ville Objet: interjection d'appel.