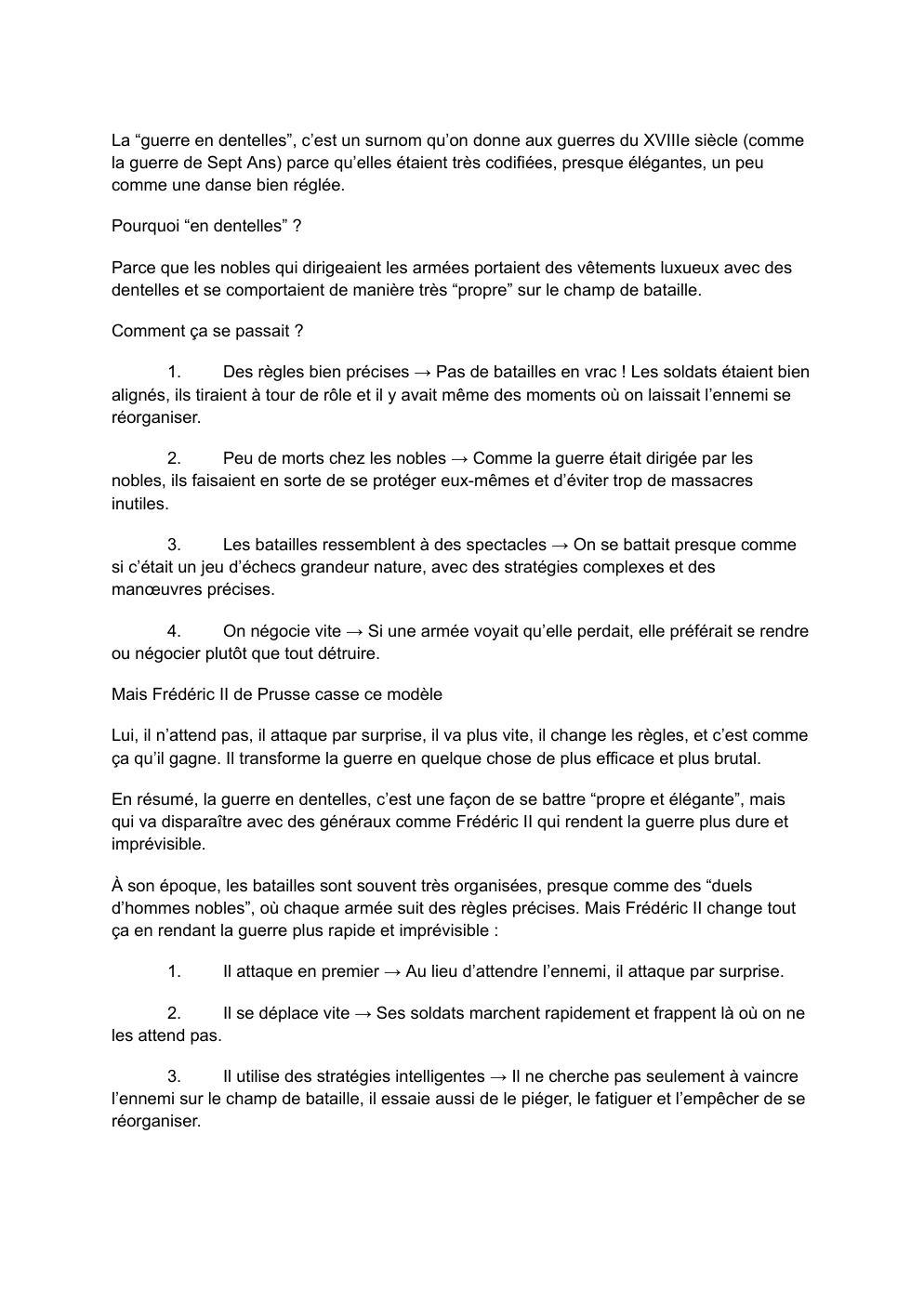HGGSP-thème 2 guerre et paix La “guerre en dentelles”
Publié le 19/05/2025
Extrait du document
«
La “guerre en dentelles”, c’est un surnom qu’on donne aux guerres du XVIIIe siècle (comme
la guerre de Sept Ans) parce qu’elles étaient très codifiées, presque élégantes, un peu
comme une danse bien réglée.
Pourquoi “en dentelles” ?
Parce que les nobles qui dirigeaient les armées portaient des vêtements luxueux avec des
dentelles et se comportaient de manière très “propre” sur le champ de bataille.
Comment ça se passait ?
1.
Des règles bien précises → Pas de batailles en vrac ! Les soldats étaient bien
alignés, ils tiraient à tour de rôle et il y avait même des moments où on laissait l’ennemi se
réorganiser.
2.
Peu de morts chez les nobles → Comme la guerre était dirigée par les
nobles, ils faisaient en sorte de se protéger eux-mêmes et d’éviter trop de massacres
inutiles.
3.
Les batailles ressemblent à des spectacles → On se battait presque comme
si c’était un jeu d’échecs grandeur nature, avec des stratégies complexes et des
manœuvres précises.
4.
On négocie vite → Si une armée voyait qu’elle perdait, elle préférait se rendre
ou négocier plutôt que tout détruire.
Mais Frédéric II de Prusse casse ce modèle
Lui, il n’attend pas, il attaque par surprise, il va plus vite, il change les règles, et c’est comme
ça qu’il gagne.
Il transforme la guerre en quelque chose de plus efficace et plus brutal.
En résumé, la guerre en dentelles, c’est une façon de se battre “propre et élégante”, mais
qui va disparaître avec des généraux comme Frédéric II qui rendent la guerre plus dure et
imprévisible.
À son époque, les batailles sont souvent très organisées, presque comme des “duels
d’hommes nobles”, où chaque armée suit des règles précises.
Mais Frédéric II change tout
ça en rendant la guerre plus rapide et imprévisible :
1.
Il attaque en premier → Au lieu d’attendre l’ennemi, il attaque par surprise.
2.
Il se déplace vite → Ses soldats marchent rapidement et frappent là où on ne
les attend pas.
3.
Il utilise des stratégies intelligentes → Il ne cherche pas seulement à vaincre
l’ennemi sur le champ de bataille, il essaie aussi de le piéger, le fatiguer et l’empêcher de se
réorganiser.
4.
Il s’adapte aux situations → Contrairement aux autres généraux qui suivent
toujours les mêmes plans, lui change de tactique en fonction de l’ennemi.
Grâce à ces méthodes, il réussit à tenir tête à plusieurs grandes puissances en même
temps, alors que la Prusse est un petit royaume comparé à la France ou l’Autriche.
En résumé, il transforme la guerre en un jeu plus rapide, plus malin et plus efficace, ce qui
l’aide à gagner malgré des adversaires plus forts que lui.
Guerre de 7 ans encore une guerre dite classique -> guerre en dentelle
Mais Frédéric II de Prusse change tt ça car il s’adapte à son terrain avec tte les contraintes
-> guerre réelle
•
La guerre en dentelles = la version “propre” de la guerre classique du XVIIIe siècle.
•
plus dure.
La guerre réelle = une guerre qui prend en compte les contraintes et qui est
•
Frédéric II de Prusse applique une guerre plus proche de la guerre réelle car
il utilise des stratégies plus efficaces et brutales pour gagner.
Donc, oui, la guerre de Sept Ans correspond bien à une guerre réelle et Frédéric II l’a
adoptée pour vaincre.
La guerre de Sept Ans mélange des batailles classiques inspirées de la guerre en dentelles
et des combats plus modernes et brutaux qui annoncent la guerre réelle.
Donc, oui, il y a encore des éléments de guerre en dentelles dans la guerre de Sept Ans,
mais elle marque aussi une transition vers une guerre plus dure et plus stratégique.
Bien sûr bébé ! Le lien avec Clausewitz, c’est que le terrorisme islamiste remet en cause sa
théorie classique de la guerre.
1.
Clausewitz et la “guerre réelle”
Clausewitz définit la guerre comme “la continuation de la politique par d’autres moyens”.
Pour lui, une guerre suit trois principes :
1.
Un duel entre deux États avec des armées organisées.
2.
Un objectif politique clair (gagner un territoire, renverser un gouvernement…).
3.
Un affrontement structuré, avec des règles et des stratégies militaires.
Or, le terrorisme islamiste ne respecte aucune de ces règles !
2.
Pourquoi le terrorisme ne rentre pas dans la théorie de Clausewitz ?
•
Il n’oppose pas deux États → Ce ne sont pas des guerres interétatiques,
mais des guerres irrégulières où un État combat un groupe terroriste.
•
Les terroristes n’ont pas d’armée régulière → Ils se cachent dans la
population, font de la guérilla et des attentats.
•
L’objectif politique est flou → Daech voulait créer un califat, mais d’autres
groupes n’ont pas de but précis, juste semer le chaos.
•
La ligne de front disparaît → Il n’y a pas de batailles, les attaques peuvent
avoir lieu n’importe où dans le monde (attentats du 11 septembre, Paris 2015…).
•
Le rapport de force est déséquilibré → C’est une guerre asymétrique, où une
superpuissance combat un ennemi beaucoup plus faible mais insaisissable.
3.
Le terrorisme et la “guerre absolue” de Clausewitz
Clausewitz parle aussi de la “montée aux extrêmes”, où la guerre devient de plus en plus
violente et totale.
Le terrorisme illustre cette idée parce qu’il :
•
une cible.
Supprime toute distinction entre civils et militaires → tout le monde devient
•
Utilise des méthodes extrêmes → attentats suicide, prises d’otages,
décapitations…
•
Génère une réponse militaire disproportionnée → intervention de coalitions,
frappes aériennes massives, surveillance de masse.
4.
En conclusion : Clausewitz doit être adapté
Le terrorisme islamiste ne rentre pas complètement dans le modèle de Clausewitz, mais
certains aspects restent valables (comme la montée aux extrêmes).
💡 Donc, les historiens et stratèges doivent repenser la guerre moderne, car elle ne suit plus
toujours les règles classiques de Clausewitz !
Oui bébé, bien sûr ! Je vais t’expliquer ça en lien direct avec ton cours et les guerres
asymétriques.
1.
Clausewitz et la guerre classique : un modèle dépassé
Dans son modèle classique, Clausewitz parle d’une guerre symétrique, c’est-à-dire :
✅ Un affrontement entre deux États bien définis.
✅ Deux armées régulières qui respectent des stratégies militaires.
✅ Un objectif politique clair : conquérir un territoire, renverser un gouvernement…
Mais dans ton cours, on voit que le terrorisme islamiste ne fonctionne pas du tout comme ça
:
❌ Ce ne sont pas des États qui s’affrontent mais des armées régulières (USA, France…)
contre des groupes terroristes (Al-Qaida, Daech).
❌ Les groupes terroristes ne sont pas des armées classiques → Ils se cachent dans la
population et frappent par surprise (attentats, guérilla).
❌ L’objectif politique est flou → Par exemple, Daech voulait un califat, mais Al-Qaida voulait
juste déstabiliser les puissances occidentales.
C’est pour ça qu’on parle de guerre asymétrique → une armée puissante combat un ennemi
insaisissable, qui utilise des tactiques irrégulières.
2.
Ton cours : la guerre contre le terrorisme = une guerre asymétrique
Dans ton texte, on voit bien que les attentats du 11 septembre ont déclenché une “guerre
globale contre la terreur”, menée par les États-Unis et leurs alliés.
Mais cette guerre est très différente des guerres classiques :
•
Les États-Unis utilisent des méthodes modernes → frappes aériennes,
drones, unités spéciales.
•
Les terroristes utilisent des méthodes irrégulières → attentats, guérilla,
recrutement mondial via Internet.
•
Pas de ligne de front claire → Les combats peuvent se dérouler en
Afghanistan, en Irak, en Syrie, ou même en Europe avec des attentats.
💡 Tout ça montre que la guerre contre le terrorisme ne correspond plus à la théorie de
Clausewitz !
3.
Pourquoi Clausewitz ne fonctionne plus totalement ?
Clausewitz disait que la guerre doit servir un objectif politique clair.
Mais ton cours montre que :
❌ Les victoires militaires ne débouchent pas sur des victoires politiques → Par exemple,
les États-Unis ont vaincu militairement Saddam Hussein et les talibans, mais ça n’a pas
apporté la paix.
❌ Le terrorisme ne cherche pas une victoire militaire classique → Al-Qaida et Daech
veulent semer la peur et déstabiliser des États, pas forcément les envahir.
❌ Les terroristes se fondent dans la population → Impossible de mener une bataille
classique contre eux, ce qui remet en cause le modèle de Clausewitz basé sur des
affrontements directs.
4.
En conclusion : une guerre sans fin et sans règles claires
📌 Ton cours montre que les guerres contre le terrorisme sont hybrides :
•
régulières).
Elles utilisent encore des stratégies classiques (coalitions militaires, armées
•
Mais elles intègrent aussi de nouvelles formes de guerre (drones, guerre de
l’information, cybersécurité…).
💡 C’est pour ça que certains historiens pensent qu’il faut revoir les théories classiques de
la guerre (comme Clausewitz) pour mieux comprendre les conflits modernes !
Donc, en résumé : ton cours montre que Clausewitz ne suffit plus pour comprendre la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- dissertation guerre et paix HGGSP
- dissertation guerre et paix HGGSP: Construire la paix : du système d’équilibre des puissances à la sécurité collective.
- CORTOT, Jean-Pierre (1787-1843)Sculpteur, il réalise de 1839 à 1841, le fronton du Palais Bourbon, dont le thème est " la France entre la Liberté et l'Ordre public, appelant à elle les Génies du Commerce, de l'Agriculture, de la Paix, de la Guerre et de l'Eloquence ".
- Révisions HGGSP Terminale Thème 5 L'environnement
- comment la construction de la paix, à la fin de la Première Guerre mondiale, confirme le suicide de l’Europe