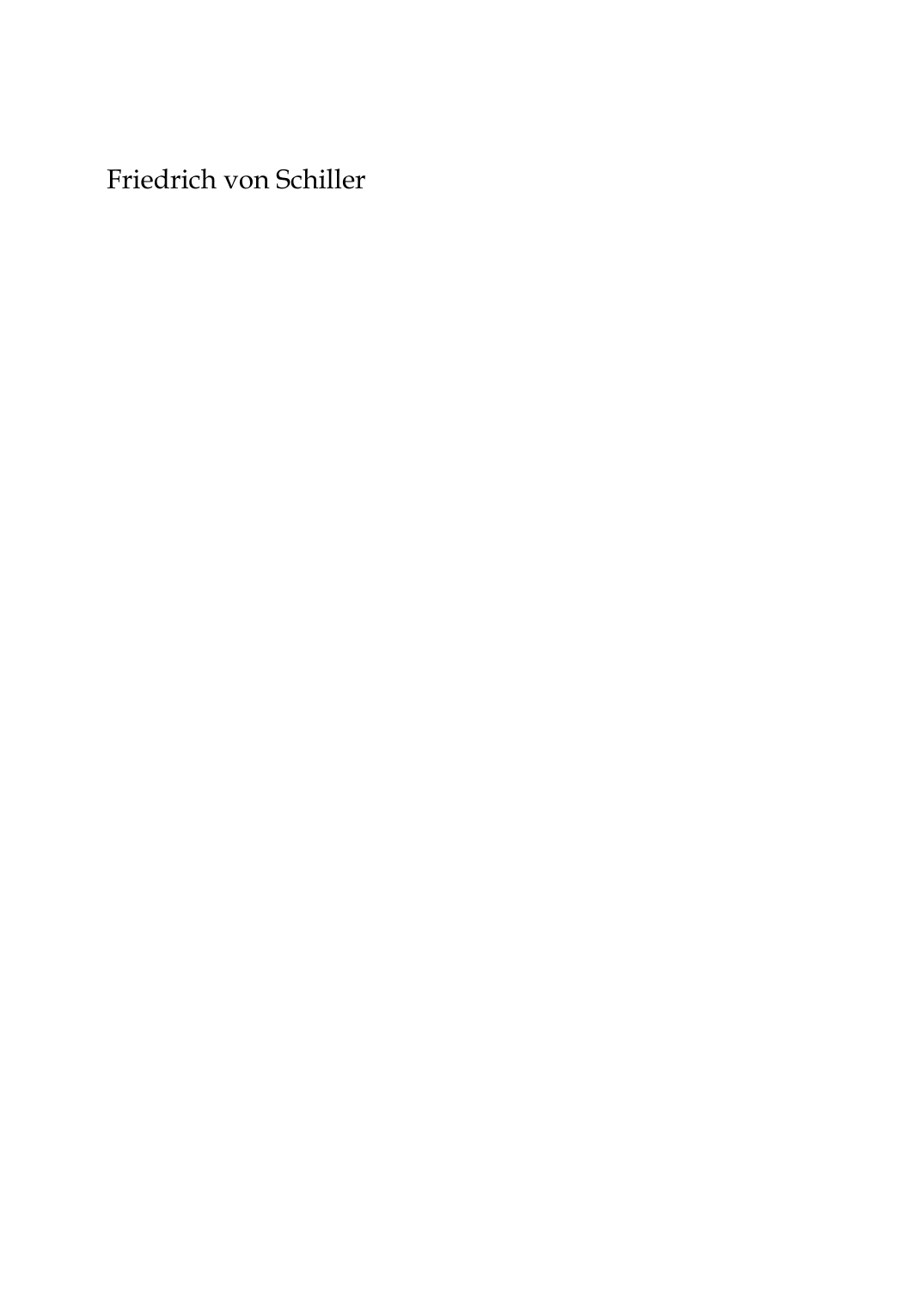Friedrich von Schiller par Kurt May
Publié le 23/05/2020

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Friedrich von Schiller par Kurt May A l'opposé de l'épanouissement organique de la personnalité et de la création de Goethe, entre 1759 et 1805, la vie et l'oeuvre tout entières de Schiller se développent dans un style dramatico-dialectique. Ce document contient 1342 mots soit 3 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Culture générale.
SCHILLER Johann Christoph Friedrich von. Poète et dramaturge allemand. Né le 10 novembre 1759 à Marbach (Wurtemberg), fils de Johann Kaspar Schiller et d’Elisabeth Dorothea Kodweiss. 1773-1780, élève à la Karlschule. Etudie la médecine. 1780, médecin militaire à Stuttgart. 1782, s’enfuit de Stuttgart. 1783, vit a Bauerbach, hôte de Mme von Wolzogen, puis à Mannheim, Leipzig, Dresde (chez Kömer), Weimar (1787). 1789, nommé professeur d’histoire à l’université d'léna. 1790, épouse Charlotte von Lengefeld. 1791, dangereusement malade. 1794, début de la correspondance suivie avec Gœthe. 1799, s’installe à Weimar. 1802, anobli. Depuis longtemps d’une santé chancelante (tuberculose), il meurt à Weimar le 9 mai 1805. Plus jeune que Gœthe de dix ans, Schiller débuta comme son aîné par un coup d’éclat : Les Brigands , qui le rendirent célèbre à vingt-deux ans (1781). Une partie du drame avait été composée à l’école et jouée dans les bois au cours des promenades, quand les surveillants s’éloignaient. Mais Schiller n’appartenait pas, comme Gœthe, à la haute bourgeoisie d’une grande ville. Son père était fonctionnaire du duc de Wurtemberg (d’abord militaire, ensuite inspecteur des jardins) et lui-même distingué par Charles-Eugene qui venait de fonder une école qu’il voulait exemplaire, fut élève boursier, ensuite chirurgien militaire. Mis aux arrêts parce qu’il s'était éloigné de sa garnison afin d’assister à une répétition de sa pièce, déjà parue en librairie et mise en scène à Mannheim (qui n’était pas dans les limites du Wurtemberg), il se vit signifier l’ordre de ne plus écrire d’ouvrages aussi dangereux pour l’ordre social. Alors il s’enfuit sous un déguisement et commença une vie errante et malheureuse, aidé ou recueilli par quelques personnes compatissantes. Un admirateur inconnu, Kömer, l'hébergea chez lui aux environs de Dresde, où il termina Don Carlos , et devint l’un de ses plus fidèles amis avec qui il entretint une correspondance abondante. Les Brigands (thème du brigand vertueux qui n’est poussé que par la haine de l’injustice et l’horreur que lui inspire une société corrompue) de même que Intrigue et Amour (1784) où un ministre retors et scélérat — qui, cette fois n’est pas, comme dans Emilia Galotti de Lessing, en Italie au XVIIe siècle, mais bel et bien dans l’Allemagne contemporaine, et peut-être en Wurtemberg même ! — ajoute des raisons politiques au drame de la mésalliance et montre combien les Grands peuvent être inhumains, alors que toutes les vertus fleurissent chez les humbles et les artisans —, ces deux pièces (séparées par La Conjuration de Fiesque (1782) qui n’eut que peu de succès et n’est pas de la même veine), peuvent déconcerter les lecteurs d’aujourd’hui. Les défauts sautent aux yeux et paraissent inexcusables : caractères outrés, langage hyperbolique, comparaisons ridicules (une vraie ménagerie !), situations simplifiées à l’extrême et peu vraisemblables. Mais Schiller, dès ses débuts, a incarné, ce qui ne fut jamais le fait de Gœthe, le génie du théâtre. Confiés à des acteurs qui sont capables de les bien « composer », ces rôles ont un relief, une grandeur qui les transfigurent : malgré soi on est pris et entraîné par le drame. On se dit : ces nommes sont des fantoches, cela n’existe pas, c’est combiné à plaisir pour nous montrer des monstres ou des anges. Pourtant, on ne peut s’empêcher de sentir qu’il y a là de la passion et de la douleur, peut-être sous une forme brute, mais vraie, comme à l’état primitif. Le grossissement, la simplification et l’outrance que nous admettons, voire recommandons dans la comédie, sont ici dans le drame. Pourquoi le déplorer si nous sommes émus ? Schiller d’ailleurs ne cherche pas visiblement l’effet ou l’antithèse comme le fera Hugo : on sent une âme généreuse et pathétique. Après ces trois œuvres dont deux furent représentées avec éclat, Schiller, recueilli par Kömer, acheva Don Carlos. Si l’on partage sa carrière littéraire, comme celle de Gœthe, en une première période révolutionnaire de « Sturm und Drang » (dont il fut le dernier et le plus puissant représentant) et un « classicisme » dont il meut pas le temps de s’évader, car il mourut à quarante-six ans, Don Carlos marque bien la frontière et le passage. La pièce est écrite en vers, le rythme est plus calme, la frénésie en est absente. Deux intrigues s’y entrecroisent et s’y superposent, car ce drame conçu d’abord comme un drame de famille (le fils amoureux de la seconde femme de son père), tourne au drame politique (le marquis Posa s’efforçant de convertir Philippe II à son idéal de liberté républicaine !). Mais les caractères ont du relief, de la vérité; ils sont moins simplifiés que dans les pièces précédentes et la langue est souvent magnifique de fermeté et d élévation. Ce qu’on appelle le « classicisme » de Schiller ne doit pas induire en erreur : rien de commun entre ce classicisme-là et le nôtre, si ce n’est un certain souci d’ordre, de dignité, de grandeur. Mais Schiller est plus près de Shakespeare que des Anciens. Beaucoup plus résolument partisan des modernes que Gœthe, et avant tout champion de la liberté dans tous les domaines, il façonne le drame à sa guise. Dans la Fiancée de Messine (1803), il cherche à incorporer le chœur de la tragédie grecque et le motif du destin; dans La Pucelle d'Orléans (1802) il traite l’histoire, et même la légende, avec une désinvolture incroyable, Wallenstein (1799) et Marie Stuart (1801) caractérisent bien ce moyen terme entre le classicisme français et le désordre génial de Shakespeare. Mais chez Schiller il y a toujours un souci de moraliste : pour lui, le théâtre doit être une école de vertu, c’est-à-dire qu’il doit enseigner à respecter en soi et chez autrui la liberté et la dignité humaines. Wallenstein passe pour sa pièce la plus classique : c’est le drame, hélas ! toujours renouvelé, de l’homme fort qui se laisse entraîner par un destin hors série qu’il croit seul à sa mesure. La pièce contient de grandes beautés. Le prologue Le Camp de Wallenstein est haut en couleur, grouillant et pittoresque : il expliquera la trahison du chef par le culte que lui vouent ses soldats. La partie intermédiaire Les Piccolomini , en cinq actes, est languissante. La Mort de Wallenstein , également en cinq actes, pourrait se suffire à elle-même et montre Schiller dans toute sa maîtrise. Est-ce la plus belle et la plus forte de ses pièces ? On peut hésiter entre Wallenstein, Marie Stuart et Guillaume Tell car on trouve dans ces trois œuvres toutes les qualités de Schiller et aucun de ses défauts. Marie Stuart, jouée à Paris, récemment, a fait sur la critique et le public une impression profonde. Dans Guillaume Tell, le paysage, l’atmosphère tour à tour champêtre, alpestre, paisible, tourmentée et tragique, les caractères, les sentiments, les péripéties dramatiques, les scènes populaires, de beaux monologues et un souffle d’idéal concourent à exprimer cet amour et cette glorification de la liberté qui furent, a dit Goethe, le ressort principal de tout ce que Schiller écrivit. L’année suivante Schiller mourait. Il avait déjà avancé la rédaction d’un Démétrius qui aurait marqué un renouvellement de sa manière. Que ne pouvait-on attendre de cet homme qui avait, avec ce qu’il a de violent, de vulgaire, de pathétique et de sublime, le génie du théâtre, s’il avait vécu, ne disons pas aussi longtemps que Goethe, mais seulement dix ou quinze ans de plus ? Schiller a écrit des essais d’esthétique et de morale qui restent d’un grand intérêt : De la grâce et de la dignité, De la poésie naïve et sentimentale , Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme . Dans les deux premiers, il cherche à analyser différents aspects du génie (en réalité le sien et celui de Goethe qu’il sentait tout différent). Les termes ne sont pas heureusement choisis, mais ils sont restés usuels : par « sentimental » Schiller entend l’esprit où la réflexion domine et, avec elle, l’inquiétude, les repentirs, l’angoisse, tandis que le génie « naïf » crée comme la nature, pour ainsi dire sans efforts et par une expansion spontanée. Ainsi simplifiée l’opposition paraît artificielle, mais Schiller a su lui donner une valeur exemplaire et en tirer des conséquences très suggestives. Dans les Lettres, il expose une théorie qui revient à dire (c’était au moment où la Révolution française commençait à décevoir ou à indigner même ses admirateurs) que toutes les réformes de l’Etat ne serviront de rien si l’homme intérieur n’a pas changé. Or la culture désintéressée du Beau paraît à Schiller le seul moyen de régénérer l’organisme social, tandis que les rouages de l’Etat, comme il est nécessaire, ne cessent pas de tourner. Expression la plus nette de cet « humanisme esthétique » qui est l’un des plus nobles aspects du classicisme allemand. Les œuvres historiques de Schiller, Histoire de la guerre de Trente Ans et Histoire de la révolte qui détacha les Pays-Bas de la domination espagnole , ne sont pas sans mérites, mais furent des travaux soit alimentaires, soit préparatoires à ses drames. Il nous faut dire un mot de ses poésies. Elles sont apprises dans toutes les écoles allemandes, comme chez nous les fables de La Fontaine. On les trouve dans toutes les anthologies. Confessons que nous sommes embarrassé et craignons d'être injuste. Il y a, d’une part les Ballades — v. Contes et ballades , Le Plongeur , Le Gant , L'Anneau de Polycrate , Les Grues d'Ibycos , Le Combat contre le dragon , La Caution , Le Comte de Habsbourg , — justement célèbres, qui sont de la poésie « épique », dramatique, dont le fond et même la forme prêtent à sourire, mais qui ont du mouvement, sont d’une langue admirablement ferme et qui indiquent une leçon morale sans ambiguïté. D’autre part, il y a les « poèmes philosophiques » — v. Poésies — qui parent des idées abstraites avec les atours de la mythologie. Les thèses que Schiller développe dans ses traités sont mises en vers et s expriment dans des formules, il faut le reconnaître, admirablement frappées et bien faites pour se graver dans la mémoire. Entre ces deux groupes on peut situer le très populaire Chant de la cloche qui retrace en plusieurs épisodes les péripéties de l’existence humaine et, comme l’Ode à la Joie, reprise par Beethoven dans la IXe Symphonie , exprime un généreux et imperturbable idéalisme. Cette cloche-symbole s’appelle Concordia. On connaît l’amitié légendaire de Gœthe et de Schiller. Elle ne fut pourtant pas subite. Schiller, dix ans après Gœthe, portait sur la scène, en les grossissant encore, tous les excès du « Sturm und Drang », au moment où Gœthe cherchait l’apaisement et la simplicité. Tout semblait les séparer. On avait tenté plusieurs fois de les mettre en présence. L’étincelle n’avait pas jailli. Ce fut a la suite d’une conférence sur un sujet d’histoire naturelle, faite à léna en 1794 et à laquelle les deux poètes avaient assisté, qu’ils se parlèrent à la sortie et échangèrent leurs idées. Comme il arrive parfois lorsque nous hésitons à livrer à nos proches les idées qui nous tiennent le plus à cœur, alors que nous en discuterions volontiers avec des étrangers, parce que ceux-ci nous paraissent moins prévenus et plus aptes à nous comprendre, Gœthe confia à Schiller ses conceptions de la «plante symbolique», de la « forme originelle » et de la métamorphose. Dès le lendemain commençait cette correspondance qui ne devait cesser qu’à la mort de Schiller. Tous les sujets qui intéressaient les deux poètes y sont traités et les hommes devinrent eux-mêmes le type de ces amis légendaires qui semblaient n avoir existé que dans l’antiquité. Selon les mœurs les plus répandues (non seulement chez les écrivains !) il eût été naturel qu’ils fussent hostiles l’un à l’autre, chacun cherchant à faire valoir ce qui le distinguait. Schiller avait, peu de temps avant cette rencontre, émis des critiques dont Gœthe avait été blessé. Gœthe, de son côté n’aurait trouvé que trop de prétextes pour blâmer ou railler certaines faiblesses ou des travers, voire des ridicules dans les œuvres de Schiller. Ils se seraient déchirés mutuellement que cela n’aurait pas pu nous surprendre. C’eût été au contraire conforme a la coutume. Ils furent amis. Ils en ont été plus grands. ♦ « Je me vois créer et modeler; j'observe le jeu de mon enthousiasme et ma force d'imagination s'exerce avec une moindre liberté depuis qu'elle se sait observée, mais une fois atteint le point où ma technique artistique sera devenue pour moi une seconde nature, comme l'éducation pour un homme bien élevé, ma fantaisie recouvrera sa liberté éternelle et ne s'imposera plus d’autres limitations volontaires » ... «Je ne me mesure pas avec Gœthe lorsqu'il met en œuvre tout son génie. Il en a bien plus que moi et aussi des connaissances infiniment plus nombreuses, des sens plus parfaits, et, en outre, un sens artistique plus fin et plus pur, grâce à tout ce qu’il sait de l’art dans tous ses genres, choses qui me font défaut à un degré qui confine à l’ignorance. Si je n’avais quelques autres talents et assez de finesse pour déployer ces talents et ces qualités dans le domaine du drame, je serais passé inaperçu à côté de lui. » Schiller. ♦ « A présent, il est vrai, on dit du bon Schiller qu’il n’est pas poète mais nous avons là-dessus notre opinion... Je prends la liberté de tenir Schiller pour un poète, un très grand poète » ... « Les Allemands se chamaillent pour savoir qui est le plus grand de Schiller ou de moi. Ils devraient se réjouir d'avoir des gaillards comme nous, sur lesquels ils puissent discuter. » Gœthe. ♦ «... le premier, fonda notre art dramatique, et le premier, aida à la détruire. » L. Tieck. ♦ « Je nommerais Schiller parmi les plus grand Allemands... s’il y avait en lui autant d’harmonieuse unité que de force combative et d’imagination... » F. Schlegel. ♦ « Schiller était un homme d’un génie rare et d’une bonne foi parfaite, ces deux qualités qui devraient être inséparables, au moins dans un homme de lettres... C’est une belle chose que l’innocence dans le génie et la candeur dans la force. » Mme de Staël. ♦ « Il saisissait dans sa vie même l'esprit de son temps, il luttait avec lui, il était dominé par lui, il portait son drapeau, le même drapeau... pour lequel nous sommes toujours prêts à verser notre sang. Il travaillait à l’érection du Temple de la Liberté... » H. Heine. ♦ « Gœthe peut être un plus grand poète et je crois qu’il l’est en effet; mais Schiller est pour notre nation allemande un plus grand trésor. » F. Grill-parzer. ♦ « L’enthousiasme sublime, éclairé, qui imprègne l’œuvre de Schiller, toucherait davantage notre cœur, s’il se limitait à un champ plus étroit. » Carlyle. ♦ « Ses œuvres semblent des monceaux de grandes idées entrevues : on souhaiterait un plus grand artiste pour leur donner forme. » Nietzsche. ♦ « Dans la personnalité de Schiller, malgré toute sa gravité sainte, appliquée et son infinie acuité d’esprit, qui donc méconnaîtrait l’élément puéril, la noble naïveté qui parfois fait monter aux lèvres un sourire respectueux ?... Ce caractère de grand enfant, d’éternel adolescent, ne se manifeste-t-il pas encore bien au-delà de ce premier stade de sa production... Ne le trouve-t-on pas dans sa rhétorique souvent exagérément exaltée, dans ses effets de théâtre calculés où l’imagination et la nature doivent « conspirer ensemble » ? » Th. Mann.
« Friedrich von Schiller. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Friedrich von Schiller Schiller vit le jour à Marbach, fils d'un fonctionnaire qui l'envoya à treizeans dans l'Académie militaire du duc de Wurtemberg.
- Friedrich von SCHILLER: Guillaume Tell (Résumé & Analyse)
- Friedrich von Schiller
- Kurt von Schuschnigg1897-1959Né à Riva (lac de Garde) dans une famille d'officiers, il est enrôlé en 1915 dans l'arméeautrichienne.
- Friedrich von Holstein1817-1909Ses contemporains traitaient d'" éminence grise " le conseiller-rapporteur du ministère desAffaires étrangères de l'Empire allemand.