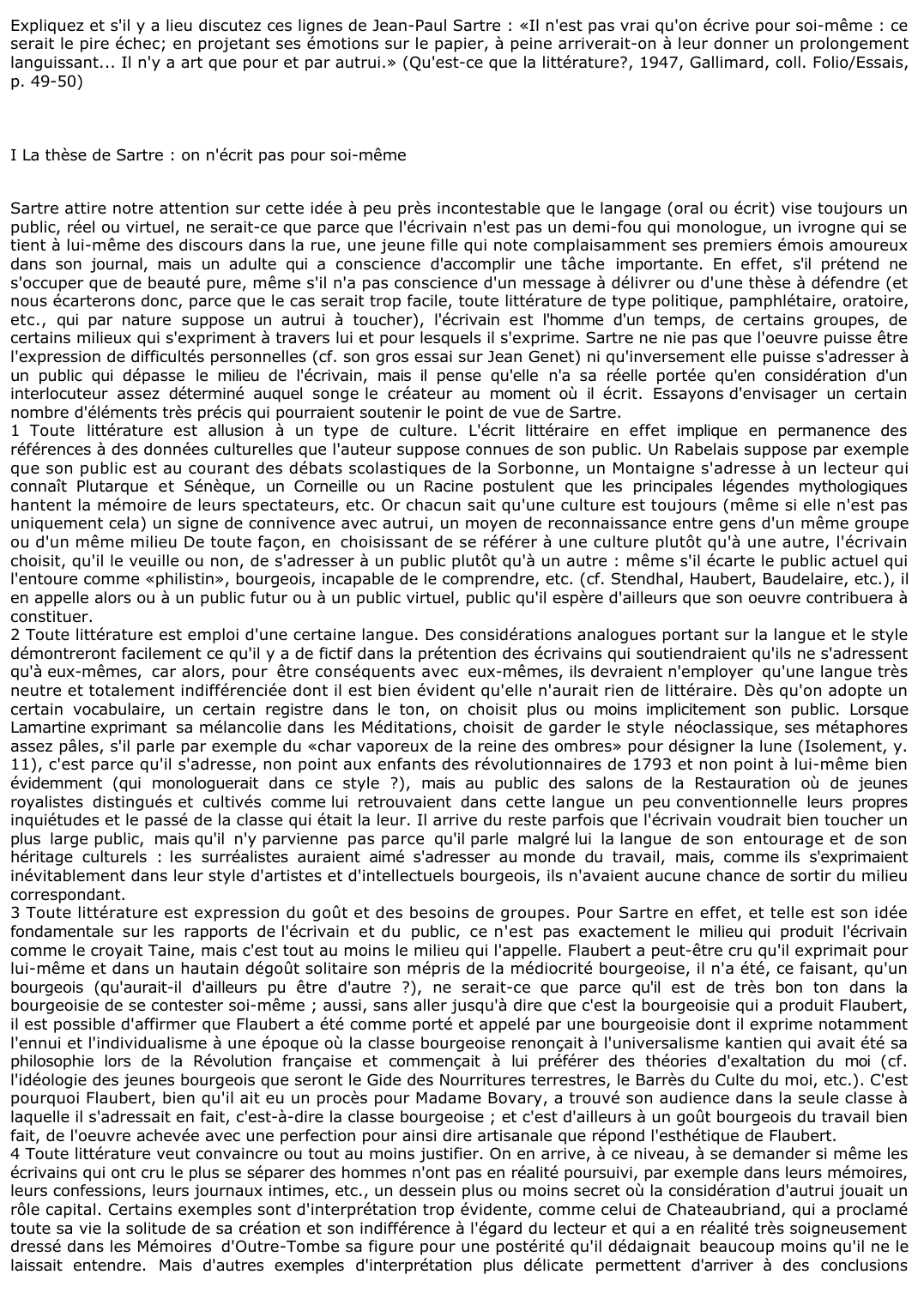Expliquez et s'il y a lieu discutez ces lignes de Jean-Paul Sartre : «Il n'est pas vrai qu'on écrive pour soi-même : ce serait le pire échec; en projetant ses émotions sur le papier, à peine arriverait-on à leur donner un prolongement languissant... Il n'y a art que pour et par autrui.» (Qu'est-ce que la littérature?, 1947, Gallimard, coll. Folio/Essais, p. 49-50)
Publié le 15/05/2020

Extrait du document
«
Expliquez et s'il y a lieu discutez ces lignes de Jean-Paul Sartre : «Il n'est pas vrai qu'on écrive pour soi-même : ceserait le pire échec; en projetant ses émotions sur le papier, à peine arriverait-on à leur donner un prolongementlanguissant...
Il n'y a art que pour et par autrui.» (Qu'est-ce que la littérature?, 1947, Gallimard, coll.
Folio/Essais,p.
49-50)
I La thèse de Sartre : on n'écrit pas pour soi-même
Sartre attire notre attention sur cette idée à peu près incontestable que le langage (oral ou écrit) vise toujours unpublic, réel ou virtuel, ne serait-ce que parce que l'écrivain n'est pas un demi-fou qui monologue, un ivrogne qui setient à lui-même des discours dans la rue, une jeune fille qui note complaisamment ses premiers émois amoureuxdans son journal, mais un adulte qui a conscience d'accomplir une tâche importante.
En effet, s'il prétend nes'occuper que de beauté pure, même s'il n'a pas conscience d'un message à délivrer ou d'une thèse à défendre (etnous écarterons donc, parce que le cas serait trop facile, toute littérature de type politique, pamphlétaire, oratoire,etc., qui par nature suppose un autrui à toucher), l'écrivain est l'homme d'un temps, de certains groupes, decertains milieux qui s'expriment à travers lui et pour lesquels il s'exprime.
Sartre ne nie pas que l'oeuvre puisse êtrel'expression de difficultés personnelles (cf.
son gros essai sur Jean Genet) ni qu'inversement elle puisse s'adresser àun public qui dépasse le milieu de l'écrivain, mais il pense qu'elle n'a sa réelle portée qu'en considération d'uninterlocuteur assez déterminé auquel songe le créateur au moment où il écrit.
Essayons d'envisager un certainnombre d'éléments très précis qui pourraient soutenir le point de vue de Sartre.1 Toute littérature est allusion à un type de culture.
L'écrit littéraire en effet implique en permanence desréférences à des données culturelles que l'auteur suppose connues de son public.
Un Rabelais suppose par exempleque son public est au courant des débats scolastiques de la Sorbonne, un Montaigne s'adresse à un lecteur quiconnaît Plutarque et Sénèque, un Corneille ou un Racine postulent que les principales légendes mythologiqueshantent la mémoire de leurs spectateurs, etc.
Or chacun sait qu'une culture est toujours (même si elle n'est pasuniquement cela) un signe de connivence avec autrui, un moyen de reconnaissance entre gens d'un même groupeou d'un même milieu De toute façon, en choisissant de se référer à une culture plutôt qu'à une autre, l'écrivainchoisit, qu'il le veuille ou non, de s'adresser à un public plutôt qu'à un autre : même s'il écarte le public actuel quil'entoure comme «philistin», bourgeois, incapable de le comprendre, etc.
(cf.
Stendhal, Haubert, Baudelaire, etc.), ilen appelle alors ou à un public futur ou à un public virtuel, public qu'il espère d'ailleurs que son oeuvre contribuera àconstituer.2 Toute littérature est emploi d'une certaine langue.
Des considérations analogues portant sur la langue et le styledémontreront facilement ce qu'il y a de fictif dans la prétention des écrivains qui soutiendraient qu'ils ne s'adressentqu'à eux-mêmes, car alors, pour être conséquents avec eux-mêmes, ils devraient n'employer qu'une langue trèsneutre et totalement indifférenciée dont il est bien évident qu'elle n'aurait rien de littéraire.
Dès qu'on adopte uncertain vocabulaire, un certain registre dans le ton, on choisit plus ou moins implicitement son public.
LorsqueLamartine exprimant sa mélancolie dans les Méditations, choisit de garder le style néoclassique, ses métaphoresassez pâles, s'il parle par exemple du «char vaporeux de la reine des ombres» pour désigner la lune (Isolement, y.11), c'est parce qu'il s'adresse, non point aux enfants des révolutionnaires de 1793 et non point à lui-même bienévidemment (qui monologuerait dans ce style ?), mais au public des salons de la Restauration où de jeunesroyalistes distingués et cultivés comme lui retrouvaient dans cette langue un peu conventionnelle leurs propresinquiétudes et le passé de la classe qui était la leur.
Il arrive du reste parfois que l'écrivain voudrait bien toucher unplus large public, mais qu'il n'y parvienne pas parce qu'il parle malgré lui la langue de son entourage et de sonhéritage culturels : les surréalistes auraient aimé s'adresser au monde du travail, mais, comme ils s'exprimaientinévitablement dans leur style d'artistes et d'intellectuels bourgeois, ils n'avaient aucune chance de sortir du milieucorrespondant.3 Toute littérature est expression du goût et des besoins de groupes.
Pour Sartre en effet, et telle est son idéefondamentale sur les rapports de l'écrivain et du public, ce n'est pas exactement le milieu qui produit l'écrivaincomme le croyait Taine, mais c'est tout au moins le milieu qui l'appelle.
Flaubert a peut-être cru qu'il exprimait pourlui-même et dans un hautain dégoût solitaire son mépris de la médiocrité bourgeoise, il n'a été, ce faisant, qu'unbourgeois (qu'aurait-il d'ailleurs pu être d'autre ?), ne serait-ce que parce qu'il est de très bon ton dans labourgeoisie de se contester soi-même ; aussi, sans aller jusqu'à dire que c'est la bourgeoisie qui a produit Flaubert,il est possible d'affirmer que Flaubert a été comme porté et appelé par une bourgeoisie dont il exprime notammentl'ennui et l'individualisme à une époque où la classe bourgeoise renonçait à l'universalisme kantien qui avait été saphilosophie lors de la Révolution française et commençait à lui préférer des théories d'exaltation du moi (cf.l'idéologie des jeunes bourgeois que seront le Gide des Nourritures terrestres, le Barrès du Culte du moi, etc.).
C'estpourquoi Flaubert, bien qu'il ait eu un procès pour Madame Bovary, a trouvé son audience dans la seule classe àlaquelle il s'adressait en fait, c'est-à-dire la classe bourgeoise ; et c'est d'ailleurs à un goût bourgeois du travail bienfait, de l'oeuvre achevée avec une perfection pour ainsi dire artisanale que répond l'esthétique de Flaubert.4 Toute littérature veut convaincre ou tout au moins justifier.
On en arrive, à ce niveau, à se demander si même lesécrivains qui ont cru le plus se séparer des hommes n'ont pas en réalité poursuivi, par exemple dans leurs mémoires,leurs confessions, leurs journaux intimes, etc., un dessein plus ou moins secret où la considération d'autrui jouait unrôle capital.
Certains exemples sont d'interprétation trop évidente, comme celui de Chateaubriand, qui a proclamétoute sa vie la solitude de sa création et son indifférence à l'égard du lecteur et qui a en réalité très soigneusementdressé dans les Mémoires d'Outre-Tombe sa figure pour une postérité qu'il dédaignait beaucoup moins qu'il ne lelaissait entendre.
Mais d'autres exemples d'interprétation plus délicate permettent d'arriver à des conclusions.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- De nombreux auteurs tels que Voltaire ont pris « leur plume pour une épée » (Jean-Paul Sartre, Les Mots, 1964). Pensez-vous que la littérature soit une bonne arme contre les inégalités ou les abus humains ? Quel(s) genre(s) et quel(s) registre(s) vous semblent-ils le(s) plus efficace(s) dans ce domaine ? Vous appuierez votre réponse sur des exemples précis, tirés de vos lectures personnelles, des textes étudiés en cours et de Candide.
- Jean-Paul Sartre, Les Mots, Gallimard, 1964.
- Thierry Maulnier écrit dans son Racine (p. 70, Gallimard, édit.) : « Montrer sur la scène des monstres ou des meurtres, montrer du sang, montrer de brillants costumes ou des foules ou des batailles, tout cela est bon pour des primitifs, des romantiques ou des enfants. La grandeur et la gloire de l'homme sont d'avoir cessé de montrer parce qu'il a appris à dire. L'art le plus affiné et le plus complexe est nécessairement l'art où le langage - honneur des hommes, dit le poète - a la plac
- Vous expliquerez et préciserez ces lignes extraites d'un article d'Emile Henriot sur le livre de Jean Rousset consacré à La littérature de l'age baroque en France : « Le baroque est un art solide, massif, membré; la préciosité est une afféterie, un jeu salonnier de la pointe! moins que rien.... Cependant baroque et précieux parfois se rencontrent. Comme le baroque et le classique; comme se rencontreront, sans nécessairement se confondre, le baroque et le romantique.... »
- Jean-Paul Sartre par Bernard Pingaud " Qu'il écrive ou qu'il travaille à