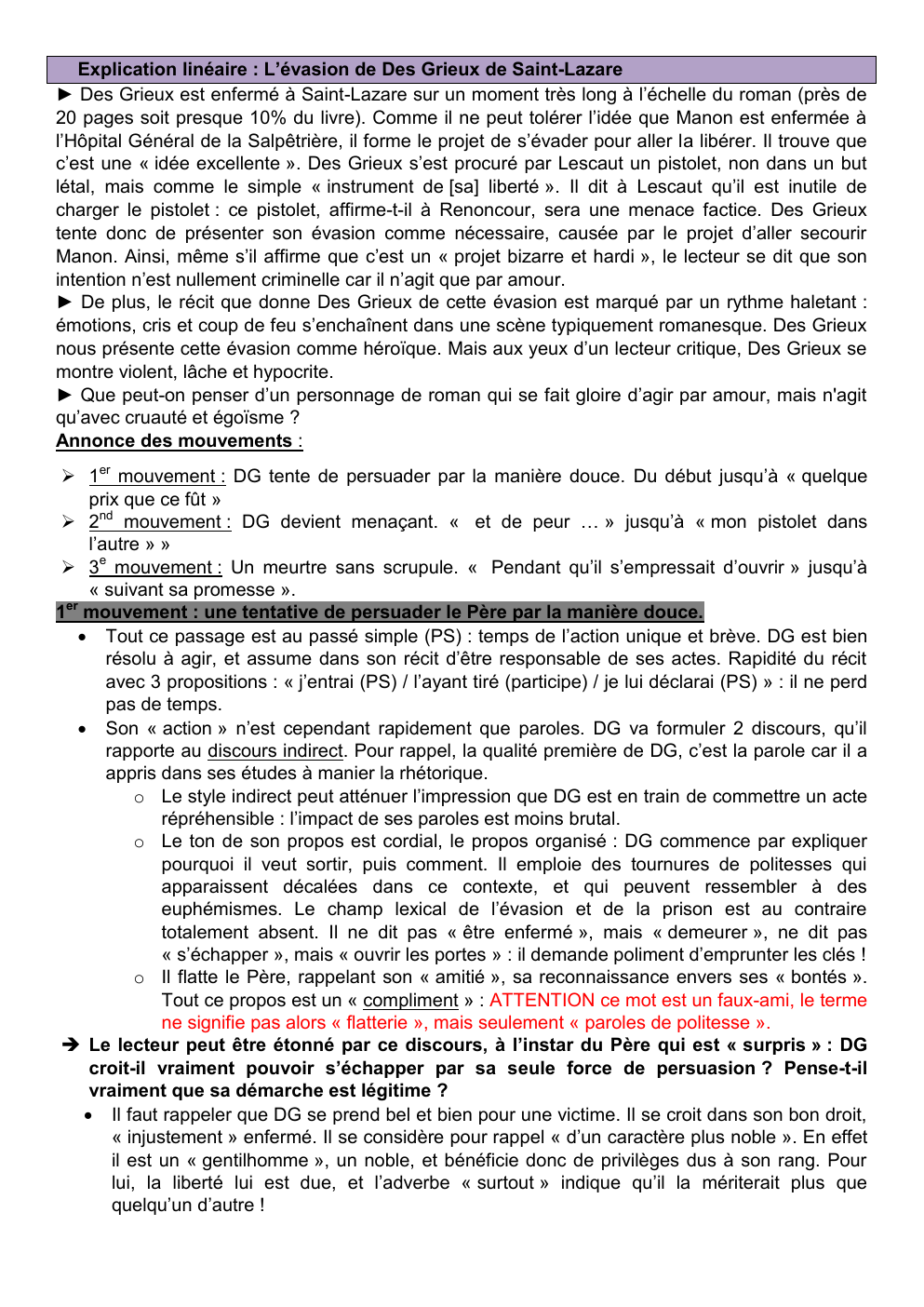explication linéaire: Explication linéaire : L’évasion de Des Grieux de Saint-Lazare
Publié le 18/04/2025
Extrait du document
«
Explication linéaire : L’évasion de Des Grieux de Saint-Lazare
► Des Grieux est enfermé à Saint-Lazare sur un moment très long à l’échelle du roman (près de
20 pages soit presque 10% du livre).
Comme il ne peut tolérer l’idée que Manon est enfermée à
l’Hôpital Général de la Salpêtrière, il forme le projet de s’évader pour aller la libérer.
Il trouve que
c’est une « idée excellente ».
Des Grieux s’est procuré par Lescaut un pistolet, non dans un but
létal, mais comme le simple « instrument de [sa] liberté ».
Il dit à Lescaut qu’il est inutile de
charger le pistolet : ce pistolet, affirme-t-il à Renoncour, sera une menace factice.
Des Grieux
tente donc de présenter son évasion comme nécessaire, causée par le projet d’aller secourir
Manon.
Ainsi, même s’il affirme que c’est un « projet bizarre et hardi », le lecteur se dit que son
intention n’est nullement criminelle car il n’agit que par amour.
► De plus, le récit que donne Des Grieux de cette évasion est marqué par un rythme haletant :
émotions, cris et coup de feu s’enchaînent dans une scène typiquement romanesque.
Des Grieux
nous présente cette évasion comme héroïque.
Mais aux yeux d’un lecteur critique, Des Grieux se
montre violent, lâche et hypocrite.
► Que peut-on penser d’un personnage de roman qui se fait gloire d’agir par amour, mais n'agit
qu’avec cruauté et égoïsme ?
Annonce des mouvements :
1er mouvement : DG tente de persuader par la manière douce.
Du début jusqu’à « quelque
prix que ce fût »
2nd mouvement : DG devient menaçant.
« et de peur … » jusqu’à « mon pistolet dans
l’autre » »
3e mouvement : Un meurtre sans scrupule.
« Pendant qu’il s’empressait d’ouvrir » jusqu’à
« suivant sa promesse ».
1er mouvement : une tentative de persuader le Père par la manière douce.
Tout ce passage est au passé simple (PS) : temps de l’action unique et brève.
DG est bien
résolu à agir, et assume dans son récit d’être responsable de ses actes.
Rapidité du récit
avec 3 propositions : « j’entrai (PS) / l’ayant tiré (participe) / je lui déclarai (PS) » : il ne perd
pas de temps.
Son « action » n’est cependant rapidement que paroles.
DG va formuler 2 discours, qu’il
rapporte au discours indirect.
Pour rappel, la qualité première de DG, c’est la parole car il a
appris dans ses études à manier la rhétorique.
o Le style indirect peut atténuer l’impression que DG est en train de commettre un acte
répréhensible : l’impact de ses paroles est moins brutal.
o Le ton de son propos est cordial, le propos organisé : DG commence par expliquer
pourquoi il veut sortir, puis comment.
Il emploie des tournures de politesses qui
apparaissent décalées dans ce contexte, et qui peuvent ressembler à des
euphémismes.
Le champ lexical de l’évasion et de la prison est au contraire
totalement absent.
Il ne dit pas « être enfermé », mais « demeurer », ne dit pas
« s’échapper », mais « ouvrir les portes » : il demande poliment d’emprunter les clés !
o Il flatte le Père, rappelant son « amitié », sa reconnaissance envers ses « bontés ».
Tout ce propos est un « compliment » : ATTENTION ce mot est un faux-ami, le terme
ne signifie pas alors « flatterie », mais seulement « paroles de politesse ».
Le lecteur peut être étonné par ce discours, à l’instar du Père qui est « surpris » : DG
croit-il vraiment pouvoir s’échapper par sa seule force de persuasion ? Pense-t-il
vraiment que sa démarche est légitime ?
Il faut rappeler que DG se prend bel et bien pour une victime.
Il se croit dans son bon droit,
« injustement » enfermé.
Il se considère pour rappel « d’un caractère plus noble ».
En effet
il est un « gentilhomme », un noble, et bénéficie donc de privilèges dus à son rang.
Pour
lui, la liberté lui est due, et l’adverbe « surtout » indique qu’il la mériterait plus que
quelqu’un d’autre !
2nd mouvement : Des Grieux devient menaçant et traître.
DG ne semble pas avoir attendu très longtemps pour dégainer son argument-choc :
dégainer un pistolet : est-ce vraiment « de peur qu’il n’élève la voix pour appeler au
secours » ? Il semble au contraire que DG avait prémédité l’emploi de son arme.
DG tente ici de se dédouaner étrangement auprès de Renoncour en désignant le pistolet
par la périphrase euphémisante : « une honnête raison de son silence ».
On peut
comprendre « honnête » comme « respectable » : en effet comme il n’est pas souhaitable
de perdre la vie, le choix de se taire est respectable !
o DG renverse ici totalement l’ordre des valeurs morales : selon lui, se taire est un
choix « honnête », tandis qu’il serait dans son bon droit de menacer le prêtre.
« honnête raison » est donc aussi une antiphrase pour le lecteur (antiphrase =
expression à comprendre comme l’inverse de ce qu’elle signifie.)
Peut-être pour la première fois du roman, le lecteur ne peut pas ici se laisser entraîner
par la jeunesse et la soi-disant innocence de DG.
L’irruption pour la première fois de la scène du discours direct laisse entendre la réponse
du prêtre qui est non seulement raisonnable, mais pathétique : l’emploi de « mon fils »,
rappelle que cet homme a été bon envers DG : même si à l’époque un prêtre appelle toute
personne « mon fils » et se fait appeler « mon Père », on se souvient qu’une relation de
type père-fils s’est tissée entre eux.
Le ton exclamatif (« Quoi ! ») et les émotions
rapportées par DG (« pâle et effrayé ») ont plutôt pour conséquence de causer la pitié du
lecteur.
De plus les questions du prêtre « Que vous ai-je fait ? … », qui tentent de montrer à DG
qu’il est ingrat et de l’apitoyer, font aussi ressentir la trahison dont est coupable ce dernier :
pour mémoire, il s’est montré hypocrite depuis qu’il est emprisonné à Saint-Lazare, faisant
croire au supérieur qu’il s’est repenti, et bénéficiant ainsi de sa bienveillance (remise de
peine, liberté d’entrer et sortir de sa cellule…).
Mais DG reste totalement insensible.
Il ne lui fait que se dire de se taire : « Point de
bruit, mon Père ».
Cela renforce l’impression que DG a une conduite brutale et égoïste.
DG est ici coupable de menace de mort : ce faisant, il fait éprouver la peur de mourir à un
homme qui lui faisait confiance.
Que peut penser le lecteur de son attitude ? Du point de
vue de DG, son intention n’est nullement criminelle.
D’ailleurs il inverse l’ordre moral en
affirmant que si son projet échoue, c’est la « faute » du Père.
Mais DG se montre très ambigu dans sa réponse car à la fois il affirme qu’il n’a pas
l’intention de tuer : « A Dieu ne plaise » signifiant « J’espère que ça n’arrivera pas », et à....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- explication linéaire de la scène 4 de l'Acte II du Véritable Saint Genest
- Explication linéaire Ma bohême Rimbaud
- Explication linéaire n°2 : Molière, Le Malade imaginaire, Acte III, scène 3
- explication linéaire Merleau ponty: Les champs perceptif donne une ubiquité spatiotemporelle a l’homme
- Explication linéaire Acte I Scène 3 Ruy Blas