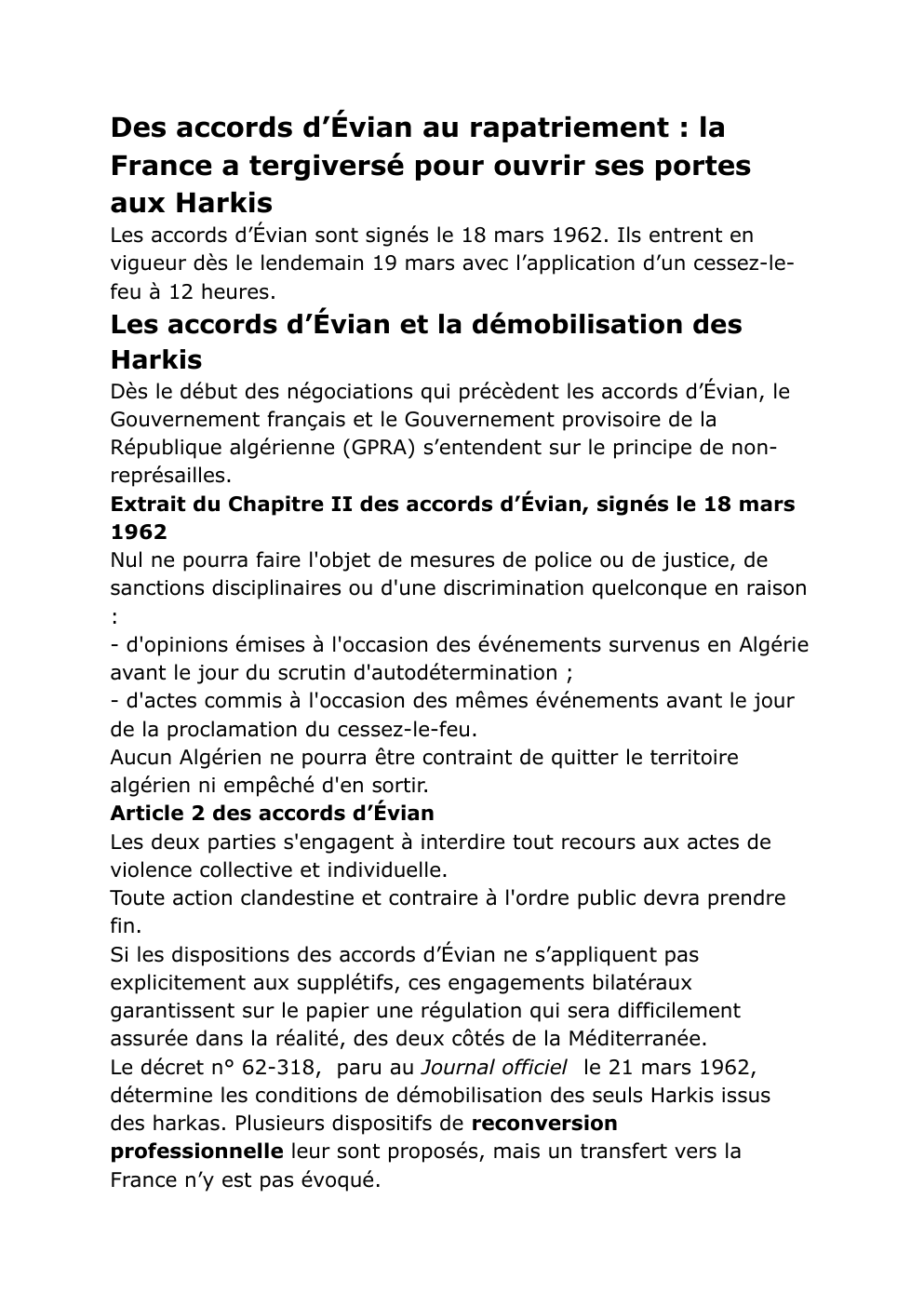Etude des Harki après la guerre d'Algérie
Publié le 02/05/2025
Extrait du document
«
Des accords d’Évian au rapatriement : la
France a tergiversé pour ouvrir ses portes
aux Harkis
Les accords d’Évian sont signés le 18 mars 1962.
Ils entrent en
vigueur dès le lendemain 19 mars avec l’application d’un cessez-lefeu à 12 heures.
Les accords d’Évian et la démobilisation des
Harkis
Dès le début des négociations qui précèdent les accords d’Évian, le
Gouvernement français et le Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA) s’entendent sur le principe de nonreprésailles.
Extrait du Chapitre II des accords d’Évian, signés le 18 mars
1962
Nul ne pourra faire l'objet de mesures de police ou de justice, de
sanctions disciplinaires ou d'une discrimination quelconque en raison
:
- d'opinions émises à l'occasion des événements survenus en Algérie
avant le jour du scrutin d'autodétermination ;
- d'actes commis à l'occasion des mêmes événements avant le jour
de la proclamation du cessez-le-feu.
Aucun Algérien ne pourra être contraint de quitter le territoire
algérien ni empêché d'en sortir.
Article 2 des accords d’Évian
Les deux parties s'engagent à interdire tout recours aux actes de
violence collective et individuelle.
Toute action clandestine et contraire à l'ordre public devra prendre
fin.
Si les dispositions des accords d’Évian ne s’appliquent pas
explicitement aux supplétifs, ces engagements bilatéraux
garantissent sur le papier une régulation qui sera difficilement
assurée dans la réalité, des deux côtés de la Méditerranée.
Le décret n° 62-318, paru au Journal officiel le 21 mars 1962,
détermine les conditions de démobilisation des seuls Harkis issus
des harkas.
Plusieurs dispositifs de reconversion
professionnelle leur sont proposés, mais un transfert vers la
France n’y est pas évoqué.
• Les Harkis peuvent s’engager dans l’armée régulière et être
transférés en France.
Cette option est proposée essentiellement aux
jeunes Harkis célibataires.
• Ils peuvent faire le choix d’un retour à la vie civile, moyennant une
prime de licenciement ou de recasement équivalente à 1,5 mois de
solde par année de service.
Les officiers sont incités à faire pression
sur les Harkis pour qu’ils choisissent cette option.
• Ils peuvent s’engager pour une durée de 6 mois à titre civil en tant
qu’agents contractuels dans les armées.
La France entend se conformer à la lettre aux accords d’Évian.
Toutefois, Louis Joxe, secrétaire d’État aux Rapatriés, donne ses
instructions à Christian Fouchet, haut-commissaire par lettres 395
API/POL du 7 avril, 443 API/POL du 11 avril et du 18 avril 1962, MAE
C.47.
Il écrit :
« Objet : situation de personnes engagées en Algérie aux côtés de
l’Administration ou de l’Armée…/… En ce qui concerne les Harkis, les
Moghaznis et les engagés…/… On ne devra pas hésiter à
regrouper et à protéger ceux qui se trouveraient
effectivement menacés, et le cas échéant, en cas de
nécessité, les acheminer vers la métropole.
»
Dans le même temps, pour les Harkis, en mars, 81,2 % d’entre eux
optent pour le licenciement avec primes et, en avril, un tiers de ceux
qui avaient demandé à s’installer en France y renoncent (CharlesRobert Ageron, « le “drame des harkis”… », p.
4.).
Le rapatriement tardif des Harkis
En France, le Premier ministre Michel Debré procède en février 1962
à l’installation d’une commission interministérielle chargée
d’étudier les possibilités de rapatriement des Harkis et de
leurs familles.
Elle conclut à la nécessité du rapatriement des
supplétifs et souligne que la France "n’a pas le droit [de les]
abandonner" en vertu de la promesse qui leur a été faite au moment
de leur engagement.
Les autorités gouvernementales requièrent alors un recensement
des supplétifs menacés par le Front de libération nationale (FLN).
Le
15 mai 1962, près de 5 000 supplétifs et leurs familles sont
dénombrés et bénéficient de ce plan de rapatriement : ils quittent le
pays au début du mois de juin 1962.
Ex-supplétifs et leur famille
débarqués à Marseille dans l’attente d’un départ pour le camp de
Sainte-Marthe puis celui du Larzac.
Ils sont placés derrière un mur
afin d'éviter les jets de pierres et les insultes d'immigrés, membres
du FLN.
© Fond Pierre Domenech - Source : ONaCVG
Ainsi la majorité des Harkis restent en Algérie tandis que d’autres
supplétifs qui ne sont pas parvenus à se faire connaître par
les autorités administratives embarquent clandestinement
pour la France avec ou sans l’aide de leurs officiers.
Ceux-ci sont
en effet déjà chargés de la logistique de retour des forces armées et
de l’ensemble des rapatriés, soit près de 700 000 personnes durant
l’année 1962.
L’arrivée de groupes d’anciens Harkis en métropole
suscite d’ailleurs la vive réaction de Pierre Messmer, ministre des
Armées, tel qu’il apparaît dans le message ci-dessous.
Il est difficile de déterminer le nombre exact de supplétifs et des
membres de leurs familles rapatriés en métropole.
On estime
toutefois que 66 000 d’entre eux sont arrivés entre juin et
septembre 1962 (source : Service central des rapatriés).Le
lieutenant Yvan Durand, chef de la SAS et de la harka de Maala El
Isseri (Grande Kabylie) démissionne de l’armée pour pouvoir
s’occuper de ses hommes et de leurs familles.
Il demeure alors en
Algérie, sans droit, avec sa femme et sa fille de dix-huit mois, afin
de trouver les moyens d’organiser leur transfert vers la métropole.
Il
attend que tout le monde soit embarqué pour partir, le 30 juin,
dernier jour avant l’indépendance.
Cette photographie montre l’arrivée des familles le 6 septembre
1962, soit 133 personnes au total, ce qui représente la moitié de la
population existante du village d’Ongles (Alpes de Haute-Provence).
En juillet 1962, le ministre des Armées Pierre Messmer signale que
l’armée française ne dispose plus de moyens pour accueillir les
anciens supplétifs dans les camps militaires en Algérie.
Ces
incertitudes amènent le gouvernement français à interdire
fermement les transferts des supplétifs en France et donc à les
abandonner, selon les mots du Président de la République le 20
septembre 2021.
C’est dans ce contexte que des officiers ou des
fonctionnaires, à l’instar du futur général François Meyer, décident
de rapatrier des supplétifs, placés sous leur commandement,
accompagnés de leur famille.
Les Harkis victimes de représailles
Dès le cessez-le-feu du 19 mars 1962, et surtout durant l’été puis
l’automne 1962, certains anciens supplétifs font l’objet de
représailles par les forces indépendantistes et une partie de la
population.
Le nombre de personnes qui ont été exécutées,
torturées ou écrouées demeure indéterminé.
Si le rapport à l’ONU du
contrôleur général de Saint-Salvy fait état de 150 000 morts, les
historiens estiment quant à eux que plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont été exécutées ou assassinées, sans qu’ils ne puissent,
aujourd’hui, apporter une évaluation plus précise et consensuelle.
Ce n’est que le 19 septembre 1962 que le Premier ministre
Georges Pompidou ordonnera le rapatriement des supplétifs
en France.
Des conditions d’accueil et....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La guerre d’Algérie d ans le monde occidental
- l'enjeu mémoriel de la guerre d'Algérie
- Algérie 1994-1995 Une "guerre sans chiffre"
- La guerre d'Algérie (exposé)
- Lhistorien et les mémoires de la guerre d'Algérie